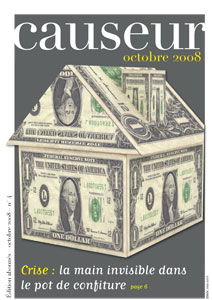Comptez ! Comparez ! Vérifiez ! Depuis que notre compte en banque est supposé être notre ultime patrie, la pingrerie est un devoir patriotique et la méfiance une vertu citoyenne. Dans les cours d’instruction civique, on apprendra bientôt aux gamins à acheter malin. Les magazines qui vous faisaient rêver hier avec des fanfreluches coûtant trois ou quatre mois de votre salaire (pour couvrir à peine 10 % de votre anatomie) vous somment aujourd’hui de recycler les chemises de nuit de grand-mère ou de confectionner des meubles en carton. Bienvenue dans la vie low cost. On ne nous demande plus depuis longtemps d’être de « bons Français », il s’agit de faire de nous des consommateurs avertis – comprenez les plus enquiquinants possibles. Du genre de ceux à qui on ne la fait pas.
Non seulement on nous cache tout, mais en plus on nous vole. Les « révélations » de 60 millions de consommateurs sur les combines des industriels de l’agro-alimentaire pour vous faire payer plus sans que ça se voie ont évidemment suscité un tollé. Sus à l’inflation masquée ! Il faut dire que les fins limiers de « 60 », petit nom que le journal aime à se donner, ont déterré un scandale de taille. Pour éviter d’augmenter le prix unitaire de leurs produits, les industriels vous en donnent moins par unité. Ni vu ni connu, je t’embrouille. Jugez-en plutôt : le paquet de biscuits Prince de Lu ne pèse plus que 300 grammes, contre 330 avant l’été ; le pot de fromage blanc Jockey de Danone est passé de 1 kilo à 850 g, tandis que les petits pots étaient délestés de 10 g, tout comme les Danette (mais, mystère, seulement celles qui sont vendues en paquet de 16). Un autre stratagème dénoncé par les justiciers du pouvoir d’achat consiste à changer le packaging pour pouvoir augmenter le prix : ainsi, le nouveau flacon de vinaigrette à l’ancienne Amora qui contient 450 ml semble bien plus rebondi que l’ancien, qui en contenait 500.
Admettons d’emblée que ce vénérable mensuel (quand j’étais petite, il s’appelait 50 millions de consommateurs) fait œuvre utile, même si son nom me chafouine : le consommateur n’est pas ce que je préfère en moi (ni chez les autres d’ailleurs). Mais passons[1. Dans le genre, Isabelle Giordano a réussi à faire de « Service Public » sa quotidienne « conso » sur France Inter autre chose qu’un carrefour des récriminations, et même un lieu de débat (j’y ai entendu des auditeurs s’énerver de cette obsession collective).].
Toute la journée de mardi, cette bombe eut l’honneur de nos antennes radio et télé – premier, deuxième ou troisième titre selon les heures. Les turpitudes des industriels ont été dénoncées en boucle et le représentant de ceux-ci invité à faire son autocritique une bonne dizaine de fois dans la journée. Du reste, il était plutôt rigolo quand il a essayé de faire gober au téléspectateur que l’amincissement du pot de Jockey était la contribution de Danone à la lutte contre l’obésité. Mon excellent confrère de Marianne Daniel Bernard me fait remarquer qu’il était assez réjouissant d’entendre, pour une fois, les journalistes malmener de gros annonceurs généralement traités avec tapis rouge et impertinence de bac à sable. J’en conviens volontiers. Oserai-je dire que j’ai trouvé beaucoup moins plaisant le spectacle de braves gens transformés en obsédés de l’étiquette ? Au risque d’aggraver mon cas, ma sympathie est allée spontanément aux rares personnes qui ont répondu qu’elles étaient bien incapables de repérer un changement de 30 grammes ou de 20 centimes. C’est que s’il fallait suivre à la lettre les multiples conseils dispensés sur les ondes et les écrans, la vie serait un enfer. Imaginons la journée du consommateur idéal : muni de sa calculette, de sa balance et de sa loupe (pour les étiquettes), il sillonne les rues sur son vélo, allant d’un commerce à l’autre, compare, soupèse, note, établit des palmarès, scrute les clauses écrites en petits caractères, écrit aux services clientèles, alerte la presse. Evidemment, ça lui laisse peu de temps pour travailler. Comment expliquer que personne n’ait encore exigé la création d’un « statut d’intermittent de la consommation » ?
Inutile de monter sur vos petits poneys. Il ne m’échappe pas que nombre de mes concitoyens ont des problèmes de fins et même de début de mois. Je sais à quel point il est désespérant de travailler sans parvenir à vivre de son travail. Et, comme tout le monde, je déteste qu’on me prenne pour un gogo. Mais en l’occurrence, il s’agit d’autre chose – non pas de la réalité mais du récit de la réalité. Depuis que le candidat Sarkozy a commis la sottise de se présenter comme « le président du pouvoir d’achat » (ce qui revenait à dire qu’il était Merlin l’Enchanteur), et que les Français (en tout cas les journalistes, ce qui, en démocratie cathodique est plus important) ont fait la sottise de le croire ou de faire semblant, ce maudit pouvoir d’achat est devenu notre unique horizon, l’aune à laquelle nous jugeons nos gouvernants et, en prime, la mesure d’une existence réussie. Pouvoir d’achat – le terme est à lui seul un programme que devraient récuser avec la dernière énergie ceux qui le brandissent comme s’il contenait la formule magique de la Révolution. Pour ceux qui se sont arrêtés en classe Lénine, on comprend, le slogan doit avoir un vieux relent du « Patron ! Des sous ! » de la cogestion gaullo-communiste des années 1970. Mais il est étrange que Besancenot et les autres, à qui on a bien dû causer de Marcuse, Debord et Lacan, n’entendent pas ce que la formule a d’oxymorique. On ne leur a jamais dit que la consommation est une aliénation ? N’ont-ils pas entendu parler du règne de la Marchandise ?
Il ne s’agit bien sûr pas de nier ou de minimiser la pauvreté et le scandale qu’elle constitue, en termes de justice abstraite et plus encore au regard de la prospérité « moyenne » de la société française. Ce qui est en revanche contestable, et même détestable, c’est le continuum, voire l’amalgame, que le discours médiatique établit entre pauvreté et pouvoir d’achat, deux sujets qui se télescopent en permanence dans l’écriture de l’actualité. En quelques mois, des dizaines, peut-être des centaines de reportages ont fait apparaître sur le devant de la scène un nouveau personnage : le sacrifié du pouvoir d’achat. Entre l’histoire du cadre qui ne peut plus se payer que des vacances au camping, celle des employés qui pratiquent le troc, du jeune prof obligé de loger chez l’habitant, du couple contraint de partager sa pizza au restaurant, chacun peut trouver pauvreté à son pied. À l’arrivée, tout téléspectateur est convaincu que le complot des étiquettes (fomenté soit par les patrons, soit par le gouvernement) a fait de lui un pauvre et qu’il est à 50 centimes d’euros près. Après une journée de matraquage, n’importe qui est prêt à croire que sa vie est dure à cause de la disparition de 150 grammes de fromage blanc par pot ou d’un biscuit par paquet.
Tous pauvres – sauf les riches : telle est donc l’image de la société qui s’imprime dans nos cerveaux. Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi certains (à l’exception, donc, des vrais riches) seraient invités à faire acte de solidarité. Invité mercredi de la matinale de France Inter à l’occasion du début du débat parlementaire sur le RSA, Martin Hirsch tente de faire prévaloir la raison sur le fantasme. « J’ai travaillé toute ma vie, j’ai une petite assurance-vie, je ne comprends pas pourquoi c’est encore à moi de payer », lui lance un retraité furibond pendant « Interactiv », la plage réservée aux appels des auditeurs. Sans se départir de sa courtoisie, l’ancien patron d’Emmaüs réussit à lui arracher le montant de son capital, une quarantaine de milliers d’euros. « Vous allez donc payer 20 € pour le RSA cette année et sans doute moins l’année prochaine », répond-il. On pense alors que le retraité, rassuré, acceptera volontiers de faire ce sacrifice indolore. Mais il n’en démord pas. Il est la victime, le cochon de payant. Et pourtant, lui aussi est pauvre.
Répétons-le pour les malentendants : la pauvreté existe en France, et elle frappe des salariés. Pour autant, faut-il en permanence en agiter le spectre comme si chaque citoyen était menacé par la faim ? Les effets pervers de cette nouvelle croyance collective dans notre propre malheur ne se font pas sentir seulement sur la solidarité mais aussi sur l’économie elle-même dès lors qu’elle pèse nécessairement sur la consommation. Il y a quelques années, les journalistes glosaient abondamment sur le fantasme sécuritaire des petits blancs. Il n’y avait pas d’insécurité mais un « sentiment d’insécurité ». On dirait qu’ils cherchent aujourd’hui à implanter en chacun d’entre nous un « sentiment de pauvreté ». Déjà que ce n’est pas marrant d’être fauché, faut-il, de surcroît, y penser tout le temps ?
PS. On sort d’en prendre et c’est reparti. Deux jours après le scandale du fromage blanc sorti par 60 millions de consommateurs, on nous refait le même coup avec une flopée de sujets sur l’enquête commandée par le Secours populaire d’où il ressort que 40 % des Français ne peuvent se soigner comme ils le voudraient, faute de moyens. Non seulement nous sommes au bord de la famine mais notre situation sanitaire est désastreuse. Bonne journée !
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !