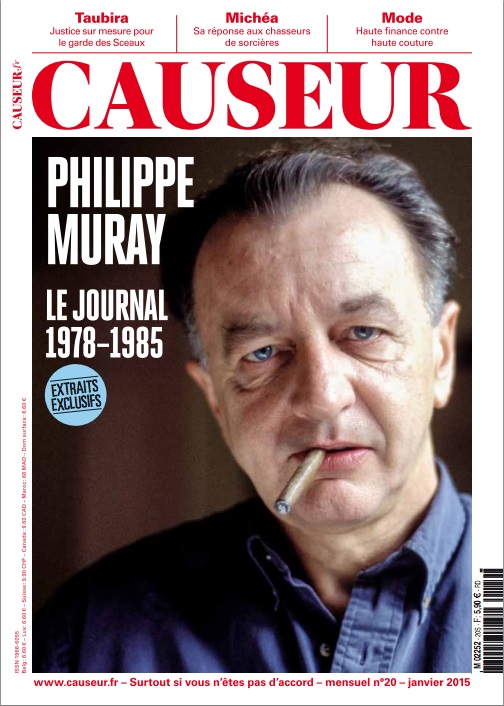« Nous avions plusieurs traits de ressemblance avec ces autres sectateurs de la vie dangereuse qui avaient passé leur temps, exactement cinq cents ans avant nous, dans la même ville et sur la même rive. Je ne peux évidemment pas être comparé à quelqu’un qui a maîtrisé son art comme François Villon. Et je ne me suis pas aussi irrémédiablement que lui engagé dans le grand banditisme ; enfin je n’avais pas fait d’aussi bonnes études universitaires. » Ces lignes teintées de mélancolie et d’ironie sont extraites de Panégyrique, de Guy Debord, autobiographie brève et élégante, à l’image du retrait hautain pour lequel il avait opté après avoir pris acte de son échec à subvertir le monde ancien.[access capability= »lire_inedits »]
Ce « nous », c’est celui du groupe qui ne s’était pas encore baptisé « situationniste » et qui errait « entre la rue du Four et la rue de Buci » avec comme centre de gravité le bar Chez Moineau où se côtoyaient en ce début des années 1950 les étudiants en rupture de ban, les filles de joie, les fugueuses mineures et les petits truands. Finalement, la même compagnie ou presque que celle de Villon, « escolier » buvant « force pots d’eau de vie » dans les tapis francs du vieux royaume, en compagnie des « coquillards », c’est-à-dire ces mauvais garçons, voleurs, tricheurs, assassins parfois, dont un des membres les plus éminents, Regnier de Montigny, est un des légataires du Lais de Villon, la première version de son célèbre Testament. Dans Panégyrique, Debord, le théoricien froid et terriblement lucide de La Société du Spectacle, parue en 1967, se montrait sous un jour nouveau, celui d’un grand seigneur nostalgique, d’un « prince de la division », selon ses propres termes, contemplant la fin de la ville qu’il avait aimée, Paris, et qui avait disparu avec sa propre jeunesse pour devenir une cité adaptée aux convenances du marché : « Qui voit les rives de la Seine voit nos peines : on n’y trouve plus que les colonnes précipitées d’une fourmilière d’esclaves motorisés », écrivait-il, toujours dans Panégyrique. Cela fait un peu plus de vingt ans aujourd’hui que Debord s’est suicidé, et l’on pourra lire pour plus de détails la belle biographie d’Andrew Hussey, enfin traduite en français : Guy Debord. La Société du Spectacle et son héritage punk.
La référence à Villon, chez Debord, ne doit donc rien au hasard, comme le confirmera cette Pléiade que l’on attendait depuis longtemps, des Œuvres complètes de Villon, qui est tout de même, avec Charles d’Orléans et Rutebeuf, un de nos premiers poètes nationaux, passé dans les chansons populaires, avec Brassens pour Les Dames d’antan ou Reggiani pour La Ballade des pendus. Pourtant, jusque-là, Villon n’avait pas trouvé refuge dans la prestigieuse collection. Sans doute pour des raisons de taille. Finalement l’œuvre de Villon est encore plus mince que celle de Debord, qui déclarait par ailleurs : « Quoique ayant beaucoup lu, j’ai bu davantage. J’ai écrit beaucoup moins que la plupart des gens qui écrivent ; mais j’ai bu beaucoup plus que la plupart des gens qui boivent. » Villon, , c’est un peu moins de 3 000 vers, c’est à dire ce qu’un Victor Hugo pouvait produire en un mois… Mais Jacqueline Cerquiglini-Toulet, maître d’œuvre de cette édition remarquable, a décidé de rendre accessible, enfin, un Villon tellement patrimonial qu’on en a oublié de le lire vraiment sauf quelques huitains, toujours les mêmes, que l’on trouve dans les anthologies. Et rendre accessible Villon, qui semblait si fraternel à Debord, suppose aujourd’hui un effort d’élucidation qui justifie amplement l’ampleur de ce volume.
Dieu merci, néanmoins, cette édition n’est pas envahie par ces appareils critiques de plus en plus impérialistes et ces renvois de notes qui transforment le texte en formule algébrique ou ces variantes qui le rendent obèse. Ici, Villon est d’abord accessible par la langue : les poèmes sont traduits en français moderne avec le texte original du xve siècle en regard. Certains regretteront ce parti pris, mais Jacqueline Cerquiglini-Toulet le justifie parfaitement: « La question ne se posait pas il y a cinquante ans, où un homme aussi intéressé par la langue que Queneau pouvait écrire :“ La traduction s’impose pour presque tous les textes avant Villon”. Tel n’est plus le cas aujourd’hui. » Cette traduction se veut par conséquent la plus neutre possible et évite la demi-mesure qui consistait à garder ici et là quelques mots pour donner une couleur d’époque. Mais qu’importe, il suffira au lecteur de coups d’œil de temps à autre sur le texte original pour retrouver toute la charge poétique sans que cela nuise à sa compréhension. Il pourra savourer, par exemple, l’allitération du vers « Que les loups se vivent de vent » traduit par « Où les loups se paissent du vent ». L’autre élément précieux de cette édition, c’est aussi de nous donner des documents d’archives comme les rapports de police des principales affaires dans lesquelles furent impliqués Villon et ses compagnons : l’affaire du Pet au Diable en 1453, autour de l’enlèvement d’une borne devant la maison d’une veuve qui porta plainte. Villon et sa bande n’hésitèrent pas lorsque la police la rapporta dans les locaux du palais de justice à prendre celui-ci d’assaut. Ou encore une affaire de vol au collège de Navarre, sans oublier la plus grave, le meurtre du prêtre Philippe Sermoise.
Dernier apport et non des moindres de cette édition, ce sont les lectures faites de l’œuvre de Villon, de Clément Marot, qui fut son premier éditeur, à Philippe Sollers, qui en fait un poète fondateur de la métrique française dans son roman Les Folies françaises, en passant par Céline ou Rabelais, qui le premier s’interrogea sur la mystérieuse disparition de Villon à partir de 1463. On trouvera également, parmi beaucoup d’autres, des écrivains de la même famille par-delà les siècles, et notamment Mac Orlan et Cendrars, bourlingueurs émérites, francs-tireurs d’une littérature de l’errance, fascinés eux aussi par cette disparition de Villon comme s’ils pressentaient que bientôt, comme c’est le cas aujourd’hui, il deviendrait rigoureusement impossible de s’absenter, de se perdre, de devenir injoignable.
Le seul reproche que l’on pourrait faire à cette édition, finalement, c’est l’absence de Debord. Son biographe Andrew Hussey repère des points de convergence trop nombreux pour être de simples coïncidences. Il souligne notamment que Debord fut un grand amateur du jargon médiéval, cet argot des classes dangereuses, au point d’écrire dans cette langue tout un passage de Panégyrique, ce même jargon utilisé d’abord par Villon dans toute une série de ballades que l’on retrouvera dans La Pléiade et qui méritent le détour : « Que faictes vous toute ménéstrandie ?/Antonnez poix et marques six à six/ Et les plantez au bien en paillardie. »[1. Nous laisserons au lecteur le plaisir de découvrir la traduction légèrement paillarde de ce passage.]
Debord fut aussi, fait largement ignoré, le traducteur de Jorge Manrique, ce Villon espagnol qui comme lui développe les thèmes de la vie comme voyage et surtout du monde comme illusion, ou pour reprendre des termes proprement debordiens, comme Spectacle. Un des vers préférés de Debord, d’ailleurs, sur ce sujet, est de Villon : « Ce monde n’est qu’abusion », que l’on trouve dans La Ballade des seigneurs du temps jadis, « abusion » c’est-à dire-tromperie, illusion, folie. Et Andrew Hussey de commenter : « Au début des années 80, Debord s’identifie avec tout ce petit monde (…), Manrique, Villon, parce qu’ils ont été forcés par les circonstances à renoncer à leur statut initial, dans un monde qui les a déçus. »
Cette déception, c’est pourtant elle, précisément, qui fait naître cette façon poétique d’être au monde, d’aimer les femmes, le vin, l’aventure, le style et les disparitions soudaines. Tout ce qui réunit fraternellement Villon et Debord dans cette grande dérive du temps que notre « escolier » voyait déjà ainsi :
« Moi, pauvre colporteur de paroles
Ne mourrai-je pas ? Oui, s’il plaît à Dieu !
Mais pourvu que j’aie pris du plaisir,
Une bonne mort ne me déplaît pas »
François Villon, Œuvres complètes, édition et traduction de l’ancien français par Jacqueline Cerquiglini-Toulet, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard.
Andrew Hussey, Guy Debord. La Société du Spectacle et son héritage punk, Globe.[/access]
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !