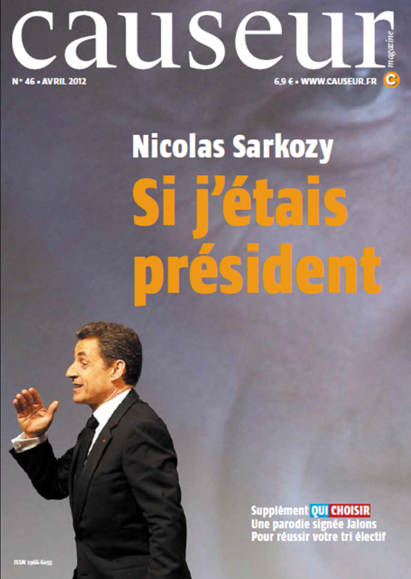« L’histoire entière du Reich millénaire peut-être relue comme une guerre contre la mémoire », affirmait Primo Lévi dans Les Naufragés et les rescapés. Le dernier recueil d’essais du sinologue Simon Leys, Le Studio de l’inutilité, confirme ce dont on avait l’intuition depuis longtemps − et ce que lui-même démontrait déjà dans son célèbre essai, Les Habits neufs du président Mao (1971) : que sur ce plan, le nazisme n’est pas un cas à part, et que l’amnésie obligatoire est au fond inhérente au totalitarisme, qu’il soit ancien ou moderne, occidental ou asiatique.[access capability= »lire_inedits »]
Dans chacun de ces systèmes s’installe en effet un mécanisme d’oubli-destruction qui, selon le politiste Johann Michel, vise à « construire une mémoire officielle hégémonique au détriment de mémoires collectives concurrentes qui font l’objet d’une entreprise systématique d’anéantissement (destruction de documents publics, autodafés…). À travers une telle entreprise, c’est bien entendu l’identité collective (sa reproduction physique, sociale et symbolique) que l’on cherche à bafouer, voire à exterminer. » Construire en détruisant : on devine cette institution de l’oubli dès la Révolution française, convaincue que l’on n’établira pas la République éternelle sans procéder à l’effacement du passé − mais on la retrouve, de façon aussi terrible que spectaculaire, dans les totalitarismes contemporains évoqués par Simon Leys, en Chine ou au Cambodge.
Notre « grande Révolution » prétendait abolir les symboles, les titres, les usages, les dates et les noms, ceux des lieux comme ceux des personnes. Dès le mois de juin 1790, l’Assemblée nationale adoptait ainsi un décret déclarant qu’« il importe à la gloire de la Nation de ne laisser subsister aucun monument qui rappelle les idées d’esclavage ». Et ce n’était que le tout début d’une damnatio memoriae institutionnalisée qui devait se poursuivre pendant une dizaine d’années. Celle qui s’est produite en Chine a débuté dans les années 1960, et elle dure encore : « Car jusqu’à présent, observe Leys, sa métamorphose, sa transformation en super-puissance s’effectue sans mettre en question l’absolu monopole que le Parti communiste continue à exercer sur le pouvoir politique, et sans toucher à l’image tutélaire du président Mao, symbole et clé de voûte du régime ». Or, « le corollaire de ces deux impératifs est la nécessité de censurer la vérité historique de la République populaire depuis sa fondation : interdiction absolue de faire l’histoire du maoïsme en action. […] Quarante années de tragédie historique (1949 – 1989) ont été engloutis dans un trou de mémoire orwellien : les Chinois qui ont 20 ans aujourd’hui ne disposent d’aucun accès à ces informations-là ». Ainsi, par exemple, « le massacre de Tiananmen a été entièrement effacé de la mémoire de la nouvelle génération », à qui l’on offre en échange des dérivatifs puissants, un « nationalisme grossier », un « carnaval érotique » permanent, et surtout, bien entendu, la recherche monomaniaque du profit matériel. Et c’est ainsi, constate le Prix Nobel de la paix Liu Xiaobo, que « la poursuite exclusive de l’intérêt personnel et l’endoctrinement incessant de l’idéologie du Parti communiste ont produit une génération d’individus dont la mémoire est absolument vide ». Poupées dociles entre les mains du Parti dès lors qu’il leur fournit, sous leurs formes modernes et en quantité suffisante, du pain et des jeux.
Le cas du Cambodge, s’il a duré moins longtemps, est encore plus significatif. Au départ, comme dans n’importe quelle construction totalitaire, il y a un projet sublime − la construction d’une sorte de paradis sur Terre, le dépassement ultime des inégalités, des contraintes et des conflits : « Le monde entier, proclame ainsi la propagande du régime, a les yeux tournés vers le Kampuchéa démocratique, car la révolution khmère est la plus belle et la plus pure. La révolution khmère est sans précédent dans l’histoire universelle. Elle a réglé l’éternelle contradiction entre villes et campagnes. Elle dépasse Lénine et va plus loin que Mao Zedong. » Mais pour passer du rêve à la réalité, il n’y a pas d’autre moyen que de la nier, avec une férocité proportionnée à sa résistance, et à la grandeur de ce que l’on se propose d’instaurer.
Les Khmers rouges contrôlent le Cambodge entre avril 1975, date de la prise de Phnom Penh par Pol Pot, et janvier 1979. Mais « durant cette période relativement courte, remarque Leys, le régime réussit à parachever son grandiose projet de destruction totale de la société » − et en particulier, d’éradication absolue de la mémoire. Pour ce faire, ils vont privilégier deux voies.
D’une part, une entreprise génocidaire qui, affirme Leys, se situe dans « la grande tradition hitléro-lénino-stalino-maoïste » : le moyen le plus achevé d’effacer tout lien avec le passé étant en effet de supprimer les hommes. D’autre part, la mise en avant d’une vérité de substitution, si fantasmatique, si évidemment fausse soit-elle : et c’est ainsi que Pol Pot « célébrait les splendides progrès du pays, de la production industrielle et agricole, de l’économie, de l’éducation et de la culture à un moment où cette partie de la population qui avait temporairement échappé au massacre titubait de famine dans un dénuement proprement préhistorique – les écoles n’existaient plus, le commerce avait disparu, la monnaie avait été abolie et, à la campagne, il y avait des bourreaux qui pratiquaient le cannibalisme » – le tout, comme naguère dans la Chine de la révolution culturelle, sous le regard émerveillé ou complaisant de certains observateurs étrangers.
Tel est, en somme, le principal mérite du nouvel essai de Simon Leys : rappeler instamment à ses lecteurs que sans mémoire, il n’y a ni raison, ni liberté. Et que tout attentat contre elle entrouvre la porte à la folie, et au despotisme.[/access]
Simon Leys, Le Studio de l’inutilité, Flammarion, 2012.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !