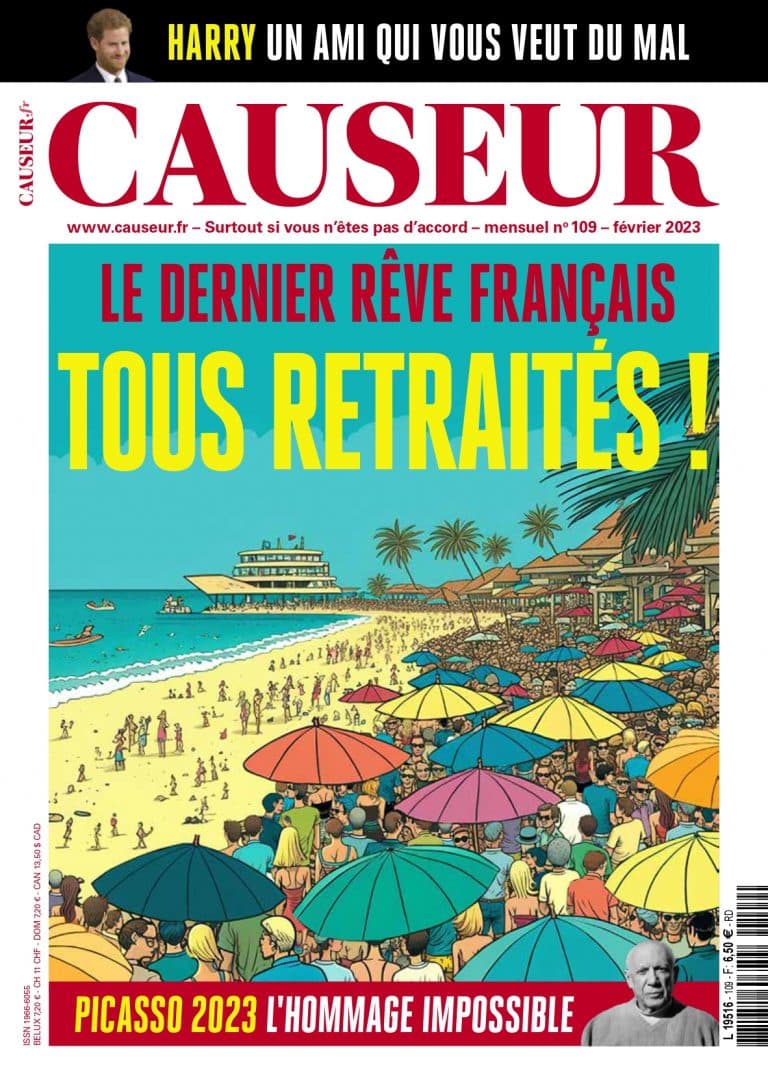Le monde de l’entreprise a instauré entre employés un rapport de soumission qui peut aller jusqu’au sentiment de déchéance. Or le travail, c’est l’honneur, l’accomplissement de soi à travers la reconnaissance d’autrui. Fort de cette dignité, on accomplit ses devoirs.
Il peut paraître étrange, dans le monde d’aujourd’hui, de faire appel à un terme aussi archaïque que celui d’honneur. Mais il est irremplaçable pour rendre compte des rapports que les Français entretiennent avec leur travail. Il prend alors le sens que lui donne Montesquieu, qui l’associe aux idées de grandes actions, de distinction, de fierté et de volonté de « chaque personne et de chaque condition » de juger ce qui, la concernant, est honorable.
« Mon mandat, c’est une noblesse, et je veux en être digne de la manière que je déciderai », déclarait François Mitterrand. On retrouve dans ce propos les grands traits de l’honneur : le lien avec la place que l’on occupe dans la société, la noblesse d’un « rang » ; l’obligation d’être à la hauteur de ce rang, d’en être digne ; la volonté d’être seul juge des exigences dont il est porteur. Ces traits sont présents aujourd’hui en France dans le domaine du travail.
Sentiment de déchéance
Il est contraire à l’honneur de plier, par peur ou par intérêt, devant quiconque, supérieur, client ou membre d’un autre service, peut vous faire profiter de ses faveurs à condition