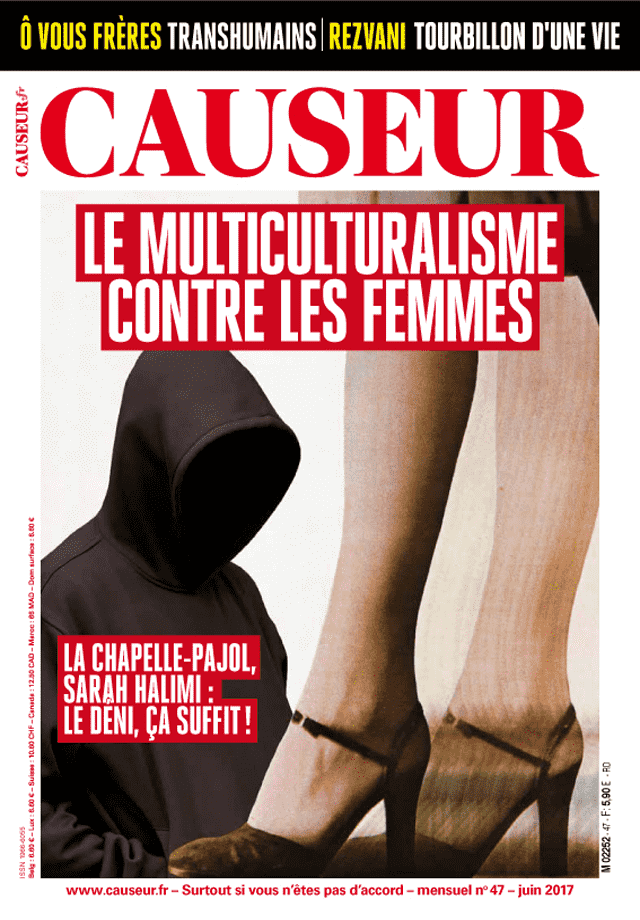Causeur. Comment définir le transhumanisme ?
Béatrice Jousset-Couturier. Ce mot a été employé pour la première fois en 1957 par Julian Huxley, premier président de l’Unesco et frère de l’auteur du Meilleur des mondes, pour définir un homme qui dépasserait ses limites. Dans son édition 2017, le Larousse introduit ce nouveau mot et définit le transhumanisme comme « un mouvement prônant l’utilisation des technologies pour améliorer l’être humain (physiquement et intellectuellement) ». C’est-à-dire en langage transhumain : moins souffrir, moins vieillir, moins mourir. Ou encore : vivre plus longtemps en bonne santé !
A lire aussi: L’utérus artificiel est l’avenir de la femme
Que s’est-il passé entre la naissance du mot et son apparition dans le dictionnaire soixante ans plus tard ?
Le courant transhumaniste s’est développé dans les années 1980 aux États-Unis, sur la côte californienne. Initié par la communauté américaine des geeks, le mouvement est bientôt rejoint par des ingénieurs, des scientifiques, des techniciens, des informaticiens – mais aussi des philosophes, des écrivains, des futurologues – et s’enracine dans la Silicon Valley. La World Transhumanist Association (WAT) est créée en 1998 et devient en 2008 Humanity+, actuellement dirigée par Natasha Vita-More. L’Europe préfère quant à elle parler de « techno-progressisme ». En France, l’association Technoprog voit le jour en 2007.
Ces structures préparent la révolution transhumaniste de demain. Une grande transformation de l’humanité connue sous le nom barbare de « NBIC ». Que signifie ce sigle ?
Dans NBIC il y a : « N » pour « nanotechnologies », l’étude de l’infiniment petit (10-9m) ; « B » pour « biotechnologies », principalement l’étude du génie génétique ; « I » pour « informatique », c’est-à-dire l’ensemble des données, ce qu’on appelle le Big Data ; et « C » pour « cognitif », qui désigne tout ce qui touche au cerveau. On parle de convergence NBIC car à chaque fois que la connaissance dans l’un de ces domaines s’améliore, cela accroît celle des trois autres. Une des causes de cette dynamique est la puissance de plus en plus exponentielle des ordinateurs, qui offre en retour à la technologie un champ des possibles jusque-là inimaginable.
Avant d’explorer ce champ des possibles, faisons un petit détour par Darwin.