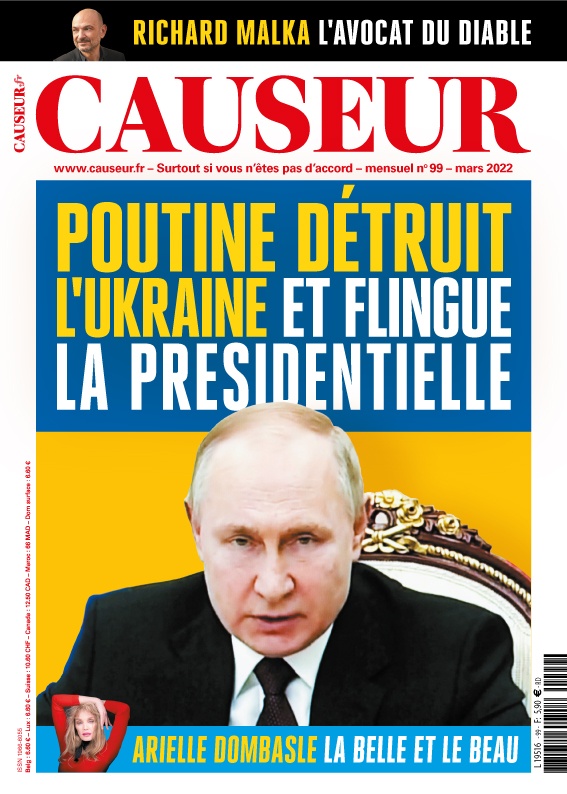L’OTAN ne menace pas la Russie. Ce qui inquiète Moscou, c’est l’insolente longévité et la bonne santé de l’Alliance atlantique face à sa perte d’influence. En reproduisant les agressions de l’URSS, le Kremlin n’ébranlera pas l’organisation américaine.
L’OTAN était-elle, fin 2019, « en état de mort cérébrale » comme le suggérait alors Emmanuel Macron ? En tout cas, le pronostic vital n’est plus engagé. L’OTAN est en pleine forme.
À quoi sert l’OTAN ? La question, légitime en 1990, a été close assez vite. La France avait tort, à l’époque, de parier sur son étiolement. L’organisation, disait son premier secrétaire général, avait pour vocation de « conserver les Américains en Europe, garder les Russes en dehors, et s’assurer que les Allemands soient tenus ». Sa valeur pour les États-Unis reste intacte : outre qu’une guerre en Europe ne serait pas dans l’intérêt de Washington, l’Alliance reste un levier d’influence politique… et commerciale : nombre d’alliés cherchent à s’attirer les bonnes grâces du protecteur en achetant du matériel de défense made in USA. La mission première de l’OTAN, la défense collective, est revenue au premier plan en 2014. L’organisation a su diversifier ses compétences en assurant, généralement sous mandat de l’ONU, des missions de soutien ou de rétablissement de la paix. Et s’il n’est plus question du retour d’une menace allemande, l’« élargissement », dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, avait aussi pour but de pacifier le continent européen.
14 nouveaux membres de l’OTAN depuis 1999
L’entrée de pays d’Europe de l’Est n’allait pas de soi. En 1991, les États non membres qui évoquaient cette perspective étaient accueillis froidement par leurs homologues occidentaux. Le seul élargissement souhaité était celui… de l’Allemagne, dont les Länder orientaux furent couverts par la garantie transatlantique dès l’unification.
Mais pour de vieilles nations telles que celles d’Europe centrale, rejoindre l’OTAN voulait dire retrouver la famille occidentale. Et pour elles, seule la garantie américaine pouvait assurer leur sécurité face à une menace militaire à l’Est. De ce fait, l’« élargissement » fut un processus ad intra bien davantage qu’ad extra. L’alliance atlantique n’y voyait pas d’avantage militaire. Cela signifiait accroître le territoire à défendre tout en faisant entrer des États dont les armées s’étiolaient. Mais il y avait trois aspects positifs : sécuriser l’Allemagne en l’enserrant dans un voisinage amical ; éviter, après la dissolution du Pacte de Varsovie, la renationalisation des politiques de défense ; enfin, pour l’Amérique, se constituer de nouveaux alliés (et clients), garantir sa place sur le continent face aux velléités de construction d’une Europe de la défense, et contribuer à l’agrandissement de l’espace libéral. Depuis 1999, l’OTAN a accueilli 14 nouveaux membres au total.