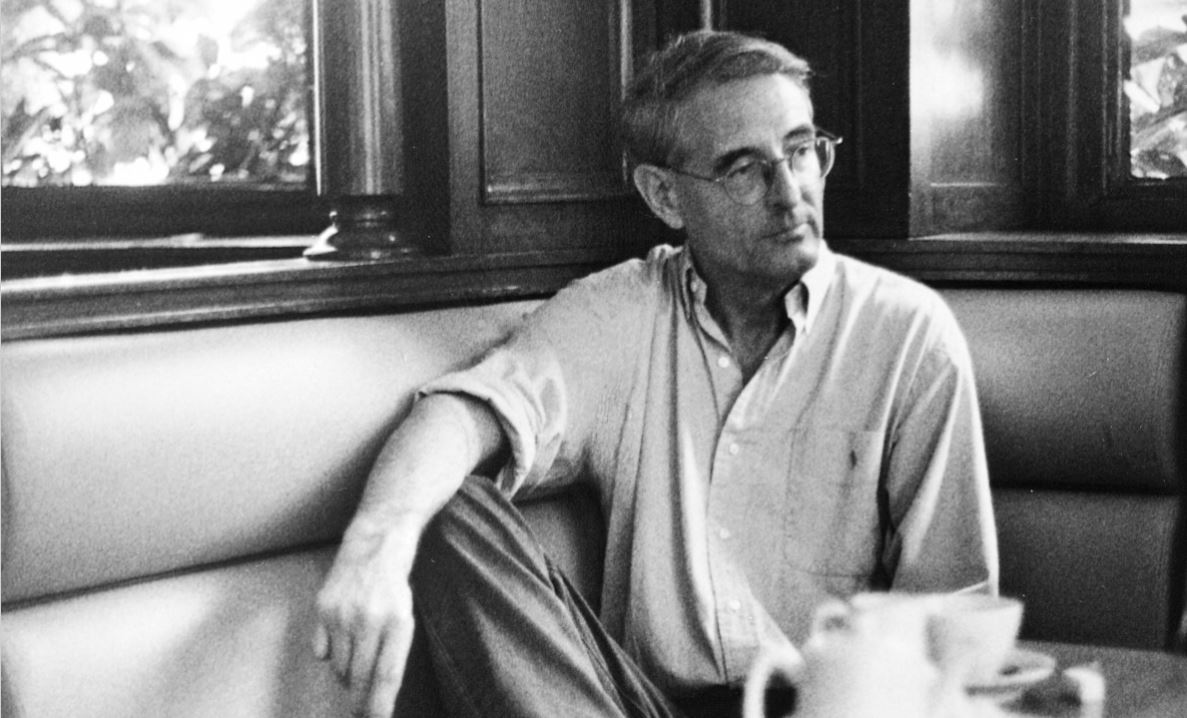1. La question que j’entends le plus souvent : pourquoi ne vous êtes-vous pas encore suicidé ? Sous-entendu : votre nihilisme serait-il en carton-pâte ? Je songe à Jean-Pierre Georges qui écrivait joliment : « Prévenez-moi si la vie commence ! Je ne voudrais pas rater ça. » J’aimerais bien aussi qu’on me prévienne qu’elle est finie. Mais peut-être qu’on le fait… et que je refuse d’entendre. D’ailleurs, je remarque que je deviens un peu sourd.
Je relis la lettre que Jean-Pierre Georges m’a écrite hier. Il me parle de Penseurs et Tueurs et des Derniers Jours d’Amiel. Leur lecture, me dit-il, l’a soustrait à la morosité et a mis quelques bulles pétillantes dans son eau plate. « La ritournelle humaine, ajoute-t-il, devient sous votre plume corrosive d’un coup éminemment réjouissante. » Que demander de plus à la littérature ?
Nous sommes sur la même longueur d’onde : le charme, la