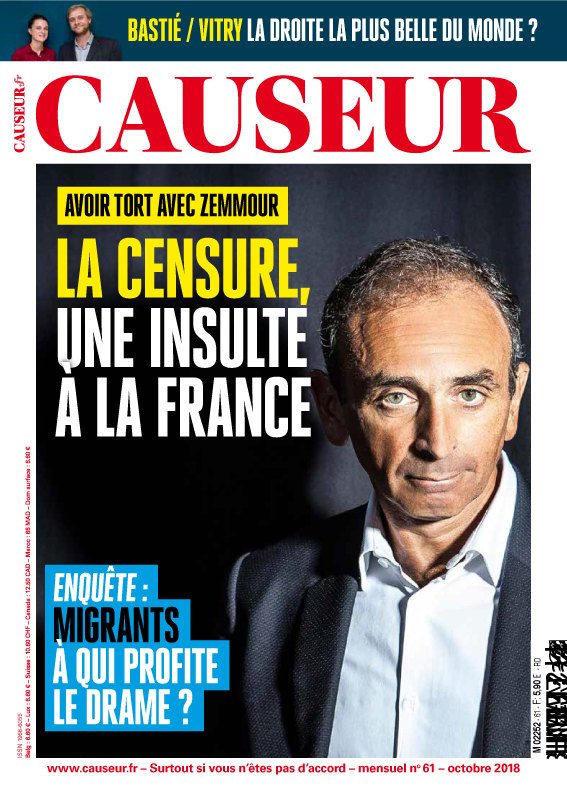Dix ans après la fin de la guerre civile qui s’est soldée par la défaite des Tigres tamouls, l’un des plus sectaires des mouvements indépendantistes, le Sri Lanka jouit d’une forte croissance économique. Malgré la nationalisme exacerbé de la majorité cinghalaise, ce pays profondément divisé sur le plan ethnique et religieux ne pourra éternellement ignorer les revendications de ses minorités.
Malgré une spectaculaire transformation économique depuis une dizaine d’années, les vieux démons de la division ethnique planent toujours sur le pays aux innombrables Bouddhas souriants. Depuis la fin de la guerre civile opposant l’armée aux « Tigres » tamouls en 2009, le Sri Lanka connaît une forte croissance économique (plus de 5 % en moyenne sur les dix dernières années), dopée par les exportations, le tourisme et les investissements chinois. Ce développement impressionnant entraîne son lot de problèmes, comme un boom de construction anarchique défigurant parfois ses magnifiques côtes. Le pays a pourtant tout pour séduire chaque année un nombre croissant de touristes : des plages paradisiaques, des sites archéologiques, des paysages sublimes, ainsi qu’un mélange inédit de cultures bouddhiste, hindoue et chrétienne. Et les investissements étrangers sont encouragés par des politiques incitatives.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, grâce à sa situation géographique stratégique dans l’océan Indien et aux exportations de thé (la marque Lipton est associée à Ceylan), le pays était le plus développé d’Asie après le Japon. L’instabilité politique, le choix d’une économie planifiée et trente ans de guerre civile n’ont pas permis au Sri Lanka de figurer parmi le club des tigres asiatiques aux performances économiques spectaculaires. Au Sri Lanka, les « Tigres », c’était le nom que s’était donné la LTTE (Liberation Tigers of Tamil Ealam), le mouvement politico-militaire, totalitaire et terroriste qui revendiquait l’indépendance des régions nord et est, où les Tamouls sont majoritaires et qui, pendant plus de vingt-cinq ans, a contrôlé jusqu’à un quart du territoire national.
Aujourd’hui, la question tamoule mine toujours la politique sri lankaise et se décline à travers deux dimensions complémentaires, l’une liée aux conséquences de la guerre et l’autre à