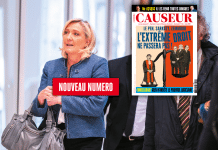L’État perd ses meilleurs serviteurs, et son autorité. Parce qu’ils sont mal payés (profs, médecins) ou parce qu’ils cèdent aux sirènes du privé (haute fonction publique), les fonctionnaires qui le peuvent quittent le navire, affaiblissant la culture du service public, le sens de l’État et celui de l’intérêt général.
La Révolution française n’a pas remis en cause la puissance de l’État royal, patiemment construit et consolidé par la monarchie. Elle a même renforcé sa centralité par son jacobinisme. Elle a en revanche aboli les privilèges de naissance de ceux qui en assuraient la direction au profit d’un principe électif (chargé de fournir une classe politique nouvelle) et d’un principe méritocratique (chargé de recruter les fonctionnaires). Conformément aux textes constitutionnels, les fonctionnaires travaillent au service de la nation et pour l’intérêt général, mais ils obéissent aux lois et au gouvernement, c’est-à-dire au pouvoir politique. Napoléon Bonaparte a renforcé la puissance de l’État républicain. Il a créé une justice administrative pour protéger l’État et ses serviteurs (les fonctionnaires) des administrés, du peuple et de ses juges. La Révolution avait assez montré leur potentiel révolutionnaire. Dans le monde anglo-saxon, on protège les sujets et les citoyens de l’État : notre inversion démontre en creux la place prestigieuse et l’étrange privilège historique des serviteurs de l’État en France.
Une fonction publique devenue obèse
Mais depuis deux siècles, des évolutions profondes ont modifié la donne, et peu à peu abaissé la puissance publique et étatique. L’évolution est préoccupante depuis un petit demi-siècle. D’abord, l’État, qui était sobre jusqu’à la guerre de 1914, a considérablement grossi et le nombre de ses fonctionnaires a crû en conséquence. De quelques centaines de milliers de fonctionnaires au xixe siècle – armée et professeurs compris –, on est passé à 6 millions, non comptés les contractuels, les sous-traitants (y compris désormais les cabinets de conseil), les secteurs paraétatiques, à commencer par la médecine financée sur fonds publics, et la masse des associations et des entreprises financées par l’État. La filiale française d’Acted, parmi d’autres ONG, est financée par cinq niveaux de donateurs publics (UE, l’AFD pour l’État, des régions, des départements et des communes), de sorte qu’on se demande si elle est une ONG ou un bras décentralisé de l’État ? La fonction publique est devenue obèse, et ses missions comme ses compétences se sont diluées au point qu’une zone grise entoure toutes les actions de l’État et de ses démembrements. La SNCF a ainsi été méthodiquement démembrée, tronçonnée entre activités d’investissement, de fonctionnement, de transport, de low cost, etc., semi-privatisée – ses grandes gares étant transformées en galeries commerciales, tandis que les petites