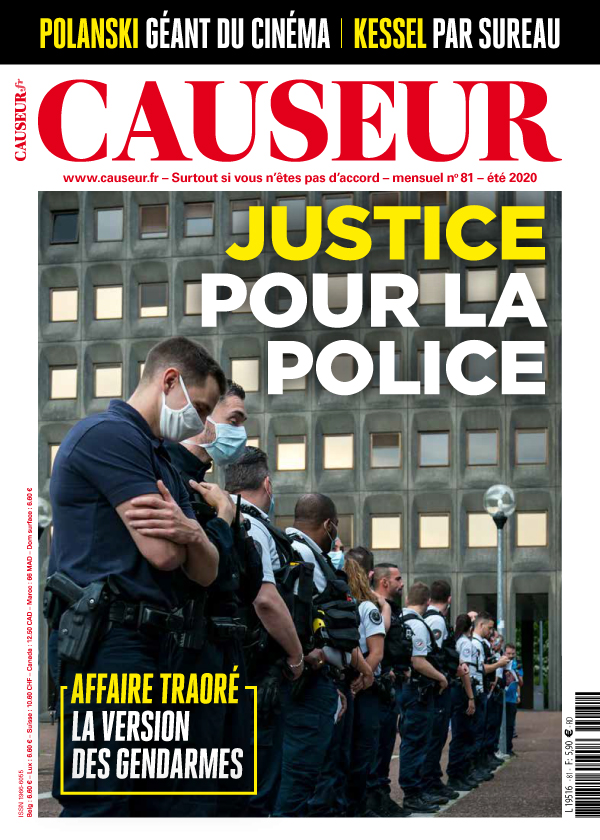Les meilleurs films de Roman Polanski, de « Rosemary’s Baby » au « Pianiste », brouillent désespérément la frontière entre le réel et l’imaginaire. Ils ne conduisent pas à la solution d’une énigme, mais nous enfoncent au cœur de cette énigme. Là se trouve la clé de son cinéma, comme celle de son existence.
C’est par un court-métrage, Deux hommes et une armoire (1958) que Polanski a été repéré en France, d’abord par les cinéphiles. On aima ici son esprit d’absurdité troublante : deux hommes portant une armoire sortent des flots de ce qui pourrait être la Baltique. Ils errent ensuite dans une ville où ils croisent des voyous, des tueurs de petits chats, des exemplaires d’humanité capables du pire.
Depuis, Polanski n’a pas cessé de nous inquiéter. Il se méfie de la réalité, mais n’en prend sans doute pas assez soin, car elle n’a cessé de se venger. Polanski est un survivant. Durant la soirée des Césars (plus vulgaire et navrante que d’habitude[tooltips content= »Dans son hommage rendu aux morts de l’année, l’académie césarienne a oublié volontairement le nom de Jean-Claude Brisseau, auteur d’une œuvre très au-dessus de la majorité des films français de ces dix dernières années. Nul, dans la salle, n’a manifesté au moins son étonnement sinon sa réprobation. Doit-on s’étonner de cette preuve supplémentaire de bassesse morale, d’incompétence et de lâcheté de groupe ? »]1[/tooltips]), quelques manifestantes, aveuglées par les lacrymogènes et la colère intersectionnelle consécutive ont protesté : « C’est Polanski qu’il faut gazer ! » Les nazis y auraient pensé avant elles, si par malheur le petit Roman était tombé entre leurs mains…
Le Pianiste : fenêtre sur mur
Né à Paris de parents polonais, en 1933, il suit sa famille dans le pays de ses origines trois ans plus tard (voir l’article de Patrick Eudeline). Il aime les « salles obscures » du cinématographe : « J’adorais le rectangle lumineux de l’écran, le faisceau qui perçait l’obscurité depuis la cabine du projectionniste, la synchronisation miraculeuse du son et de l’image [tooltips content= »Roman Polanski, Roman par Polanski (trad. Jean-Pierre Carasso), Robert Laffont, 1984 (rééd. Fayard, 2016). »]2[/tooltips] […]. » Mais les nazis, qui envahissent la Pologne le 1er septembre 1939, ont d’autres projets pour lui, et pour les juifs en général…
La mémoire ancienne est imprécise, mais elle fixe des moments forts. Pour l’enfant du ghetto, la persistance rétinienne fait surgir un mur de briques, annonciateur des calamités. Ce mur, qui ferme brutalement une rue, dans Le Pianiste (2002), Polanski l’évoquait parmi d’autres souvenirs sauvés du temps et de l’oubli dans son autobiographie, et dans un entretien accordé à Catherine Bernstein [tooltips content= »Dans la collection