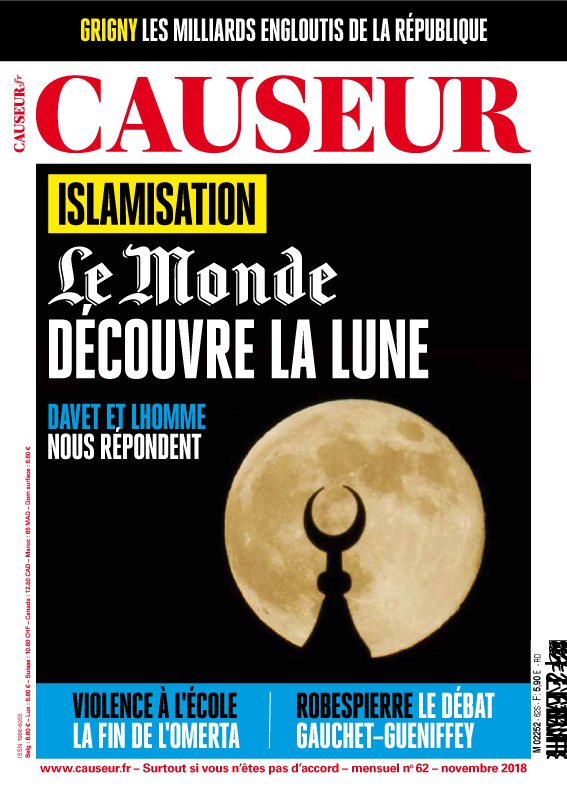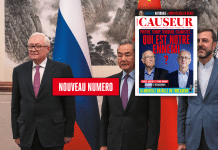Pour saluer la parution de Robespierre, l’homme qui nous divise le plus, le nouvel essai de Marcel Gauchet, nous avons voulu le confronter à l’historien Patrice Gueniffey. Pourquoi ce symbole de la Terreur et des grands principes démocratiques habite-t-il toujours le subconscient français ? Quelle est sa postérité ? Un débat passionnant et toujours ouvert.
Causeur. Marcel Gauchet, pourquoi consacrer un livre à Robespierre aujourd’hui ?
Marcel Gauchet. Parce qu’il y a lieu de revisiter la signification de l’expérience révolutionnaire. Or, Robespierre est le concentré de la mémoire de la Révolution française. Aucun autre ne l’incarne autant que lui. Certains – Sieyès, Mirabeau, Danton – représentent un de ses moments, mais dans l’imaginaire collectif, Robespierre épouse l’ensemble du mouvement révolutionnaire avec une netteté particulière, car il est chaque fois le plus marquant. Il exprime et représente à la fois la radicalité révolutionnaire de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) et la radicalité du renversement des principes de la liberté dans leur contraire : la Terreur.
Sans doute, mais depuis le bicentenaire célébré en 1989, la Révolution française elle-même n’est plus une question qui fâche. En dehors des universitaires, qui s’intéresse encore à Robespierre ?
Marcel Gauchet. Vous avez raison : le bicentenaire a été, après deux siècles de débats passionnés, un enterrement de la Révolution. Mais nous sommes en train de changer d’époque : après une phase d’oubli, non pas de la mémoire révolutionnaire, mais de la manière dont elle s’est traduite dans le débat politique, nous entrons dans une période de réappropriation mémorielle du passé national. Dans cette nouvelle configuration, deux tendances se heurtent. D’un côté, une pente qui tend vers l’oubli et la banalisation de la France, dans le contexte européen et global. De l’autre, une réaction dite « identitaire », qui traduit un profond mouvement de redéfinition des identités nationales dans ce qu’elles ont de particulier. Le passé, dont nous avons eu l’impression d’être délivrés, revient, au moins comme question. Or, dans le passé national, la Révolution joue un rôle-clé.
Patrice Gueniffey, observez-vous, comme Marcel Gauchet, ce retour de la Révolution française dans le débat national ?
Patrice Gueniffey. Je n’en suis pas sûr. Ce que je vois, en revanche, c’est une nouvelle phase dans laquelle l’esprit de la Révolution continue de vivre dans le travail de la démocratie, mais sous une forme qui n’est plus politique. La phase d’explicitation politique de la Révolution et de ses conséquences est à peu près épuisée : la France a trouvé un équilibre politique en réussissant à articuler Ancien Régime et République dans le cadre de la Ve République. La démocratie comme régime politique n’est plus vraiment contestée : fascisme et communisme ont disparu. Si la Révolution vit encore, souterrainement, c’est davantage comme une promesse d’égalité vague et indéfinie.
C’est pourquoi Robespierre a toujours une actualité : nous assistons à la surenchère des droits qu’il a incarnée plus que les autres. S’il reste dans la mémoire collective, c’est précisément parce qu’il est l’homme des principes. Il incarne la radicalité de l’idée démocratique elle-même : le fait que l’idéal démocratique ne peut être pleinement atteint, l’insatisfaction qui en découle et la quête de toujours plus de démocratie qui s’ensuit. Aujourd’hui, les principes, les droits individuels parlent aux gens, tandis que la citoyenneté, l’État, la souveraineté, toutes choses qui étaient l’objet politique même de la Révolution et que Robespierre avait également incarnées, ne leur parlent plus. Une moitié de Robespierre a survécu. Par ailleurs, ressentiment et jalousie – sentiments typiquement français – contribuent à protéger Robespierre contre l’oubli. Ne fut-il pas l’homme du soupçon ? Dans le très médiocre film Un peuple et son roi, Robespierre est, avec Saint-Just, le seul personnage vraiment consistant. Les autres sont des ectoplasmes qui traversent l’écran sans qu’on sache très bien de qui il s’agit. Mais le Robespierre terroriste n’a pas disparu, lui non plus. Avec la transformation de la mémoire historique en morale, il incarne plus que jamais le bourreau, et Marie-Antoinette la victime.
Il y a donc une légende noire (le tyran) et une légende dorée (l’incorruptible) de Robespierre. Peut-on complètement échapper à ces mythes ? Comment éviter à la fois la réhabilitation et la diabolisation ?
Marcel Gauchet. J’ai essayé de me tenir à l’écart de ce dilemme entre damnation et réhabilitation. Il faut rendre compte de l’étrangeté de l’attraction que ce personnage, peu fait pour attirer quoi que ce soit, a exercée pendant la Révolution. Comment ce type, pas aimable, froid, distant, ne faisant confiance à personne, en prend-il la tête jusqu’à en devenir le visage ?
Il devait y avoir deux cents personnes comme lui à l’Assemblée en 1789 et Robespierre n’a aucune raison de s’imposer, surtout face à des personnages très en relief. Mais il a su mobiliser l’opinion publique, attirer l’attention et devenir populaire alors que ce n’était pas un démagogue comme il y en avait des quantités. Ses dissertations laborieuses devaient endormir la population des sans-culottes, mais ils étaient prêts à se faire couper en deux pour lui. Sans Robespierre, la trajectoire révolutionnaire, à partir de la Convention, n’aurait pas été ce qu’elle a été. Il faut expliquer cette puissance hors pair. Mon livre est une tentative de dégager l’entrelacs entre cette puissance mobilisatrice et la face très sombre du personnage.
Comment la décririez-vous ?
Marcel Gauchet. Je dirais que ce manœuvrier hors pair manifestait une parfaite indifférence à la dimension humaine de la politique qui n’était pas, cependant, de l’inhumanité.
Pour vous, c’est un homme-idée empreint d’une certaine mystique…
Marcel Gauchet. Mystique, oui, certainement ! Aux yeux de la postérité et jusqu’à aujourd’hui, c’est le seul saint laïque de la mémoire française. Il est parfaitement laïque et parfaitement saint en même temps, une sacrée performance !
Patrice Gueniffey. Je suis d’accord avec Marcel sur le fait que Robespierre ne sort pas du lot et ressemble en apparence à la plupart des députés. Du moins au début de la Révolution. Ce qui ne résout pas la question du mystère