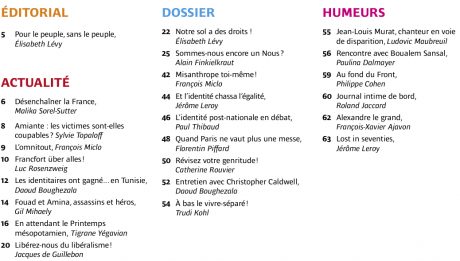Ce n’est ni dans un reportage, ni dans une enquête sociologique, ni chez un philosophe contemporain que j’ai trouvé la description la plus précise, la plus concrète et la plus aiguë de la crise contemporaine du vivre-ensemble, mais au chapitre XIII du Léviathan, le livre fondateur publié par Thomas Hobbes en 1651 : « Les humains n’éprouvent aucun plaisir mais plutôt un grand déplaisir à demeurer en présence les uns les autres s’il n’y a pas de puissance capable de les tenir tous en respect. Car chacun cherche à s’assurer qu’il est évalué par son voisin au même prix qu’il s’évalue lui-même, et chaque fois qu’on le sous-estime, chacun s’efforce naturellement, dans la mesure où il ose, d’obtenir par la force que ses contempteurs admettent qu’il a une plus grande valeur. »
Telle est la grâce des auteurs classiques. Ils appartiennent à l’histoire des idées et, en même temps, ils lui échappent. Ils ne nous renseignent pas seulement sur ce qu’ont pensé nos ancêtres et nos précurseurs, ils jettent sur ce que nous sommes et sur ce qui nous arrive un éclairage infiniment précieux. Nous visitons le patrimoine, c’est-à-dire le musée des choses mortes et, soudain, c’est un pan de notre vie ou de notre monde qui surgit en pleine lumière.
En lisant Hobbes, donc, nous nous lisons. Une part importante de la violence contemporaine résulte du désir d’être respecté, du sentiment de ne pas l’être, de la colère suscitée par un regard de travers ou un regard tout court lorsqu’il fallait baisser les yeux pour manifester sa soumission. C’est le club de football qui a manqué de respect à un joueur en n’acceptant pas ses conditions financières. C’est le mec qui a manqué de respect à ma sœur. C’est le professeur qui a manqué de respect à l’élève en lui mettant une mauvaise note assortie d’une appréciation négative. « J’ai encore en mémoire, écrit Véronique Bouzou, professeur de français en zone dite « sensible », le visage d’un élève qui s’était avancé vers moi sa copie à la main, pour me demander sèchement : » C’est quoi cette vieille note que vous m’avez mise ? » ». Selon lui, la raison de sa mauvaise note ne faisait aucun doute : c’était de ma faute et pas de la sienne. J’ai réussi à lui faire reconnaître sa mauvaise foi quand il a relu à haute voix sa copie, totalement illisible. Mais je crains de plus en plus la réaction imprévisible des élèves qui prennent une mauvaise note pour un manque de respect et qui le font payer cher à leur prof. » La même conception du respect est à l’œuvre chez les jeunes qui se sentent bafoués et méprisés quand le bruit court que l’institution veut toucher aux vacances scolaires. Le 1er octobre, Le Figaro publiait un entrefilet ainsi libellé : « Une rumeur » infondée et ubuesque « , selon le rectorat de Lille, sur la suppression d’un mois de vacances, a déclenché des manifestations de lycéens et des violences urbaines dans plusieurs villes du Nord du pays, à Lens et Béthune, Douai et Dunkerque et près de Paris. Une dizaine de voitures ont été retournées et endommagées, des vitres brisées autour du lycée professionnel Jean-Moulin, au Chesnay, dans les Yvelines. »[access capability= »lire_inedits »]
Hobbes a écrit le Léviathan dans une Europe ravagée par les guerres civiles. Il a vu à l’œuvre trois causes principales de conflit : la compétition, la défiance et la gloire. « La première pousse les hommes à attaquer pour le profit, la seconde pour la sécurité, la troisième pour la réputation. Dans le premier cas, les hommes utilisent la violence pour se rendre maîtres de la personne d’autres hommes, femmes, enfants et du bétail ; dans le second, pour les défendre ; dans le troisième, pour des détails, comme un mot, un sourire, une opinion différente et tout autre signe qui les sous-estime, soit directement dans leur personne, soit, par contrecoup dans leur parenté, leurs amis, leur nation, leur profession ou leur nom. » Confronté à ce déchaînement, Hobbes a pensé la politique comme un moyen de pacifier le vivre-ensemble. Le premier, il a imaginé de fonder l’État sur un contrat social, un covenant, une convention expresse ou tacite, un traité de non-agression. Pour le dire avec les mots de Renaud Camus, « chaque signataire virtuel renonce à quelque chose, à sa violence, à sa force, à son pouvoir et même à sa liberté ultime dans les grandes aussi bien que dans les petite choses, liberté de déranger, d’importuner, d’attenter à la liberté de tous les autres, afin d’avoir la paix et de poursuivre l’accomplissement pour chacun de tout ce qu’il peut être, de tout ce qu’il y a en lui de virtualité d’être. Et tous les autres, en retour de ce moins qu’il s’impose, − et que Renaud Camus appelle l’in-nocence, c’est-à-dire la non-nocence, le combat contre la nocence originelle − lui garantissent par un mouvement semblable et symétrique le plus que constitue, dans sa vie, leur propre renonciation à l’agression et à l’importunité, c’est-à-dire, sous les espèces de leur propre in-nocence, sa tranquillité, sa sécurité, son droit à réaliser sans nuire tout ce qu’il a en lui de capacité d’exister. La conviction étant évidemment que toutes les parties gagnent au change et que le plus qui échoit à tous est infiniment plus précieux que le moins dont tous se sont dépouillés. »
Ce pacte fondé sur le principe du moins pour le plus est un pacte de respect mutuel, mais au sens kantien du mot « respect ». Kant définit le respect comme « une maxime de restriction, par la dignité de l’humanité en une autre personne, de notre estime de nous-mêmes ». Face aux nombreux comportements toujours plus négligents et péremptoires qui empiètent sur la sphère d’autrui, face à ce qu’on range sous le nom générique d’« incivilités », on en appelle aujourd’hui avec insistance au « respect ». Et ce « on » inclut même Libération, le journal issu de l’esprit de 68, c’est-à-dire de l’insurrection contre les formes, de la levée des inhibitions, de l’idée que toute restriction du moi est une répression exercée à son encontre. En 68 et dans les années qui ont suivi, nous avons entrepris de libérer l’être du carcan du paraître et des automatismes vieillots de la respectabilité bourgeoise. C’était cela la libération qui a donné son nom au premier grand quotidien générationnel. Or, voici que ce même quotidien organise à Rennes (c’était en avril 2011), un grand forum national sur le thème « Respect, un nouveau contrat social » avec, en guise de programme, ces phrases bien senties : « Il faut être coupé des réalités pour ne pas voir que le lien social s’est étiolé, que nous ne savons plus dire bonjour, accepter l’autre dans sa différence et qu’à force de tolérer cette accumulation de petites indifférences, on se retrouve un jour avec une énorme masse d’incivilités qui débouche sur une société de plus en plus individualiste, violente dans laquelle l’avidité a tendance a supplanter la fraternité. » Ironie de l’histoire : les mêmes, qui avaient cru pouvoir remplacer les convenances par le « cool », constatent aujourd’hui que la spontanéité n’a pas répondu aux immenses espoirs placés en elle et que les ravages de l’irrespect laminent notre monde.
Ce diagnostic est irréfutable et le détour par Hobbes permet de le préciser, de l’approfondir. L’irrespect est d’autant plus ravageur qu’il n’est pas l’autre du respect mais un autre respect. Et toute la question est de savoir ce qui va l’emporter, du respect au sens défini par Kant de « restriction de l’estime de soi-même » ou du respect au sens dénoncé par Hobbes de « la volonté manifestée par chacun d’être évalué par son voisin au prix qu’il s’évalue lui-même ». Deux régimes, deux conceptions du respect se disputent notre vivre-ensemble – celui qu’on me doit l’emportant malheureusement sur celui que je dois à autrui.
Ce choc des respects est aussi un choc des civilisations. Virilité exacerbée et confinement des femmes d’un côté ; de l’autre, mœurs adoucies par la tradition française de la mixité heureuse, cet « undertone of respectful flirtacion between every man and woman in France » (cette « basse continue de flirt respectueux entre les hommes et les femmes en France ») dont s’enchantait Thorton Wilder cité par Claude Habib. Rares sont, il est vrai, les chercheurs en sciences sociales qui s’aventurent sur le terrain d’une ethnologie de la susceptibilité. Et ceux qui le font encourent aussitôt les foudres du politiquement correct.
Un mot sur cette expression. Qu’est-ce que le « politiquement correct » ? C’est le conformisme idéologique de notre temps. La démocratie, en effet, produit du conformisme. Elle est indissolublement le régime de la liberté d’opinion et le régime de l’Opinion. Tocqueville a, le premier, mis en lumière cette ambiguïté constitutive : « Lorsque les conditions sont inégales et les hommes dissemblables, il y a quelques individus très éclairés, très savants, très puissants par leur intelligence et une multitude très ignorante et fort bornée. Les gens qui vivent dans les temps d’aristocratie sont donc naturellement portés à prendre pour guide de leurs opinions la raison supérieure d’un homme ou d’une classe, tandis qu’ils sont peu disposés à reconnaître l’infaillibilité de la masse. Le contraire arrive dans les siècles d’égalité. À mesure que les citoyens deviennent plus égaux et plus semblables, le penchant de chacun à croire aveuglément un certain homme ou une certaine classe diminue. La disposition à en croire la masse augmente et c’est de plus en plus l’opinion qui mène le monde. Non seulement l’opinion commune est le seul guide qui reste à la raison individuelle chez les peuples démocratiques ; mais elle a, chez ces peuples, une puissance infiniment plus grande que chez nul autre. Dans les temps d’égalité, les hommes n’ont aucune foi les uns dans les autres, à cause de leur similitude ; mais cette même similitude leur donne une confiance presque illimitée dans le jugement du public. Car il ne leur paraît pas vraisemblable que tous ayant des lumières pareilles, la vérité ne se rencontre pas du côté du plus grand nombre. » Ainsi, la liberté d’opinion conquise et promulguée par la démocratie doit sans cesse se défendre contre le pouvoir et même, dit Tocqueville, contre le despotisme de l’Opinion que la démocratie engendre. L’état social qui émancipe l’individu des anciennes tutelles lui fournit des opinions toutes faites et le décharge ainsi de l’obligation de s’en former qui lui soient propres. L’esprit humain, qui a vaincu la Transcendance et la Tradition, s’enchaîne ou risque de s’enchaîner étroitement aux volontés générales du grand nombre. Tocqueville ne se résigne pas à cette situation. Il aime trop la liberté pour préférer le pouvoir de tous au pouvoir d’un seul : « Quand je sens la main du pouvoir qui s’appesantit sur mon front, il m’importe peu de savoir qui m’opprime et je ne suis pas mieux disposé à passer ma tête dans le joug parce qu’un million de bras me le présentent. » On retrouve la même mise en garde, un siècle après Tocqueville, chez George Orwell, l’auteur de 1984 et de La Ferme des animaux : « Le remplacement d’une orthodoxie par une autre n’est pas nécessairement un progrès. Le véritable ennemi, c’est l’esprit réduit à l’état de gramophone et cela reste vrai que l’on soit d’accord ou non avec le disque qui passe à un certain moment. »
Mais le disque du politiquement correct ne fait pas entendre n’importe quelle chanson. Il met en musique le serment arraché à l’Occident par les grands traumatismes du XXe siècle : Plus jamais ça ! Plus jamais l’exclusion, la discrimination, la stigmatisation, le mépris de l’autre, le racisme. Et c’est pour ne pas tomber dans ces abominables écueils, pour ne pas faire sortir le génie de l’intolérance de la bouteille, que nous choisissons de passer certains faits sous silence, d’en minimiser la portée ou d’y voir une réponse au racisme de la société française. Nous ne venons pas au politiquement correct par contagion mimétique, par obéissance passive au discours dominant, mais par crainte du politiquement abject. Cette crainte est légitime. Cette crainte est honorable. Cette crainte est salutaire. Il ne faut jamais oublier que les dreyfusards étaient minoritaires dans la France de la fin du XIXe siècle. Qui nous dit que leur victoire est définitive ? Qui nous dit que, dans un contexte de crise économique, de désindustrialisation massive, de chômage chronique, de circulation affolante des marchandises, des capitaux et des personnes, les héritiers du dreyfusisme ne seront pas violemment balayés ? Qui nous dit que, faute de pouvoir agir sur les processus en cours, la majorité ne trouvera pas, dans la désignation de boucs émissaires, un exutoire à son angoisse et un moyen de refaire l’unité du corps social ? Non, nous ne sommes pas à l’abri d’une rechute. La cohésion peut à nouveau reposer sur le pire. Le sentiment d’être ensemble et de former, non pas un triste agrégat sans âme mais une communauté vivante, peut se reconstituer face à un Autre érigé en ennemi et accablé de toutes les tares. Bref, la vigilance s’impose car, selon la grande maxime brechtienne, « le ventre est encore fécond d’où est sortie la bête immonde ».
Mais la vigilance se contredit elle-même lorsqu’elle incite à l’aveuglement volontaire. Si nous voulons penser la crise du vivre-ensemble, et penser tout court, il nous faut desserrer l’étau de cette alternative fatale entre le déni et l’infamie, entre l’idéologie aveuglante et l’idéologie malfaisante, entre le politiquement correct et le politiquement abject. Lévi-Strauss, on l’a vu, peut nous y aider. « Le racisme est une doctrine qui prétend voir dans les caractères intellectuels et moraux attribués à un ensemble d’individus l’effet nécessaire d’un commun patrimoine génétique. On ne saurait ranger sous la même rubrique ou imputer automatiquement au même préjugé, l’attitude d’individus ou de groupes que leur fidélité à certaines valeurs rend totalement ou partiellement insensibles à d’autres valeurs. » La distinction est capitale et la disculpation salutaire parce que, comme le dit encore Lévi-Strauss, « en banalisant la notion de racisme, en l’appliquant à tort et à travers, on la vide de son contenu et on risque d’aboutir au résultat inverse à celui que l’on cherche ».
Pour autant, nous ne pouvons pas en rester à cette défense et illustration de la civilisation française. Nos propres passions, nos valeurs les plus chères, en effet, sont à l’œuvre dans l’inquiétante situation actuelle. Le malaise dans notre civilisation procède aussi de cette civilisation. C’est ce que je vais tâcher de montrer maintenant.
Les Grecs, qui sont bien plus nos ancêtres que les Gaulois, avaient un mot pour désigner ce que Kant appelle la « restriction de l’estime de soi-même ». Ce mot, c’est aidos. Aidos signifie « réserve » ou « pudeur ». Aristote disait que l’enfant, qui n’est pas spontanément logique, peut accéder au logos car il est, fort opportunément, doué d’aidos. « L’aidos, nous apprend Solange Vergnières, grande spécialiste de la pensée antique, n’est pas au sens strict une vertu (qui suppose un choix délibéré) mais une affection naturelle, intermédiaire entre la timidité et l’impudence qui sied aux enfants ou aux adolescents parce qu’elle manifeste leur noblesse ou leur humanité. L’enfant qui a le sens de la pudeur n’est pas seulement l’esclave de ses convoitises et de ses pères, il se situe dans l’orbe de la société des hommes, il est soucieux de l’image visible qu’il donne de lui-même, et c’est pourquoi il écoute ce qu’on lui dit. »
On trouve un équivalent religieux de l’aidos dans la pensée juive de l’étude. « Sans crainte, point de sagesse », disent les sages. Un grand talmudiste du début du XIXe siècle, Rabbi Haïm de Volozine, exhumé par Emmanuel Levinas, ajoute ce commentaire merveilleux : « L’écriture compare la Torah aux produits de la récolte, et la crainte de Dieu à une grange dans laquelle ces produits sont entassés et conservés. La crainte de Dieu est la grange dans laquelle la sagesse de la Torah se conserve. Si on ne prend pas soin au préalable de préparer la grange de la crainte, l’abondante moisson de la Torah gît à même le sol, exposée aux piétinements du bœuf et de l’âne et s’abîme. »
La modernité, qui se définit elle-même comme l’âge de l’audace − « Sapere aude, aie le courage de te servir de ton propre entendement », dit Kant − donne cependant une place à cette crainte ou, du moins, à son équivalent laïque sous la forme du respect de la culture. On aborde les œuvres de notre patrimoine avec timidité. Ces œuvres en imposent. Nos maîtres, nos pères, nos prédécesseurs la désignent à notre ferveur et nous leur faisons confiance. Qu’est-ce qu’un classique, en effet ? C’est un livre dont l’aura ne naît pas de la lecture mais la précède. Nous le lisons avec le sentiment que ce n’est pas nous qui le jugeons mais lui qui nous juge. Nous nous inclinons avant de céder à notre inclination. Nous admirons avant de comprendre et nous comprenons parce que nous admirons. L’a priori, en l’occurrence, ne nous aveugle pas, il nous éclaire. Ainsi s’opère la transmission de la culture, ainsi découvre-t-on l’Iliade, Bérénice ou Billy Budd.
L’aidos n’a pas disparu. La crainte laïque existe encore. Mais cet aidos, cette crainte, ne vont plus de soi. Une partie importante du nouveau public scolaire est même totalement dépourvue d’aidos. Tous les témoignages de professeurs parus ces dernières années font état de cette singulière disparition. Aymeric Patricot écrit, dans Autoportrait d’un professeur en territoire difficile : « Trente enfants qui ne craignent pas l’autorité parce qu’ils ne savent tout simplement pas ce que c’est, trente enfants dont le plus grand plaisir est la provocation, l’agressivité, le chahut, trente enfants dont l’un des buts affichés est de se » payer un prof » c’est-à-dire de l’envoyer en arrêt-maladie (expression que j’ai entendue dans la bouche d’élèves parmi les plus souriants et les plus innocents, sans doute conscients de la cruauté de leur réflexe mais surpris eux-mêmes par la facilité de la chose et par son impunité). Comment voulez-vous les tenir lorsqu’ils bavardent en chœur et qu’ils refusent de répondre aux injonctions, même discrètes, autrement que par des formules aussi lapidaires que » Lâche-moi ! » (pour les plus distinguées) ? » Je citerai aussi Tombeau pour le collège de Mara Goyet : « Parfois les cours ressemblent à des sortes d’orgies physiologiques. Manger, aller aux toilettes, prendre une sucette, aller à l’infirmerie, se balancer, être affalé sur sa chaise, renifler, tousser, bâiller, parfois péter, parler, parler, commenter : » Tiens un avion « , » oh j’ai plus d’encre « , » on a français à 14 h « , » où j’ai mis mon crayon ? « . Sentir, toucher : le corps, ce grand oublié des classes sagement assises et silencieuses, revient au galop. Cette propension à mâcher, sucer, cracher, déglutir, parler est terriblement troublante à observer. »[1. Mara Goyet, Tombeau pour le collège, Flammarion – Aymeric Patricot, Autoportrait d’un professeur en territoire difficile, Gallimard]
L’aidos s’efface et le corps s’affiche, s’étale, s’esclaffe. Voilà ce que des professeurs abasourdis observent. Ils constatent également qu’ils sont irrémédiablement seuls. Certes, l’institution s’inquiète du comportement immaîtrisable de ce nouveau public scolaire, mais elle reste tétanisée. Pire, elle scie avec application la branche déjà tremblante sur laquelle elle est précairement assise. Ces jeunes dont elle ne sait que faire et sur lesquels elle n’a pas de prise, c’est elle qui, dans un grand élan démocratique, les a dispensés d’aidos, en les accueillant comme des « jeunes », c’est-à-dire comme sujets déjà constitués, comme des personnes de plein droit, des individus à part entière, et en choisissant de composer avec la culture de leur classe d’âge. Dans les siècles d’égalité, comme dit Tocqueville, règne le signe égal et ce règne est sans partage. L’équivalence a universellement raison de l’éminence. Tout en vient à être mis sur le même plan, au même niveau. La culture n’est plus verticale mais horizontale. Elle n’est plus la culture mais les cultures. Elle n’est plus constituée des grandes œuvres de l’humanité, mais désigne désormais tout ce qui est sans exclusive. Il y avait le loisir et les loisirs, l’art et le divertissement, la culture et le reste. Ces distinctions sont perçues comme discriminatoires, attentatoires à la diversité des goûts, des pratiques, des comportements et des âges par l’esprit démocratique de notre temps. Il n’a donc besoin de personne pour démanteler « la grange de la crainte ». C’est de son fait que l’abondante moisson de la culture gît à même le sol. C’est de son fait que l’opposition fondatrice de l’humanisme européen entre l’ignorance et le logos s’estompe et se dissout dans le tout-culturel.
Cet esprit post-humaniste se veut plus humain que l’humanisme. À la place de l’ancienne, douloureuse et sélective élévation de l’inculture vers la culture, il brandit l’idéal de la reconnaissance universelle. La reconnaissance est son maître-mot, sa valeur suprême : pour être reconnues, les différences sortent du placard, les « prides » s’affichent et prolifèrent. Nous sommes entrés, comme l’a écrit Philippe Muray, dans « l’âge du fier ».
Ne nous moquons pas trop vite cependant. La reconnaissance des identités sexuelles, ethniques et religieuses est un immense progrès sur la méconnaissance ou la disqualification. Sur ce point, le politiquement correct a raison : il faut faire sa place au multiculturalisme. Mais peut-être pas toute la place. Au nom du respect des minorités, les universités américaines ont entrepris de réviser le canon des auteurs classiques. Il s’agissait de casser le monopole culturel des DWEMS, les « Dead White European Males », les Européens mâles, blancs et morts. Proust, Tchekhov, Hegel, Platon, étaient accusés de renvoyer à ceux et à celles qui n’étaient ni blancs ni hommes, ni vieux ni sages, une image dépréciative d’eux-mêmes. Comme si Proust, Tchekhov, Hegel et Platon, mais aussi Hannah Arendt ou Virginia Woolf, étaient l’image de qui que ce soit, comme s’ils ne nous renvoyaient pas d’abord à nos limites, à notre finitude, comme si leur génie ne nous infligeait pas, quelle que soit notre origine ou notre identité, une salutaire blessure narcissique, comme si enfin (je cite ici Léo Strauss), « l’éducation libérale, qui consiste en un commerce permanent avec les plus grands esprits » n’était pas « un entraînement à la modestie la plus haute pour ne pas dire à l’humilité ».
Mais qui parle encore d’humilité ? La place que Strauss, lointain héritier d’Aristote, assigne à la modestie, est aujourd’hui occupée par la « self-esteem ». L’aidos, désormais, se soigne sur le divan du psy. Notre société démocratique ne pense plus l’intersubjectivité que dans l’idiome de la reconnaissance. Elle table sur la reconnaissance mutuelle et égalitaire pour venir à bout de la violence. Elle exacerbe ainsi le phénomène en croyant y remédier. Elle flatte les susceptibilités ombrageuses. Elle prend, dans la guerre des respects, et sans en avoir clairement conscience, le parti anti-kantien de combattre toute forme de « restriction de l’estime de soi-même ».
Je disais en introduction que le changement n’est plus ce que nous faisons mais ce qui nous arrive et que ce qui nous arrive de plus inquiétant, c’est la crise du vivre-ensemble. Et puis j’ai découvert peu à peu que nous sommes impliqués dans ce qui nous arrive. Nous ne le voulons pas. Nous le déplorons. Mais nous y mettons du nôtre. Je dirai donc pour conclure que la démocratie a d’autant plus de mal à faire face à la crise du vivre-ensemble que cette crise n’est pas seulement une catastrophe qui lui tombe dessus, mais qu’elle est aussi et simultanément le produit inexorable de son évolution.
Fin[/access]
Cet article est issu de Causeur magazine n ° 41.
Pour acheter ce numéro, cliquez ici.
Pour s’abonner à Causeur, cliquez ici.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !