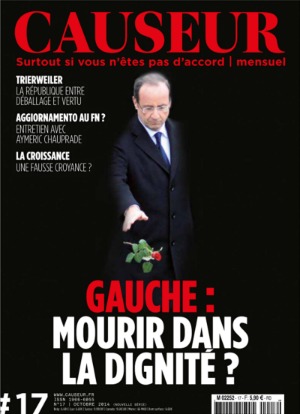Pas besoin d’avoir fait Woodstock, d’avoir les cheveux longs ou d’être mal rasé. Inutile, surtout, de se proclamer altermondialiste et de rêver un monde sans frontières. Disons qu’avoir un bon économe et une poêle à frire est votre mise de départ. Bienvenue chez les décroissants. Ceux que nous avons rencontrés l’ont dans la chair, la décroissance. Ils l’ont aussi dans leur potager – et dans leur assiette.
Catherine a 46 ans, elle est ce qu’on appelle une « amapienne ». En décroissant, cela signifie qu’elle est inscrite dans une Association pour le maintien d’une agriculture paysanne. Une AMAP. Tous les mardis soir, elle se rend au « panier vanvéen », dans les Hauts-de-Seine, avec quatre-vingts autres personnes. À 18 h 30, les amapiens se retroussent les manches et se répartissent des paniers de légumes pleins à craquer. Pour 18 euros, ils mangeront pour quatre. Toute la semaine. Mais parce que les aubergines ne poussent pas sur le parking du Leclerc, où ils se sont installés, il a fallu trouver un agriculteur qui gère une plantation. Leur plantation, même. Car c’est un peu le principe de l’AMAP : le partage, la collectivité.
Pour Catherine, cette sorte de coopérative citadine est une évidence. Depuis six ans qu’elle fréquente le panier vanvéen, elle a réduit considérablement ses frais d’alimentation. Pour les prix, pas besoin de Leader Price, l’AMAP revient moins cher. Pour le bio, oubliez la Biocoop et les fraises espagnoles. Les légumes de Catherine viennent de Boissy-sous-Saint-Yon, à moins d’une heure de Paris. Dans le Lot, où elle retape une maison depuis trente ans, selon elle les gens ne se posent pas ce genre de question. Par un faux paradoxe, c’est à la campagne que la conscience écologique reste minoritaire. Finalement, avoue Catherine, « j’ai constaté qu’on mangeait mieux à Paris que dans le Lot ». La grande distribution fait l’affaire, et tant pis si les fermes du Périgord disparaissent une à une. Les grands champs de maïs et les exploitations dévolues au foie gras prospèrent. Le bio, elle est pour, mais selon la façon dont on le pratique : elle observe des agriculteurs qui font maintenant du bio intensif, sorte de contradiction dans les termes. « Toujours cette idée d’optimiser au maximum », relève-t-elle, pensive. Catherine a toujours été, depuis ses 18 ans, « babacool ». Elle a vécu en communauté près de Nîmes dans les années 1970, elle s’habillait aux puces, a toujours fait les brocantes, les vide-greniers, et a une bagnole d’occasion. « Bref, dit-elle, décroissante avant que le mot existe. »[access capability= »lire_inedits »]
Nous sommes en 2014. Toute l’Île-de-France est occupée par la grande distribution et l’exploitation intensive. Toute ? Non ! Dans sa ferme à Boissy-sous-Saint-Yon, Laurent Marbot est l’agriculteur qui nourrit Catherine et les banlieusards du plateau de Vanves : avec Jérôme, fils d’un céréalier de la Beauce, il partage 3 hectares de terrain. Ils pratiquent tous deux le maraîchage biologique dans six serres. Mais contrairement à son associé, qui vend sa production dans une boutique sur place, Laurent a décidé de fonder cette AMAP et s’en porte on ne peut mieux.
Ce dimanche matin, dans sa ferme de l’Essonne, Laurent Marbot désherbe parmi les rangées de betteraves. Pour l’aider, une dizaine d’« amapiens », parmi lesquels on trouve des vieux, des cadres de chez Dassault Aviation, des éducateurs soixante-huitards, des enfants courant après des chiens. Chacun est venu désherber sa ligne de soixante mètres, plus ou moins consciencieusement. Entre chaque pousse, Laurent Marbot commente : « Ça, c’est du liseron, on arrache ! Ça étouffe les racines de betteraves. On est les seuls à en avoir de ces trucs-là. » « On », ce sont les maraîchers bio. Que font dix citadins dans une ferme biologique à gratter la terre ? « Un atelier pédagogique », répond François, ironique. Chacun sourit dans sa barbe. « Atelier pédagogique », pour l’État, ça sonne meilleur – parce que c’est plus vérifiable – que « coup de main ». Entre deux sorties d’experts ès arrachage de mauvaises herbes, Laurent a le temps de se définir comme « plutôt de gauche ». Il y a encore quelques années, nous confie-t-il, il défilait dans les manifs de la CGT. Et puis le grand rêve d’égalité est retombé comme un soufflet au fromage. Avec l’âge, ce Parisien s’est incarné : « Faire pousser des légumes, c’est bien plus subversif que d’aller gueuler dans les manifs », décoche-t-il. L’Internationale ? Disons que, chez lui, elle commence par du local. Là, à Boissy-sous-Saint-Yon.
Il y a dix ans, Laurent était voué à vendre des pesticides. Dans le milieu agricole, le choix est restreint. Si vous n’êtes pas fils de paysans, vous ne verrez jamais le début d’une roue de tracteur, nous explique le maraîcher. Et puis, un matin, Jérôme, son ami agriculteur, l’appelle : « Laurent, j’ai un plan. Quand-est-ce qu’on fait la révolution ? » Quelques années plus tard, le concept est lissé. Les paniers que livre Laurent ont la réputation d’être particulièrement garnis. Et parce qu’il refuse de cultiver plus – il le pourrait, sous la pression de l’idéologie productiviste – la qualité des relations qu’il entretient avec ses amapiens reste authentique. Le rêve de Laurent serait de partager des grandes parcelles avec de nombreux associés, qu’il n’y ait pas de patron, qu’on établisse une vraie coopérative.
Pour autant, on aurait tort de prendre les amapiens pour de gentils rêveurs. Ce serait même le contraire. Là où le bobo, depuis quinze ans, a fait son miel du bio, qui convient autant à son portefeuille qu’à sa soif de confort matériel et intellectuel, l’AMAP est un rappel constant de nos limites : le consommateur paie à l’avance et pour un an la production à venir du paysan et subit les aléas climatiques autant que la saisonnalité des fruits et légumes. C’est le choix de n’avoir plus le choix.
Décroître comme consommateur, c’est croître en sagesse, selon Anne, qui habite Amette, petite commune du Pas-de-Calais dont le seul titre de gloire est d’avoir vu naître, comme par hasard, Benoît-Joseph Labre, le saint clochard du XVIIIe siècle, gyrovague dont les rombières du premier rang de la messe s’écartaient en se bouchant le nez tant, selon la légende, il puait. Saint patron idéal, quoiqu’un peu outré, pour tous les décroissants du monde. Anne est une « chrétienne indignée », c’est-à-dire qu’elle fait partie de ceux qui prônent la décroissance matérielle comme conséquence d’une humilité et d’un dépouillement spirituel. Elle ne vit certes pas dans un ashram, mais elle parle de « cette libération progressive de nos asservissements, des plus manifestes aux plus subtils, à la société de consommation ». Se dégager de cette accumulation de futurs déchets, marqués du virus de l’obsolescence, elle ne l’appelle pas mépris de la matière, mais au contraire goût des créations, des fruits de la terre et du travail des hommes. Elle égrène : « Légumes du maraîcher de mon pays, pain du boulanger tôt levé, ouvrage du cordonnier à l’atelier fleurant le cuir, de la couturière dans son champ d’étoffes colorées. » Finalement, sa décroissance ressortirait plus de l’épicurisme que du jansénisme ; aller à pied ou à vélo, choisir ses vêtements à Emmaüs, inventer une nouvelle vie à un objet usagé : « J’aime, comme l’enfant qui fait un pied-de-nez à une armée d’empire totalitaire, ces gestes dérisoires qui libèrent l’âme de la peur et nous relient à l’essentiel. Et j’ai folie de croire que la vie est un enfant qui peut mettre en déroute l’armée la plus puissante. »[/access]
*Photo : Hannah.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !