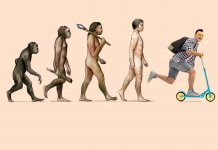On ne sait ce qu’il faut admirer le plus dans En pays défait, la « lettre ouverte » adressée par l’essayiste et romancier Pierre Mari à ceux de ses contemporains capables de l’entendre : l’élégance impeccable de la langue, épousant au plus près le frémissement d’une pensée que n’a pas désertée la vie ?
La sincérité poignante d’un homme, accablé mais dénué de ressentiment en dépit de la colère qui l’habite ? Ou la lucidité blessée d’un regard, démasquant les « forces de dépossession » partout à l’œuvre en France mais nimbé de la douceur propre aux désespoirs pleinement assumés ? Fustigeant tous les « importants » dont l’excès de visibilité ne parvient plus à masquer l’inconsistance, cette harangue démontre en tout cas qu’il est un courage propre à l’intelligence lorsqu’elle ne se met pas au service de « l’énormité irrespirable qui nous oppresse depuis une bonne trentaine d’années ».
La croyance dominante est inhabitable, l’incroyance personnelle est sans feu ni lieu. La plupart des hommes de ce temps sont ainsi rejetés d’une impossibilité à une autre : ils ne peuvent pas plus se fixer dans le credo général qu’ils ne parviennent à fixer l’expression de leur mécréance
Peu soucieux d’établir la généalogie du désastre qu’il décrit, Pierre Mari situe néanmoins le virage fatal dans les années 1980 qui virent l’installation durable du grand Sphinx aux commandes de l’État français. Mais comment identifier cette « énormité » dès lors qu’elle est moins une idéologie comme le furent stalinisme, national-socialisme et maoïsme, qu’une allégeance servile à ce qui défigure notre pays ?
La béance du monde
Né en Algérie, Pierre Mari dit se sentir « français avec acharnement » ; et l’on pense souvent, le lisant, à l’attachement non moins charnel d’Albert Camus à la langue française et à sa terre d’origine. Pour l’un comme pour l’autre un « pays » est bien davantage qu’une délimitation territoriale et une résidence administrative. On ne dira donc jamais assez, et Mari le dit avec énergie, combien l’abaissement de son propre pays affecte d’abord le cœur de qui le vit de plein fouet. C’est aussi pourquoi En pays défait est plus proche du manifeste de Botho Strauss Soulèvement contre le monde secondaire (1996) que du Déclin de l’Occident d’Oswald Spengler (1917) ou même du nostalgique récit autobiographique de Stephan Zweig Le Monde d’hier (1941). Conscient d’avoir lui aussi une part de responsabilité pour avoir délégué son pouvoir à ceux qui en ont mésusé, Pierre Mari n’ignore pas pour autant la crise de civilisation majeure secouant l’Europe, ni la béance d’un monde désormais largement ouvert à la mondialisation. Ce ne sont pourtant pas les fameuses « questions de société » qui retiennent son attention (chômage, immigration, insécurité, homoparentalité), mais les motifs profonds de l’affaissement moral d’un pays comme la France dont l’histoire, la culture, auraient dû faire un modèle d’intégrité intellectuelle et spirituelle.
Que nos défaites étaient belles…
On sent cependant Pierre Mari moins désireux d’imposer ses raisons que de ne pas faillir à sa tâche d’écrivain en tentant de « faire tenir debout son humanité » à contre-courant du mainstream ambiant. Car ce qui jour après jour se défait, ou se contrefait, ne peut même plus être vécu comme une défaite, supposant qu’il y eut affrontement. Défaite est un mot trop empreint de logique guerrière pour décrire avec justesse le rapport tragique à ce qui se délite et s’effrite du fait de trop de lâchetés, compromissions et démissions. Plus proche de la poétique des ruines que du lyrisme des catastrophes, cette méditation qu’inspire une sensibilité à vif met au jour un terrain de toutes parts miné, embourbé, souillé d’insanités verbeuses et prétentieuses oblitérant la réalité vécue par la plupart des « invisibles ». Mais peut-on se dire comme Pierre Mari « ennemi » de ce qui ruine tout face-à-face loyal sans réintroduire un imaginaire que cet état des lieux répudie ? Exilé, plutôt, et c’est le sentiment qui prédomine dans cet écrit même si les mots souvent employés (imposture, inauthenticité, infamie) restent ceux du combat frontal dirigé en tout premier lieu contre la médiocrité opportuniste qui se livre sans vergogne à un « gâchage intéressé de son propre fonds».
Une sensibilité toujours en éveil
Les coups néanmoins portent juste, et presque rien du « devenir calamiteux de cette société » n’échappe au narrateur dont les cibles sont si nombreuses qu’on s’épuiserait à les dénombrer, et les formulations souvent si percutantes qu’on pourrait être tenté de les paraphraser : « La croyance dominante est inhabitable, l’incroyance personnelle est sans feu ni lieu. La plupart des hommes de ce temps sont ainsi rejetés d’une impossibilité à une autre : ils ne peuvent pas plus se fixer dans le credo général qu’ils ne parviennent à fixer l’expression de leur mécréance. » L’originalité du propos tient pourtant moins à la nouveauté radicale des analyses qu’à l’acuité d’une sensibilité constamment en éveil et à l’ampleur d’un regard capables de recréer l’unité d’une vision là où l’on est porté à ne voir que reniement et falsification : « dévoiements de la renommée » que rien ne vient plus corriger, mépris pour l’excellence, irresponsabilité professionnelle et « novlangue en état d’ébriété », marketing de soi au détriment d’une « tenue de vie » personnelle, anesthésie de la sensibilité au profit d’émois grégaires, dégradation de l’imaginaire collectif et défiguration de la langue…
D’autres voix lui répondent
Mais Pierre Mari n’est-il pas moins seul dans son exil qu’il le dit ? Adossé à la tradition littéraire française où il a pris racine, l’écrivain qu’il est contribue à restaurer ce qu’il reproche aux « roués d’aujourd’hui » d’avoir souillé ou détruit en se ralliant « à toutes les formes d’occupation, à tous les saccages matériels ou intellectuels, dès lors qu’ils s’affublaient des nippes du progressisme et de la modernité. » À l’écouter parler, raconter, ce sont d’autres voix qui s’élèvent et font écho à ses propos, comme si tout écrivain authentique n’était solitaire qu’afin de libérer l’espace où le for intérieur de chacun pourra un jour s’inscrire dans le tissu cohérent et vivant d’une « communauté de rectitude » encore à venir. Saurait-on mieux définir la culture dès lors qu’on ne la réduit pas à « une bigoterie citoyenne décérébrée, ouverte sur le grand large planétaire » ? Écrite par un homme de culture, cette « lettre ouverte » ne pouvait que porter les traces de questionnements plus anciens qui font partie intégrante du patrimoine culturel français et européen.
Qui a par exemple, plus que Nietzsche, déplore l’appauvrissement des « attitudes vivifiantes » aujourd’hui défaillantes, et le « manque d’affirmation de soi et de vitalité » sévissant en France ? N’est-ce pas la voix de Heidegger dénonçant la tyrannie du « On » qu’on entend résonner quand le bavardage médiatique s’enlise dans des « palabres sans terreau ni racines » ? Qui ne reconnaîtrait dans la parade des valeurs « sur fond d’autodévaluation accélérée du pays », le dernier rebondissement de la crise du nihilisme qui n’en finit pas de gangrener les esprits ? Quant à la rupture de « l’élan narratif » interdisant à la société française de se situer dans la continuité de son histoire et de sa culture, la postmodernité n’a-t-elle pas fait ses lettres de noblesse de l’abandon des « grands récits » ? Et s’il est vrai que la « logorrhée relationnelle » omniprésente sature l’espace intérieur et empêche ainsi l’individu d’accéder à son propre fonds, Pierre Mari adopte spontanément l’attitude qui fut celle de Rilke conseillant à son jeune interlocuteur de rechercher en soi le centre de gravité qui a seul valeur de Loi (Lettres à un jeune poète, 1929). C’est à Artaud enfin qu’on pense quand Mari met en garde contre « la force d’envoûtement de ces discours métallisés et infroissables », et à Baudrillard bien sûr lorsqu’il s’en prend au « grand règne des simulacres ».
Poésie du chagrin
Si cette « lettre ouverte » touche au cœur le lecteur, c’est que le chagrin avoué de l’auteur s’inscrit aussi dans un paysage culturel où la voix des uns répond encore à celle des autres, et qu’à travers colères et dégoûts transparaît malgré tout ce que Rilke nommait « la mélodie des choses»[tooltips content= »Rainer Maria Rilke, Notes sur la mélodie des choses (1898), trad. Bernard Pautrat, Paris, Éditions Allia, 2008. »]1[/tooltips] ; une mélodie infiniment plus profonde et durable que le brouhaha qu’on nous impose car y redevient perceptible « le fond palpitant, enchevêtré et désarmé du langage». Une poétique reste ainsi à l’œuvre derrière l’insanité d’un monde qui se défait mais dont la chaîne, tendue à craquer, laisse parfois entrevoir le maillage d’une trame intemporelle et indéfectible faite de « discrétion préservatrice » et de « maturation solitaire ». Haletant mais sobre, ce texte doit être lu d’une traite afin de n’en pas morceler la coulée ni laisser retomber l’élan. Et puisque l’auteur, renonçant à spéculer sur « une révolte prochaine des accablés », dit rêver de voir à nouveau chaque être humain « souffler sur ses propres braises », sachons-lui gré d’avoir su préserver l’étincelle permettant à chaque existence de redevenir si elle le veut un « foyer de sérieux », fût-il sans éclat apparent.
Pierre Mari, En pays défait, Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2019.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !