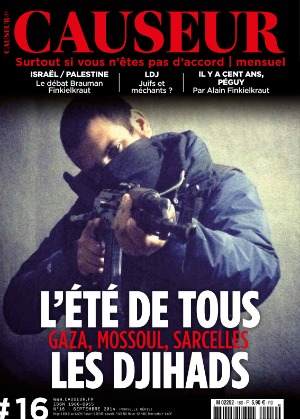Il n’y a pas de Grand Siècle français sans Pascal, c’est une évidence. Mais le souffreteux et teigneux génie amoureux de Jésus a eu tendance à trépasser dans la mémoire historique et culturelle française, ne laissant derrière lui qu’un antique billet de banque – que l’on rêvait tous de posséder petits, non tant pour la promesse de fortune qu’il annonçait mais pour sa texture soyeuse, sa taille disproportionnée et sa couleur indéfinissable –, une mesure de pression atmosphérique et un pari bien galvaudé. C’est le premier aveu de Xavier Patier dans sa Nuit de l’extase : arrivé à l’âge d’homme, quoique catholique, écrivain et éditeur, il en savait si peu sur l’insolent Blaise que, dans un mouvement de retrait du monde, délaissant carrière, honneurs et autres instruments électroniques, c’est dans le gouffre des Messieurs de Port-Royal et de leur plus illustre pensionnaire qu’il est tombé. Il en est ressorti illuminé par le Mémorial comme s’il en eût jusqu’ici ignoré la saveur. C’est autour de celui-ci qu’il bâtit entièrement son livre, autour de ce fameux texte de la nuit du 23 novembre 1654 que l’on découvrit cousu dans le pourpoint même de Pascal à sa mort, où sont les mots trop célèbres « Joye, joye et pleurs de joye ». Où le philosophe et mathématicien surdoué, à peine âgé de trente ans, délaisse enfin sa morgue d’être supérieur pour s’abandonner à la simple condition humaine devant son Créateur.[access capability= »lire_inedits »]
L’auteur promène donc son lecteur, avec une délicieuse légèreté, celle qu’on acquiert nécessairement devant le mystère, dans la vie d’un siècle où s’entrechoquent les découvertes de la science, mathématiques et physiques principalement, et la plus profonde piété, du cardinal de Bérulle à Fénelon, en passant par Bossuet et Vincent de Paul, sans qu’à l’encontre de nos croyances contemporaines rien ne vînt troubler l’égalité de la foi et de la dévotion. Seules les attirances mondaines, habituelles à tous les temps, arrachent parfois les « libertins » au sûr chemin de leur salut éternel. Succédant au siècle des guerres, et quelles guerres, civiles parce que religieuses, ou l’inverse, le XVIIe français surmonte la Fronde puis les expéditions extérieures et répétées du Roi-Soleil avec longanimité. En apparence, du moins, parce que dans l’intérieur des âmes, ou des Sorbonnes, de non moindres conflits brûlent sous la cendre.
L’irrésistible ascension de la Compagnie de Jésus, née à peine cent ans plus tôt, a excité les jalousies de ses adversaires comme l’orgueil de ses membres. Les soldats du Christ, perinde ac cadaver, qui ont déjà évangélisé la moitié du monde et fourni aux papes une nouvelle élite, tel le cardinal Bellarmin, tiennent une forme de théologie qui, pas moins juste et pas moins erronée que la pensée janséniste, va s’affronter férocement avec elle.
Xavier Patier, avec sans doute l’ardeur du nouveau converti, s’abandonne lui aussi, derrière le merveilleux tableau de l’époque qu’il dresse, à la coutume historiquement et intellectuellement pesante qui consiste à ne voir en un siècle si complexe et si tiraillé qu’une voie lumineuse et glorieuse, celle de ces jansénistes dont, parce qu’ils surent manier la langue avec une habileté sans pareille, on déduit qu’ils avaient reçu, et seuls, le dépôt sacré de la civilisation. Attribuer comme il le fait aux méchants jésuites – ces incultes qui les premiers, par exemple, entrèrent en Chine pour y conseiller l’empereur – la condamnation de Galilée, c’est reprendre une fort vieille thèse de longtemps controuvée. Ajouter qu’« il suffisait d’un peu de science pour savoir que Galilée disait vrai », c’est prendre des chemins de traverse un peu risqués, en oubliant que le système copernicien, jusqu’au début du XIXe siècle, sera resté une hypothèse intellectuelle qu’on ne pouvait positivement prouver.
Bref, quand Pascal, et avec lui le siècle qu’il fuyait, s’y précipite, le choc entre molinistes[1. Disciples du jésuite espagnol Luis de Molina] et jansénistes est frontal. Querelle de sorbonnards, dira le chaland. Voire. Toute politique européenne est fille d’une hérésie chrétienne, aurait pu dire Chesterton. En réalité, de même que Descartes est l’héritier d’une scolastique dégénérée, ainsi que l’a montré Étienne Gilson, les forces théologiennes en présence sont les filles mal nées d’un débat sur les rapports de la grâce et du libre-arbitre qui parcourt l’Occident (et même le monde musulman, à travers Avicenne notamment) depuis saint Augustin et dont la solution n’a pas été vraiment trouvée. Ou plutôt a été oubliée, puisqu’elle est déjà, comme d’habitude, chez Thomas d’Aquin[2. « Après le péché, l’homme a besoin de la grâce pour plus de choses qu’avant, mais il n’en a pas davantage besoin. »] , qu’aucun contemporain libéré ne se soucie de lire. Alors que, quoi qu’il en pense, il est aussi le fruit de cette controverse où à la natura pura des jésuites, c’est-à-dire à cette conception moderne d’un homme qui pourrait trouver la béatitude dans une fin naturelle, les jansénistes opposèrent cet autre homme, qui finalement lui ressemble étrangement, entièrement déchu, qui sans la grâce ne peut ni ne veut rien de grand. Ainsi, ces « théologies séparées » précédèrent les philosophies séparées du monde moderne, où la question surnaturelle est, pour la première fois dans l’histoire humaine peut-être, rejetée dans les ténèbres extérieures de la foi, hobby de quelques pâles séminaristes rongeant leur inquiétude existentielle dans les couloirs de la Catho.
Voltaire et nombre de ses compagnons des Lumières ne s’y trompèrent pas, qui virent dans les jansénistes leurs borgnes prédécesseurs, premiers sapeurs des fondations du monde chrétien. Le Grand Siècle, avec Pascal, discourait de la grandeur de l’homme devant Dieu, il ignorait qu’après lui, mais par lui, on ne causerait plus que de la grandeur de l’homme sans Dieu.[/access]
Blaise Pascal – La nuit de l’extase, de Xavier Patier, Cerf, 2014.
* Photo : wikicommons
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !