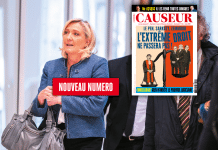Mais l’écrivain redoute sa disparition sous les coups de boutoir du militantisme.
« Vivre avec le mal, le dévoiler, pénétrer dans sa grotte, c’est la mission de la littérature », affirme Patrice Jean dans Kafka au candy-shop, la littérature face au militantisme, paru aux éditions Léo Scheer. L’auteur de L’homme surnuméraire et de Tour d’ivoire observe que la littérature et en particulier l’art romanesque sont menacés de disparaître sous les coups du militantisme politique, du relativisme culturel et des sciences humaines, toutes choses qui, selon lui, nuisent à la qualité d’une littérature contemporaine de plus en plus éloignée de l’idée de péché originel : « Croire au péché originel n’est pas, comme on dit, un dogme négociable. La littérature qui ne croit pas à ce péché est une littérature pour l’école et pour le divertissement. […] Sans suffocation, sans conflit insoluble, sans la chute, pas de littérature. » Les « anges intraitables » du progressisme ne concevant pas le monde autrement que débarrassé de cette malédiction originelle, ils n’attendent de la littérature qu’un « message positif, avec du sucre dedans ». Comme l’écrivait Philippe Muray, qui consacra de nombreuses pages à ce sujet : « Sitôt le péché originel éradiqué des consciences (qui d’ailleurs, et par la même occasion, ne sont plus à proprement parler des consciences), le Bien commence à faire des siennes. » Partout, y compris en littérature. Adieu Flaubert, bonjour Bobin.
L’art littéraire devenu inutile
Le militant progressiste, écrivain ou lecteur, pense qu’il est possible, et même qu’il est souhaitable, d’éradiquer le Mal. Négligeant « la vie intérieure de l’individu », il ne le conçoit que politiquement ou socialement et ne le décèle que dans le capitalisme, les frontières, le patriarcat, les nations, les mâles, etc. ; il s’imagine qu’il suffira d’un tract vindicatif ou d’un éclat de voix dans un mégaphone pour le faire rentrer dans son terrier. Ses livres préférés sont ceux qui, nappés d’une épaisse moraline, dénoncent le racisme, le sexisme, les inégalités sociales ou