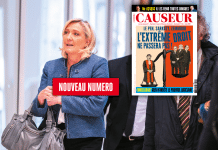3 février 2013 : Les nouvelles fractures françaises
Élisabeth Lévy. Fin janvier, Le Monde publiait l’une de ses enquêtes mesurant la progression des idées mauvaises. Fruit d’une collaboration entre le Cevipof et la Sofres, « Les nouvelles fractures françaises » dessine une France de plus en plus crispée et populiste. Qu’on en juge : 62 % des personnes interrogées pensent que la mondialisation est une menace, 70% qu’il y a trop d’étrangers, 74% que l’islam est une religion incompatible avec les valeurs de la République (25 % pour la religion juive) et enfin -résultat très commenté -, 86 % veulent un chef pour restaurer l’autorité. Bref, les Français n’aiment rien de ce qui est moderne et bon pour la santé. La France a-t-elle peur, et a-t-elle des raisons d’avoir peur ?
Alain Finkielkraut. Les journalistes, les sociologues et les historiens se penchent sur l’humeur des Français sans jamais envisager l’hypothèse que cette humeur puisse être une forme de dévoilement de la réalité. Ce sondage est donc une auscultation. Il nous livre un diagnostic sur les Français. Tout le monde est d’accord pour ne pas accorder la moindre parcelle de vérité au diagnostic des Français eux-mêmes. On leur retire l’attribut de l’objectivité. Il y a d’un côté l’expertise qui est objective et, de l’autre côté, l’expérience qui est subjective. Et pas seulement subjective : pathologique. La France va mal, c’est un grand corps malade. Elle est décliniste, elle est pessimiste, elle est crispée et dangereusement xénophobe puisque 70 % des Français pensent qu’il y a trop d’étrangers en France et 62 % que « l’on ne se sent plus chez soi comme avant ». Qu’est-ce que cela veut dire, « ne plus se sentir chez soi comme avant » ?
Dans son livre Voyages en France, le journaliste Éric Dupin fait état du « sentiment un peu pesant de parcourir un territoire presque exclusivement arabe », lorsqu’il traverse les quartiers nord de Tourcoing. Ce n’est pas la peur de l’autre qui ici s’exprime, c’est la stupeur d’être soi-même l’autre, l’étranger.[access capability= »lire_inedits »] Cette stupeur n’est pas coupable. Michel Winock, dans Le Monde, fait la comparaison avec les mouvements populistes des années 1930. Pierre Rosanvallon, dans La Société des égaux, évoque le pamphlet de Barrès Contre les étrangers. De telles analogies historiques ne sont pas éclairantes mais égarantes. Elles oublient, en appliquant le devoir de mémoire, que le présent, c’est, comme le disait Valéry, « l’état des choses en tant qu’il ne s’est jamais présenté ». On répète à juste titre la phrase du philosophe américain George Santayana : « Une civilisation qui oublie son passé est condamnée à le revivre ». Mais il faut aujourd’hui en ajouter une autre : une civilisation qui laisse le passé s’incruster au cœur du présent court le risque de ne pas savoir faire face à ce qui lui arrive. Et ce qui arrive, c’est une crise peut-être irrémédiable de l’intégration.
17 février 2013 : La renonciation du pape Benoît XVI
Le lundi 11 février, en fin de matinée, on apprenait que le pape Benoît XVI, qui avait succédé à Jean Paul II en 2004, quitterait ses fonctions le 28 février. Cette décision, qui semble arracher l’église au droit divin pour la faire entrer dans le pragmatisme démocratique, a été largement saluée, comme si elle constituait, finalement, la plus grande réalisation de son pontificat.
Même ceux, très nombreux, qui n’aiment pas Benoît XVI, et qui ne se gênent pas pour le faire savoir, ont salué son geste. Et pour bien montrer à quel point ils apprécient ce geste, ils l’ont qualifié de « moderne ». Le parangon d’archaïsme qu’est Benoît XVI aurait rejoint, in extremis, l’humanité digne de ce nom ; car, pour un moderne authentiquement moderne, il n’y a de vrai, de beau et de bien que ce qui est moderne. Moderne est le compliment suprême ; les modernes félicitent donc le souverain pontife pour sa démission. Mais précisément, le pape est un souverain, et un souverain ne démissionne pas. Il abdique ou il renonce. Ce qui était frappant dans le geste de Benoît XVI, ce n’est pas sa modernité, c’est sa majesté.
Il a dit, dans cette langue éminemment moderne qu’est le latin : « Je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l’avancement de mon âge, ne me permettent plus d’exercer adéquatement le ministère pétrinien. Cependant, dans le monde d’aujourd’hui, sujet à de rapides changements et agité par des questions de grande importance pour la vie de la foi, pour gouverner la barque de saint Pierre et annoncer l’Évangile, la vigueur du corps et de l’esprit est aussi nécessaire, vigueur qui, ces derniers mois, s’est amoindrie en moi d’une telle manière que je dois reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m’a été confié ». Ces paroles admirables ne ressemblent pas à ce que pourraient dire un cadre dirigeant ou un haut fonctionnaire atteints par la limite d’âge. Ces paroles évoquent le discours qu’a prononcé l’empereur Charles Quint le 25 octobre 1555 dans son palais à Bruxelles : « Je me sens maintenant si fatigué que je ne saurais vous être d’aucun secours, comme vous le voyez vous-même. Épuisé et brisé comme je le suis, j’aurais des comptes à rendre à Dieu et aux hommes si je ne renonçais à gouverner ». L’abdication de Charles Quint a bouleversé l’Occident. Montaigne a écrit : « La plus belle des actions de l’empereur Charles cinquième fut celle-là, […] d’avoir su reconnaître que la raison nous commande assez de nous dépouiller, quand nos robes nous chargent et empêchent ; et de nous coucher quand les jambes nous faillent ». Benoît XVI ne règne pas comme régnait Charles Quint : ce n’est pas un souverain temporel, mais il renoue, par cet acte inouï, avec cette modalité fascinante du pouvoir qu’est, selon Jacques Le Brun, le pouvoir d’abdiquer. Et ce faisant, il a choisi de ne pas rééditer la folle imitation de l’agonie du Christ qu’a été le long calvaire de son prédécesseur… Lui qui n’aimait pas la représentation, lui qui avait demandé à Dieu, lors du conclave, de lui éviter la « guillotine » de son élection, lui qui avait dit, une fois élu « Priez pour moi, pour que je ne fuie pas devant les loups » et qui avait tenu tête, il a décidé de se retirer du monde des apparences. Ce n’était ni normal ni moderne, c’était un adieu à la modernité. Il est vrai que les loups ne l’ont pas épargné, ce théologien, cet intellectuel, cette non-star irrémédiable. Dans sa magnifique conférence de Ratisbonne, il rappelle que l’Europe est née de la concordance entre le questionnement grec et la foi biblique qui dit : au commencement est le logos. Or, une double réduction est à l’œuvre aujourd’hui : la Bible devient un message moral, philanthropique, et la raison, méthode. Benoît XVI s’inquiète de voir les grandes interrogations humaines exclues de la raison commune et renvoyées au domaine de la subjectivité. Il ne défend pas la foi contre le rationalisme, il plaide pour ce qu’il appelle le « grand logos » et il cite cette phrase extraordinaire de Socrate dans le Phédon : « On comprendrait aisément que par dépit devant tant de choses fausses, quelqu’un en vienne à haïr et à mépriser tous les discours sur l’Être pour le reste de sa vie. Mais de cette façon, il se priverait de la vérité de l’Être et pâtirait d’un grand dommage ». Ce dommage est ce dont pâtit une Europe oublieuse de son histoire et devenue, hormis pour ce qui concerne la science, subjectiviste et relativiste. Mais rien de cela n’a compté. Le monde n’a retenu que l’introduction, c’est-à- dire le dialogue entre l’empereur Manuel Paléologue II et un interlocuteur persan. La scène se passe pendant le siège de Constantinople à la fin du XIVe siècle. L’empereur aborde le thème du djihad, il refuse d’accorder le moindre crédit à la religion de Mahomet car, dit-il, celui-ci a prescrit de répandre par l’épée la foi qu’il prônait. La diffusion de la foi par la violence est contraire à la raison, dit l’empereur, et ne pas agir selon la raison est contraire à la nature de Dieu. C’est là que la conférence prend son essor et que commence la critique d’une Europe qui ne sait plus ce qu’est le « grand logos ». Cette critique n’a pas été entendue. L’Europe a dénoncé les propos islamophobes du pape.
Et partout dans le monde, des musulmans ont protesté de leur non-violence par des manifestations violentes. Mais peut-être les avertissements de Benoît XVI auraient-ils été mieux entendus s’il avait défendu, sur les questions de mœurs, des positions moins bêtement rigides.
Reste l’affaire de la canonisation de Pie XII, le « pape du silence », qui a évidemment beaucoup ému la communauté juive et les Israéliens.
Il faut d’abord prendre acte de ce travail sur soi qui a été accompli par l’Église depuis Vatican II. Dans la tradition patristique, le peuple juif était déchu et l’Église était le verus Israël. « Ils sont témoins de leur iniquité et de notre vérité », disait saint Augustin. Maintenant, c’est-à-dire après la Shoah, l’Église déclare que l’ancienne Alliance n’a pas été révoquée et que le judaïsme est une réalité vivante à travers le temps. Ainsi, dans son livre Jésus de Nazareth, Joseph Ratzinger cite-t-il à plusieurs reprises l’ouvrage de Jacob Neusner Un rabbin parle avec Jésus. Neusner s’imagine au pied de la montagne, il entend les enseignements de Jésus, mais il y a en lui quelque chose qui résiste. « Qui aime son père et sa mère plus que moi n’est pas digne de moi », affirme Jésus. Et le rabbin Neusner répond qu’abandonner son père et sa mère, ses frères et ses sœurs, sa femme et ses enfants, c’est mettre en péril la survie d’Israël. Un Juif est un fils. Ratzinger n’est pas convaincu par les objections du rabbin, mais il écrit : « Globalement la Chrétienté ferait bien de considérer avec respect cette obéissance d’Israëlet de prendre ainsi la mesure des grands impératifs du Décalogue, qu’elle doit retranscrire dans l’espace de la famille universelle ».
Reste, bien sûr, le processus de béatification de Pie XII entamé par Jean Paul II et poursuivi par son successeur. Pour eux comme pour un certain nombre de chercheurs de l’Église, la retenue du pape pendant la Deuxième Guerre mondiale était tout le contraire d’une indifférence à l’égard des victimes. Tandis qu’il donnait au public l’apparence du silence, la secrétairerie d’État, la nonciature, notamment en Slovaquie, en Croatie, en Roumanie et en Hongrie, harcelaient les gouvernements et les épiscopats afin de susciter un acte de secours. Ce plaidoyer n’est pas convaincant. Si Pie XII s’est abstenu de condamner publiquement l’antisémitisme nazi puis la mise en œuvre de l’extermination, c’est parce qu’il considérait que, pour la civilisation européenne, le grand danger, la menace suprême, c’était le communisme. Les raisons de Benoît XVI ne sont pas ignobles, mais il aurait dû méditer la lettre du cardinal Tisserant, envoyée en juin 1940 au cardinal Suhard, archevêque de Paris. Il rappelle qu’en décembre 1939, il a prié en vain le pape de publier une encyclique sur le dictamen de la conscience car, dit-il, « c’est le principe vital du christianisme ». Et il ajoute ceci : « Je crains que l’histoire n’ait à reprocher au Saint-Siège d’avoir fait une politique de commodité pour soi-même, et pas grand-chose de plus. C’est triste à l’extrême, surtout quand on a vécu sous Pie XI ». Et Pie XI avait dit, en 1938 : « Nous sommes spirituellement dessémites ».
24 février et 3 mars 2013 : Marcela Iacub relate sa relation avec DSK dans un livre intitulé Belle et Bête, paru aux Éditions Stock. Le 21 février, le titre qui s’affiche pleine page à la une de L’Obs est digne du France Dimanche de l’enfance de Jean Daniel – ou du Voici d’aujourd’hui : « Mon histoire avec DSK : le récit explosif de l’écrivain Marcela Iacub ». L’Observateur publie des extraits de ce livre intitulé Belle et Bête, publié chez Stock, où l’intimité réelle ou fantasmée de deux personnes, l’auteur et son amant célèbre, est exposée au grand jour. Aux nombreux détracteurs du procédé, Le Nouvel Observateur et Libération, le lendemain, répondent en substance : l’art a tous les droits. Ce livre est-il de la littérature ?
Quand l’Angleterre fait du trash, elle appelle cela du trash ; quand la France fait du trash, elle appelle cela de la littérature. Voilà ce qui reste de notre identité nationale au siècle de l’autofiction généralisée. Le Murdoch français est cultivé, il est bardé de références, il invoque Kafka, Michel Foucault, Michel Leiris, et même Chesterton pour justifier l’arrachage des rideaux qui protégeaient la vie privée aux temps lointains qu’étaient les Temps modernes.
Parlons maintenant du livre. Je vais en dire du mal et cela m’attriste parce que Marcela Iacub est une personnalité attachante et que, tout en étant radicalement opposé à son individualisme radical, je la lis le plus souvent avec plaisir. Elle est audacieuse et stimulante.
Mais là, je suis accablé, et je me dois de le dire sans tomber, je l’espère, dans la méchanceté. Le livre raconte son histoire avec DSK qui est tutoyé, n’est jamais nommé, mais que tout le monde reconnaît et qu’elle appelle « Le cochon ». Il est le cochon. Ce n’est pas une insulte, c’est un concept ! Et d’ailleurs, le livre est beaucoup plus théorique que littéraire. C’est un cochon, et elle aime en lui le cochon parce qu’elle aime les cochons : « C’est ma compassion pour ces animaux si dénigrés qui a éveillé mon intérêt pour toi ». Cette assertion est ridicule. Car si on aime les cochons, ce qui est mon cas, alors on les délivre de la métaphore qui leur a fait tant de mal. Les cochons ne sont pas des cochons ! C’est d’ailleurs ce que montre très bien Kundera dans le dernier chapitre de L’Insoutenable Légèreté de l’être. Tereza et Tomas se sont réfugiés dans une coopérative agricole et ils deviennent l’ami du président de cette coopérative. Celui-ci a apprivoisé un cochon. Et ce cochon « […] obéissait à la voix, il était propre et rose, et trottinait sur ses petits sabots comme une femme aux gros mollets trottine sur de hauts talons »… Cette image littéraire est renversante ! On ne dit pas que les hommes sont de gros cochons, ce sont les cochons qui ressemblent à des femmes un peu boulottes et néanmoins coquettes. Donc aimer les cochons c’est les décochonéiser, c’est les libérer de l’image diffamatoire que l’on se fait d’eux, quand on dit de tel homme « salace » ou « repoussant » qu’il est un cochon. Si Marcela Iacub éprouvait la compassion qu’elle prétend avoir pour les cochons, elle les laisserait tranquilles. Et voici sa thèse : le problème de DSK, ce n’est pas qu’il soit un cochon, c’est qu’il soit aussi un homme. Le mal en lui vient de l’homme. « La foule disait que tu méprisais les femmes, en vérité c’est le cochon que tu méprisais. Tu méprisais ce frère, ce cousin, ce prochain qui vit en toi tout en étant autre que toi parce que votre société à deux n’est pas du tout égalitaire. C’est toi le maître, il est l’esclave, c’est toi le Blanc, lui c’est le Noir, l’Arabe, le colonisé, c’est toi le riche et lui le pauvre ». Marcela Iacub, ce n’est pas de la littérature, c’est le gauchisme du cochon. Elle recycle les clichés soixante-huitards, la grande bataille bête et savante de l’Eros, de l’économie libidinale, des machines désirantes, contre la civilisation répressive. C’est atterrant de simplisme, le contraire même de la littérature qui est l’objection du concret, du détail, de la singularité à la pensée massive, qui nous rappelle sans cesse que les choses sont plus compliquées que nous le pensons. Elle s’autorise par surcroît de cette philosophie pour hasarder toutes sortes d’hypothèses fantaisistes et scandaleuses, notamment sur l’affaire du Carlton. Elle dit par exemple que ce qu’il aimait lorsqu’il faisait organiser des partouzes, c’est l’humiliation de ses fournisseurs : ceux-là faisaient tout pour le contenter et il jouissait de savoir qu’il ne les paierait pas de retour. Il avait été humilié notamment par sa femme dont il était le caniche et il se vengeait de cette manière. On est dans ce livre comme sur le Net : toutes les distinctions sont abolies, il n’y a plus de frontières entre la fiction et la réalité. Ainsi apprend-on pour finir que DSK a littéralement dévoré l’oreille de son amante.
L’enthousiasme d’éminents critiques du Nouvel Observateur et de Libération répond-il, comme on l’a dit, à des considérations purement mercantiles ?
Le cynisme mercantile a joué, mais, malheureusement, ceux qui parlent de « littérature » à propos de ce livre sont sincères. Ils ont été bluffés par un récit qui pense et qui pense, en outre, dans la grande lignée libertaire de 1968. Peu leur importait que soit bafoué notre droit de ne pas savoir. Au contraire, ils se sont applaudis de reconnaître à la littérature tous les droits. Je leur répondrai qu’il y a un lien originel entre la littérature et la civilité et que l’imagination romanesque est aussi une manière élégante d’effacer ses traces.
Le 26 février, les éditions Stock et Le Nouvel Observateur ont été condamnés en référé pour atteinte à la vie privée de Dominique Strauss-Kahn. Outre le paiement de dommages et intérêts (50 000 euros pour Stock, 25 000 euros pour Le Nouvel Obs), le tribunal a ordonné l’insertion d’un encart dans le livre et la publication de la condamnation en Une de l’hebdomadaire.
Ce livre, et surtout sa promotion journalistique, ont suscité un haut-le-cœur général. Le sentiment était : « Trop, c’est trop, il y a des limites. » Sentiment que Jean Daniel, fondateur devenu la voix dissidente du Nouvel Observateur, a résumé magnifiquement : « Je veux dire clairement ici que je reste allergique et hostile à tout ce qui contribue à maintenir vivante et médiatiquement sulfureuse la descente aux enfers de cet homme ». On ne saurait mieux dire. « No limit » : telle est, à l’inverse, la philosophie de Marcela Iacub. Contre la censure, elle publie ce livre où elle fait l’éloge du cochon, l’être qu’aucune censure externe ou interne n’arrête, l’être qui jouit sans entrave car il n’a pas de surmoi. Elle s’inscrit dans un mouvement très général et déjà ancien qui dit que le mal dans l’homme vient du surmoi. Eh bien, la morale de cette histoire, c’est au contraire que le mal du siècle vient de l’affaiblissement, de l’effacement progressif du surmoi. Et la tâche des psychanalystes à venir sera sans doute de continuer à soigner les vieilles névroses freudiennes, mais aussi de restaurer le surmoi défaillant des nouveaux individus.
En attendant, ils vont se ruer sur le livre…
Oui. Sachons cependant que ce problème est vieux comme le monde ou en tout cas, vieux comme Platon. Dans La République, Socrate parle de Léontios, Léontios qui un jour se promène, remontant le Pirée, et s’aperçoit que des cadavres gisent près de chez l’exécuteur public. Il est partagé entre la fascination qui lui donne envie de regarder et l’indignation qui le pousse à se détourner. Pendant un instant il lutte, et puis il ouvre grand les yeux et dit : « Voici pour vous, génies du mal, rassasiez-vous de ce beau spectacle ». Nous sommes comme Léontios, nous cédons d’autant plus volontiers à la tentation d’y aller voir que notre surmoi est faible et qu’il ne s’agit pas d’un spectacle macabre, mais d’un spectacle cochon.[/access]
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !