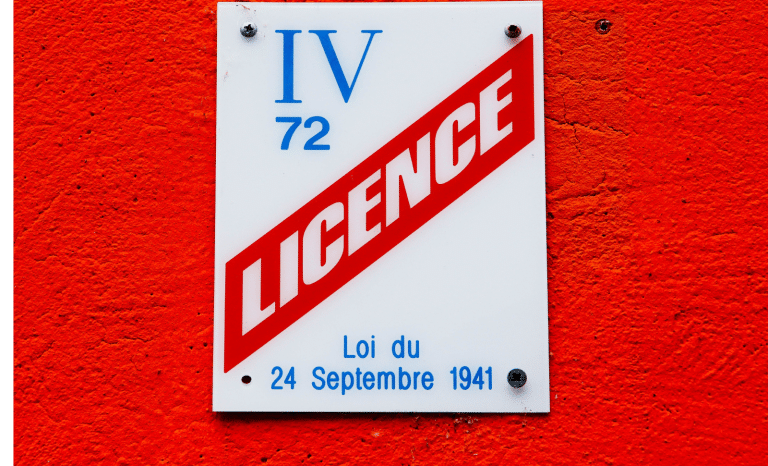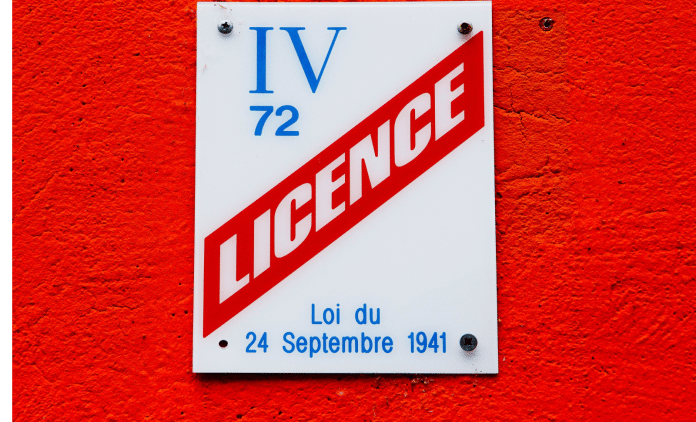Résurrection d’espèces éteintes. L’annonce spectaculaire de l’entreprise américaine Colossal Biosciences soulève des questions éthiques assez vertigineuses. Analyse.
Il n’y a pas de moment plus propice pour parler de résurrection que la Semaine sainte, et c’est peut-être pour cette raison que Colossal, une entreprise pionnière dans le domaine de la bio-ingénierie, a récemment fait une annonce spectaculaire qui a captivé l’imagination du public : le retour du loup sinistre (Canis dirus), une espèce disparue depuis 10 000 ans ! Trois spécimens, nommés Remus, Romulus et Khaleesi (ce dernier, dont le nom est issu de la série télévisée et littéraire « Game of Thrones », n’a pas encore été présenté au public), ont vu le jour grâce à ce projet à la fois surprenant et prévisible.
Une projet secret ayant abouti l’automne dernier
La surprise réside dans le secret qui a entouré cette entreprise, prenant de court de nombreux experts, ainsi que dans le choix de l’espèce « ressuscitée », le loup sinistre, qui ne figurait pas parmi les candidats en tête pour la dé-extinction. En même temps, ce résultat semble prévisible — ou plutôt inévitable — tant il découle de la convergence entre les principes de la conservation et les avancées de la biotechnologie.
Les concepts de conservation regroupent un ensemble de principes et de stratégies destinés à préserver la biodiversité, les écosystèmes et les ressources naturelles de la planète. Ils recouvrent des approches variées, allant de la protection des espèces menacées et de leurs habitats à la restauration des milieux dégradés, tout en intégrant la promotion de pratiques durables dans l’usage des ressources. Plus récemment, grâce aux avancées scientifiques et technologiques, un champ nouveau est venu enrichir cette réflexion : la dé-extinction. L’objectif global de ces démarches est de renforcer la santé et la résilience de la biosphère, dans l’espoir d’assurer un avenir durable à l’ensemble des formes de vie, y compris l’humanité.
C’est trop injuste !
Les principes de conservation soulèvent néanmoins des questions épineuses quant à leur application et à leurs implications. L’un des écueils majeurs réside dans la définition et l’évaluation de la valeur écologique. Déterminer objectivement l’importance d’une espèce ou d’un écosystème demeure une tâche complexe, souvent teintée de subjectivité. Les critères employés — qu’ils soient économiques, esthétiques ou éthiques — varient considérablement, menant parfois à des décisions contestables et souvent contestées : c’est le cas de la réintroduction des loups et des ours en France. De surcroît, la focalisation sur certaines espèces ou certains milieux peut se faire au détriment d’autres, créant des déséquilibres et des formes d’injustice écologique.
A lire aussi: Révolution anti-woke: les fausses pudeurs de la French Tech
La restauration des habitats comporte également ses inconvénients. Les projets dans ce domaine sont souvent coûteux et complexes, nécessitant une expertise technique pointue ainsi que d’importantes ressources. Cette tâche se heurte à la complexité des interactions écologiques. Comprendre et anticiper les effets des interventions sur les chaînes alimentaires, les relations de symbiose ou les interdépendances naturelles représente un défi majeur. De plus, le succès de ces entreprises n’est jamais garanti, car elles peuvent être compromises par des facteurs imprévisibles, tels que les changements climatiques ou les invasions biologiques. Il convient aussi de souligner que restaurer un habitat ne signifie pas nécessairement revenir à un état originel, mais implique plutôt la création d’un nouvel équilibre écologique, potentiellement différent de celui qui prévalait autrefois.
La durabilité, bien que largement promue, demeure un concept souvent flou et sujet à interprétation. Sa mise en œuvre se heurte à des obstacles économiques, sociaux et politiques significatifs. Les intérêts à court terme, qu’ils soient industriels ou gouvernementaux, prennent fréquemment le pas sur les objectifs de durabilité à long terme, engendrant des compromis qui nuisent à la protection de l’environnement. En outre, la définition même de la durabilité varie selon les acteurs et les contextes, ce qui complique l’élaboration de politiques cohérentes et efficaces.
Enthousiasme médiatique, doutes scientifiques
Enfin, la dé-extinction, malgré l’enthousiasme qu’elle suscite dans les médias, soulève des interrogations éthiques et écologiques fondamentales. Ramener à la vie des espèces disparues pose des problèmes liés au bien-être animal, à la gestion des populations et aux risques pour les écosystèmes actuels. Par ailleurs, cette démarche pourrait détourner l’attention et les ressources de la conservation des espèces menacées, dont la protection constitue une priorité plus immédiate. Comme le rappelle l’exemple du bucardo, un chevreau cloné qui n’a survécu que quelques minutes après sa naissance, ce qui illustre bien les défis techniques et moraux que soulève cette approche.
Retournons à nos loups. Le retour des « terrifiants » créés par Colossal soulève dès lors des questions complexes, à commencer par celle de leur authenticité : sont-ils véritablement les répliques exactes de leurs ancêtres disparus ? En réalité, ces créatures issues de la biotechnologie ne sont pas des clones au sens strict, mais des recréations génétiquement modifiées, conçues à partir de l’ADN d’espèces proches et de fragments extraits de spécimens fossiles. Leur apparence et certains traits comportementaux peuvent rappeler ceux des loups préhistoriques, mais il ne s’agit pas d’une résurrection fidèle : leur génome comporte nécessairement des zones d’incertitude, voire des éléments d’innovation. Ces loups, aussi impressionnants soient-ils, résultent donc d’une reconstruction partielle où la science comble les lacunes par des choix technologiques. Ils ne peuvent ainsi être considérés comme de parfaits clones, mais plutôt comme des hybrides, à la croisée du passé reconstitué et du présent reconfiguré.
Dans le cas précis des loups terrifiants, Colossal a procédé en combinant des techniques avancées de génie génétique, notamment l’édition du génome à l’aide du célèbre outil CRISPR-Cas9, avec des cellules d’espèces proches encore vivantes, comme le loup gris ou le chien. En insérant dans leur ADN des fragments d’anciennes séquences génétiques extraites de fossiles, l’entreprise a conçu un organisme hybride reproduisant certaines caractéristiques physiques et comportementales des loups disparus. Il ne s’agit donc pas d’un clone parfait, mais d’une recréation partielle, issue d’une reconstruction génétique ciblée. La réussite de ce projet a été rendue possible par l’édition génétique de l’ADN du loup gris, incluant vingt modifications ciblées sur quatorze gènes. Des chiennes domestiques ont été utilisées comme mères porteuses pour mener à bien ces gestations inédites.
Ainsi, la réintroduction de ces loups à peu près « terrifiants » soulève une interrogation essentielle : ne risquons-nous pas de créer des monstres ? C’est effectivement toute l’ambivalence des biotechnologies : une prouesse scientifique porteuse d’espoirs écologiques, mais aussi de risques profonds. Les hybrides génétiques, mélange d’ADN fossile et moderne, ne sont pas des clones fidèles et leur viabilité à long terme reste incertaine, tout comme leur comportement dans des écosystèmes qu’ils n’ont jamais connus.
Si les « ciseaux génétiques » permettent des modifications ciblées, ils génèrent des altérations imprévues, mutations silencieuses ou effets hors cible, pouvant déclencher des cancers ou des déséquilibres métaboliques. La réparation cellulaire, souvent approximative, ajoute une couche de risques.
A lire aussi, du même auteur: Nétanyahou : ni juges ni Hamas
Introduire une espèce hybride dans la nature revient à jouer aux apprentis sorciers. Ces organismes pourraient supplanter des prédateurs locaux, perturber les chaînes alimentaires ou transmettre des gènes anciens à des populations sauvages, menaçant la biodiversité qu’ils devaient enrichir.
On peut donc poser une autre question : vus les risques, cette résurrection ou réintroduction répond-elle à un impératif écologique ou s’agit-il surtout d’une démonstration de puissance technologique ?
Jusqu’à présent, les experts en conservation ont soutenu la dé-extinction lorsqu’elle visait à restaurer des équilibres écologiques perturbés, en réintroduisant notamment des espèces clés capables de revitaliser des habitats dégradés ou de réactiver des dynamiques naturelles. Ces choix s’appuyaient sur une évaluation rigoureuse des bénéfices attendus pour les écosystèmes. Dans le cas de Colossal, cependant, la communication semble privilégier l’exploit scientifique, mettant en avant la prouesse génétique plutôt que les bénéfices concrets pour la biodiversité. Cette orientation risque de transformer profondément la finalité de la conservation, en l’éloignant de ses objectifs écologiques pour en faire une vitrine de l’innovation technologique. La question n’est donc plus seulement de savoir si l’on peut ressusciter une espèce disparue, mais de comprendre pourquoi, et dans quel but, on choisit de le faire.
Il sera intéressant d’observer comment le monde de la conservation réagira à ce changement de paradigme, et si la logique qui sous-tend la dé-extinction évoluera. En attendant, les réactions à cette annonce sont diverses. Le ministre américain de l’Intérieur et Joe Rogan ont salué l’initiative, tandis que le compte Twitter de l’entreprise débat publiquement avec des journalistes sur la nature exacte de ce loup.
Profitant de l’engouement médiatique, l’entreprise a dévoilé ses ambitions futures, notamment le retour du mammouth laineux d’ici 2028, ainsi que celui du loup de Tasmanie. D’autres espèces emblématiques, telles que le dodo ou le pigeon voyageur noble, figurent également sur la liste des projets envisagés.
Le projet de réintroduction du loup de Tasmanie suit une approche similaire, reposant sur le clonage à partir de cellules prélevées sur un spécimen conservé dans un musée. Le pigeon voyageur noble, disparu en 1914 après une chasse massive, représente un autre défi, notamment du fait de la complexité que représente le clonage d’oiseaux, qui nécessite des manipulations génétiques particulièrement délicates. Quant au mammouth, l’idée consiste à modifier le génome de l’éléphant d’Asie pour créer un équivalent capable de survivre dans le climat sibérien.
L’idée serait de réintroduire cet éléphant-mammouth hybride dans le Parc du Pléistocène en Sibérie, un projet initié par l’écologiste Sergueï Zimov et son fils Nikita visant à restaurer un écosystème de steppe datant d’environ 12 000 ans. Cet environnement reconstitué pourrait non seulement offrir un habitat adapté au mammouth, mais aussi contribuer à limiter le changement climatique : en stabilisant le pergélisol, il réduirait les émissions de gaz à effet de serre libérés par son dégel, qui s’accélère dans la région. Cependant, le conflit en Ukraine a ralenti les avancées, plusieurs partenaires internationaux ayant suspendu leur collaboration avec le parc de Zimov.
D’autres initiatives de dé-extinction sont en cours, bien qu’à un stade moins avancé. L’aurochs européen et le quagga, une sous-espèce de zèbre, font l’objet d’expérimentations de reproduction sélective.
Jurassik Park ? Pas pour tout de suite
Aujourd’hui, le loup sinistre devance tous ces projets, marquant une étape décisive dans le domaine de la dé-extinction. Si cette discipline fascine autant qu’elle inquiète, une espèce semble écartée des tentatives : les dinosaures. Ils ne figurent pas sur les listes, bien que certains évoquent la possibilité de modifier génétiquement des oiseaux actuels, comme l’autruche, pour créer des créatures inspirées des dinosaures. Jusqu’ici rejetée au nom de la restauration des écosystèmes, cette idée pourrait être réévaluée au fur et à mesure que la technologie progresse et devient plus accessible.
Avec ce coup de communication et de technologie, Colossal, dirigée par Ben Lamm et le généticien George Church, s’impose aujourd’hui comme un acteur central dans ce domaine. Son modèle économique, fondé sur la propriété intellectuelle et, potentiellement, le tourisme, soulève des interrogations sur la nature de ses motivations et sur la place réelle accordée à la conservation, bref la question se pose s’il ne s’agit pas d’un loup de Wall Street. L’entreprise, financée par des fonds privés, devra désormais naviguer entre les espoirs nés de ses avancées scientifiques et les inquiétudes suscitées par leurs implications éthiques et écologiques.