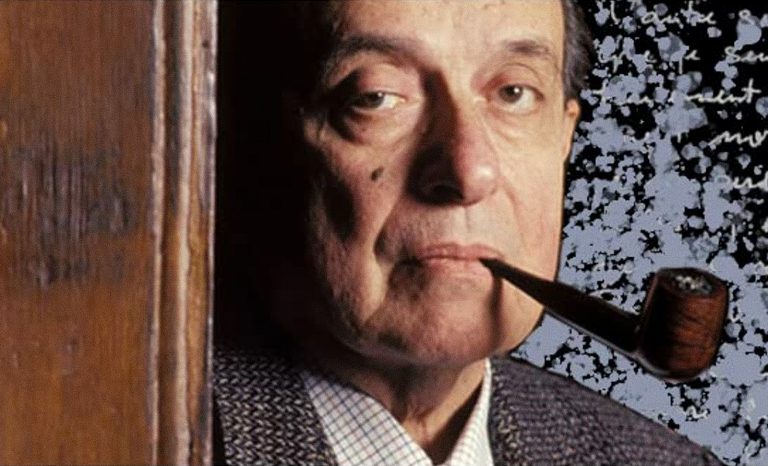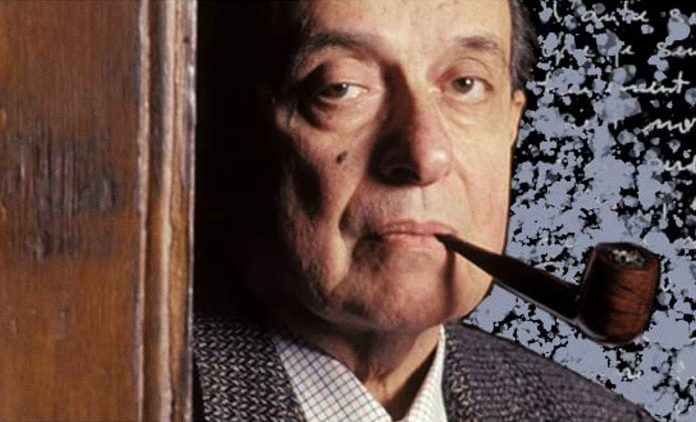Entretien avec l’essayiste Mathieu Slama, auteur de Adieu la liberté, essai sur la société disciplinaire (Presses de la Cité).
Gelés par la grande peur virale, nos esprits se figent. Prisonniers de la répétition automatique des gestes barrières, nos corps se robotisent. Masqués, les visages, autrefois sanctuaires inviolables de la personnalité, sont anonymisés, réduits à des yeux inquiets qui scrutent – certains appelant l’échange d’un regard, d’autres cachant l’âme d’un délateur.
Telle est la société “covidée” que décrit et rejette Mathieu Slama. Dans son dernier livre, Adieu Liberté, l’essayiste dresse non seulement un violent réquisitoire contre la politique sanitaire du gouvernement qu’il qualifie de disciplinaire, mais il dénonce aussi et surtout le consentement d’une large majorité de citoyens, qui a accepté ou plébiscité avec une docilité déconcertante des mesures de contrôle et de surveillance qui sont passées d’exceptionnelles à normatives. Hier, le peuple français était à l’avant garde de la liberté. Aujourd’hui, il est celui de la soumission volontaire à “l’idéologie du safe” et à un biopouvoir… Entretien.
Isabelle Marchandier. Des visages masqués devenus anonymes, des corps robotisés par la répétition de gestes barrières, une citoyenneté et une liberté conditionnées au statut vaccinal : a-t-on basculé dans une autre société ?
Mathieu Slama. Si les racines de ce désastre viennent de plus loin, il est incontestable que la crise sanitaire a précipité notre basculement vers un nouveau modèle de société. Une société où la liberté cesse d’être un principe supérieur à tous les autres, une société où la liberté nous est accordée par le pouvoir en fonction de notre comportement, une société où l’ordre est la condition de la liberté, où les devoirs précèdent les droits (de l’aveu même du Président de la République !), où la morale remplace le droit. Une société, également, où l’individu s’efface devant le collectif, et où, au fond, tous nos principes républicains se retrouvent à l’envers, inversés. J’ai en tête un échange avec un grand spécialiste de droit public, défenseur reconnu des libertés publiques, qui affirmait, en défense des mesures sanitaires, que le principe même de la République est de mettre le collectif avant l’individu. Qu’une telle méprise vienne d’un juriste aussi capé montre bien l’ampleur de notre désarroi…
“Mesures de freinage”, “distanciation”, “gestes barrières”, “protocole”… jusqu’à la dernière trouvaille langagière en date, signée Olivier Véran, “la concordance” entre la carte d’identité et le passe vaccinal… Quel rôle joue cette novlangue ?
Je suis convaincu que notre enfermement s’est d’abord joué sur le terrain de l’imaginaire et de la langue qui a, en quelque sorte, conditionné notre perception de la crise et donc notre acceptation des mesures prises. À partir du moment où la société toute entière reprend le lexique médical et scientifique, parle de « confinement » au lieu d’ « enfermement », euphémise les mesures les plus aberrantes en parlant de « mesures de freinage », alors nous sommes prêts à accepter l’inacceptable. Parler de « résilience », de « fragilité », de « vulnérabilité » etc. sous l’influence du pouvoir et de quelques intellectuels naïfs, revient à dépolitiser totalement la situation et à rendre les mesures les plus liberticides inéluctables. Et que dire du chantage à la « solidarité » et à la « responsabilité », mots martelés jour et nuit par le gouvernement pour culpabiliser les réfractaires (ce même gouvernement qui est responsable des mesures sociales les plus réactionnaires depuis des décennies…) ? Le langage a joué un rôle immense dans cette domestication des esprits et des corps, cela ne fait aucun doute.
Face au terrorisme, on disait (à raison, selon moi) qu’il ne fallait rien céder sur nos valeurs. Mais face au virus, on a cédé sur tout…
Votre essai est aussi un coup de gueule adressé à nous, les citoyens qui avons consenti et même plébiscité les mesures restrictives de nos libertés sous prétexte sanitaire. « Nous fûmes jadis les avant-gardistes de la liberté ; nous avons été, dans cette crise, les avant-gardistes de la servitude » écrivez-vous en digne héritier de La Boétie. Comment peut-on se renier à ce point ?
Je pense même qu’on peut aller plus loin : si le pouvoir a pris des mesures aussi liberticides et autoritaires, c’est parce qu’il y a eu une forte demande sociale pour ces mesures. Autrement dit : si les Français avaient été moins dociles, alors il ne fait aucun doute que le gouvernement aurait été plus prudent et moins autoritaire dans sa gestion de la crise. Rappelons qu’en janvier 2021, Emmanuel Macron prend la décision de ne pas reconfiner le pays en partie parce qu’il y a, dans l’opinion, un début de lassitude qui s’exprime. Nous sommes donc en partie responsables de ce qui nous est arrivé. On pourrait également évoquer la manière dont la délation s’est généralisée, la méfiance des uns vis-à-vis des autres, la manière dont le pays tout entier a fait des non-vaccinés les boucs émissaires de la crise… La pandémie a réveillé dans le pays des pulsions malsaines et grégaires.
Preuve en est avec l’apparition d’une nouvelle figure, celle du citoyen policier, chargé d’être vigilant non seulement vis-à-vis de lui-même, mais aussi et surtout vis-à-vis des autres. « Soyez tous vigilants » : cette injonction permanente du pouvoir a quelque chose de très dérangeant, et pousse chacun à être le flic de l’autre. D’ailleurs, le fonctionnement même du passe implique que des citoyens ordinaires endossent le rôle de policier, vérifiant les QR code d’autres citoyens avec potentiellement des contrôles d’identité. Ce monde-là est effrayant.
Vous écrivez qu’on a perdu le goût de la liberté et surtout le dégoût de la servitude. Peut-on dire qu’on a pris goût au contrôle ?
Le fait que nous ayons perdu tout goût pour la liberté est un fait incontestable, et cela ne date pas de la crise sanitaire. Ce que cette crise a révélé en revanche, c’est la profondeur de ce mal et les conséquences désastreuses qu’il peut avoir sur notre démocratie. S’installe en France, pays de la liberté, ce que j’appelle une idéologie du « safe », c’est-à-dire un nouveau paradigme dans lequel les valeurs politiques essentielles sont la sécurité et la protection, tandis que la liberté devient non seulement secondaire mais aussi suspecte, dangereuse. Depuis quand la vie biologique est devenue l’alpha et l’omega de toute politique ? Depuis quand a-t-on abandonné l’idée qu’il y a des principes avec lesquels on ne transige pas, qu’il y a des lignes rouges à ne pas franchir, que la fin ne justifie pas tous les moyens ? Face au terrorisme, on disait (à raison) qu’il ne fallait rien céder sur nos valeurs. Mais face au virus, on a cédé sur tout. Et quand le Premier ministre tient en conférence de presse des propos comme « Le couvre-feu est maintenu jusqu’à nouvel ordre », tous les démocrates de ce pays devraient exprimer leur colère et leur révolte… Cela n’a pas été le cas !
Face à cette société disciplinaire qui a donc accepté de sacrifier la liberté sur l’autel de la sécurité, vous opposez la liberté absolue. Une liberté conditionnée à des injonctions sanitaires « se vide de sa substance” affirmez-vous carrément. Mais n’est-ce pas confondre la licence – je fais ce que je veux – et la liberté au sens être responsable des conséquences de ses actes ?
Je pense qu’il n’y a pas de mal à être un peu libertaire et je pense même que c’est une nécessité dans le climat d’ordre et de discipline actuel. Je suis également très sceptique sur la formule « la liberté va avec la responsabilité » parce qu’elle revient souvent, dans la bouche de ceux qui la prononcent, à minimiser l’importance de la liberté et à justifier toutes les restrictions possibles et imaginables. La liberté n’a de bornes que la loi. Point. Un citoyen a des droits, ses seuls devoirs sont de respecter la loi. Et quand la loi empiète trop sur les libertés, alors il faut le dénoncer.
Certes, mais, de nouveau, que répondez-vous au discours rappelant cette vision collective de la liberté et qui serine à longueur de temps qu’une liberté individuelle qui nuit à la liberté des autres est irresponsable ? La liberté individuelle de ne pas se faire vacciner est-elle compatible avec un comportement citoyen et responsable ?
Dire que le collectif est supérieur à l’individu est la marque des régimes autoritaires, qu’ils soient communistes ou réactionnaires. J’ajoute que toute liberté s’effectue au détriment de quelqu’un (une parole peut blesser quelqu’un, une mauvaise conduite peut provoquer un accident, une fête peut provoquer un cluster etc.) : c’est ce désagrément lié à la liberté que notre société n’accepte plus. J’ajoute que la responsabilité, la vraie, consiste justement à faire confiance aux individus plutôt qu’à les contraindre et à normer les comportements !
Revenons tout simplement à ce qu’expliquait Rousseau dans le Contrat social : l’intérêt général doit se fonder sur un prérequis indispensable : l’adhésion rationnelle de chaque citoyen. Nous ne sommes pas des enfants, et nous sommes évidemment prêts à accepter des limitations de liberté quand elles sont proportionnées et rationnelles (port du casque, port de la ceinture etc.). Mais avec cette crise sanitaire, on parle de tout autre chose : il s’agit de faire du pays entier une prison (confinement), d’imposer un masque permanent dans la rue, d’exclure de la vie sociale toute personne refusant la vaccination, alors même que le climat est très tendu et la cohésion sociale très abimée. La vraie irresponsabilité est là.
Pour vous, la liberté absolue va-t-elle jusqu’à la désobéissance civile ? Ce serait l’anarchie !
Je ne pense pas que l’anarchie soit forcément une mauvaise chose en soi. Proudhon a d’ailleurs essayé de prouver qu’elle était consubstantielle à l’esprit de la République ! Je n’irai pas jusque-là, mais il y a un droit, pour chaque citoyen, d’adhérer et de consentir aux lois qui lui sont imposées, d’autant plus lorsqu’elles sont attentatoires à ses libertés fondamentales. Dans certaines situations, il faut savoir dire non. Mais j’insiste sur un point : dans une démocratie d’opinion comme la nôtre, nul besoin de désobéissance civile ! Un rejet massif d’une mesure dans l’opinion, des manifestations d’ampleur et d’autres actions indirectes peuvent suffire pour faire plier un gouvernement. Cela s’est vu à plusieurs reprises par le passé. Si une majorité de Français s’étaient levée contre le passe ; il ne fait aucun doute qu’Emmanuel Macron l’aurait supprimé.
Hier, la guerre froide déclenchait des débats animés entre les intellectuels de gauche et de droite. C’était Sartre contre Aron. Aujourd’hui la « guerre sanitaire » a rendu presque mutiques les intellectuels à quelques rares exceptions. Le « sanitairement correct » a-t-il gagné tous les esprits?
Les rares intellectuels à avoir compris ce qui se jouait dans cette crise sont deux représentants de la gauche critique héritée de Michel Foucault, l’intellectuel italien Giorgio Agamben et la philosophe Barbara Stiegler. Ce n’est pas un hasard. Les intellectuels marxistes se sont plantés, notamment parce que la politique sanitaire a été en partie communiste au sens où elle a instauré un ordre collectif au nom de la solidarité et de l’altruisme. D’où les errements de penseurs aussi importants que Badiou, Rancière, Zizek, Chomsky… Quant aux intellectuels de droite, eux, ils n’ont vu aucun problème à ce que l’état d’exception s’installe et que l’ordre et l’autorité s’imposent, puisque cela fait partie de leur logiciel ! D’autres intellectuels ont participé à la dépolitisation de la crise, évoquant pêle-mêle « Gaia qui respire », « Un autre monde est possible », « La respiration nécessaire ». Bref, toutes ces pensées naïves et creuses sont passées totalement à côté de l’immense problème que nous avions en face de nous.
Vous faites le parallèle entre le wokisme et le sanitarisme, entre les éveillés woke constamment offensés par la société jugée “systémiquement” discriminante et les « enfermistes » qui préfèrent vivre dans un bunker stérilisé. Les deux, dites-vous, sont animés par la même idéologie, l’idéologie du « safe ». Comment la définissez-vous ?
Je vais vous surprendre, je pense que le mouvement woke pose certains constats très lucides sur la société française, sur la prévalence des discriminations et sur leur caractère systémique. Ce que je critique en revanche, c’est la réponse que ce mouvement apporte à ces problèmes majeurs. Une partie de la gauche, imitant sans s’en rendre compte les réflexes de la droite, est prise d’une frénésie autoritaire, punitive et je dirais même sécuritaire. Que fait le mouvement woke et ses avatars ? Il réclame des peines plus lourdes, une justice plus sévère, la fin de la présomption d’innocence et de la prescription, la censure, la fin de la libre parole et de la libre pensée etc. Il y a 40 ans, la gauche militait pour la liberté des mœurs, la fin des prisons et le démantèlement de la justice. C’est tout un esprit libertaire de gauche qui est en train de disparaître au profit d’un marxisme autoritaire mélangé à un puritanisme venu d’Amérique totalement étranger à notre culture républicaine.
Et au fond, le mouvement woke comme l’hygiénisme tel qu’il s’est exprimé dans cette crise illustrent tout deux un même esprit du temps que je définis par l’idéologie du « safe ». On assiste en effet à l’avènement d’une société dans laquelle le nouveau paradigme dominant est la protection et la sécurité au détriment de la liberté. La droite ultra-sécuritaire et autoritaire participe de cette même idéologie, et c’est là où je pense que le vrai clivage aujourd’hui se situe entre partisans de l’ordre et partisans de la liberté. Et il dépasse largement le seul clivage droite-gauche.
Ne craignez-vous pas que ce parti de la Liberté soit une coquille vide étant donné le consentement de la grande majorité des Français ?
Oui, c’est une hypothèse très fragile. Je remarque que cette crise a dévoilé un clivage générationnel. Tous les sondages ont montré que globalement la jeunesse a été plus critique vis-à-vis des mesures sanitaires que leurs aînés qui ont plébiscité la société d’ordre et de discipline qui s’est installée. Pour beaucoup de jeunes, il y aura un avant et un après crise, au sens où ils ont vu ce que signifiait très concrètement un État autoritaire, comment il pouvait nous enfermer chez nous, nous empêcher de faire la fête, de voir nos proches etc. Ces jeunes l’ont vécu dans leur chair. Alors, peut-être que chez certains aura lieu une épiphanie et la révélation qu’une société de liberté est préférable à une société d’ordre. En réalité, c’est plus un souhait qu’un constat : mais pour moi, à titre personnel, le vrai combat est là.
Adieu la liberté, c’est le titre funeste de votre essai. Pourtant, cet adieu ne semble pas définitif : des parlementaires du RN et de LFI ont voté contre la loi sur le passe vaccinal, et n’oublions pas tous ceux que la presse désigne comme des antivax qui sont en majorité des anti-passes et crient ce mot de “liberté” qui vous tient à cœur dans leurs manifestations. Diriez vous que la liberté a changé de camp ?
Il se passe en effet une chose étrange, paradoxale, où les modérés et les libéraux défendent l’autoritarisme et les extrêmes défendent les libertés ! Je suis très critique sur cette extrême droite qui a selon moi exploité la crise de manière très opportuniste et a vu dans la défense des libertés un filon électoral. D’ailleurs, la plupart de ceux qui se font les résistants à l’ordre sanitaire aujourd’hui défendaient un confinement dur et autoritaire au début de la pandémie, ce qui est une réaction impossible quand on est réellement attaché aux libertés. L’extrême droite défend un État autoritaire et la sortie de l’État de droit : deux positions incompatibles, selon moi, avec la défense des libertés fondamentales.
Concernant le parti de Jean-Luc Mélenchon, il a mis du temps à prendre position contre la politique sanitaire mais leur opposition à l’instauration du passe vaccinal a été exemplaire – et courageuse parce qu’ils n’avaient rien à gagner en faisant cela. J’y vois pour ma part l’influence de François Ruffin, qui est très proche de la philosophe Barbara Stiegler.
Quant aux libéraux, il y aurait mille choses à dire sur la manière dont beaucoup d’entre eux ont trahi leurs idéaux, mais au fond cette crise a révélé qu’ils étaient bien plus préoccupés par la liberté d’entreprendre que par nos droits fondamentaux.
Que répondez-vous à Emmanuel Macron qui veut “emmerder” les non-vaccinés et entend les traiter en citoyens de seconde zone ?
Que sa plus grande faute est d’encourager et de remuer les passions les plus tristes et les plus malsaines de notre société en vertu d’un médiocre calcul électoraliste. Qu’en encourageant la majorité à persécuter la minorité, il trahit non seulement sa fonction – mais tout notre héritage républicain dont il est pourtant le dépositaire.
Adieu la liberté - Essai sur la société disciplinaire: Essai sur la société disciplinaire
Price: 20,00 €
32 used & new available from 2,82 €