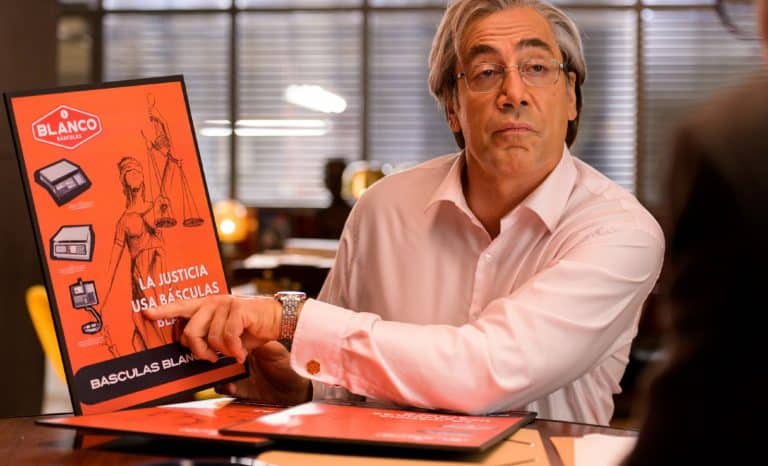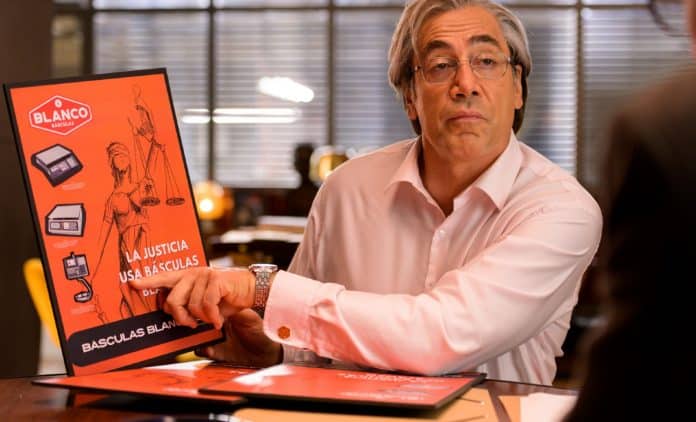À l’Opéra Garnier
Familier au courtisan du XVIIIème siècle, le fatras mythologique sur lequel s’adosse Platée, « opéra bouffon » crée en 1745 au manège des Grandes Écuries de Versailles pour célébrer, parmi son lot de fêtes somptueuses, les noces du dauphin de France avec l’infante espagnole Marie-Thérèse, est à peu près incompréhensible au spectateur lambda en 2022, avouons-le.
Platée, laideron nymphomane
Du temps de Louis XV, le genre lyrique connaît des impératifs formels très stricts, des figures imposées, des conventions en matière de livret et de séquences chorégraphiées, auxquelles cette « comédie-ballet » de Rameau ne déroge pas. Mercure, Jupiter, Junon, les Satyres et les Ménades, le dieu Momus ou la muse Thalie, tout ce petit personnel de la fable antique nous est devenu passablement étranger. Mais peu importe, au fond : le comique demeure. Et la musique, surtout ! D’une alacrité, d’une fantaisie sans pareilles. L’immense compositeur des Indes galantes, d’Hyppolyte et Aricie ou des Boréales, Jean-Philippe Rameau (1683-1764), honoré par la Monarchie au jour où le scorbut l’emporte à Paris, au point qu’elle lui alloue alors un service solennel à l’Académie royale de musique, Rameau, grand oublié de la période romantique, revient en gloire au XXIème siècle – et c’est justice.
A relire, Elisabeth Lévy: Scandale de l’Opéra de Paris: la gauche décomplexée
De cette comédie lyrique en un prologue et trois actes, l’argument dramatique est fort mince : Platée, laideron nymphomane, prend ses désirs pour la réalité. Dans le dessein de guérir Junon de sa jalousie, l’on invente un stratagème : Jupiter feindra de tomber amoureux de Platée, reine des grenouilles. Ce dernier lui apparaît tour à tour sous les traits d’un âne, d’un hibou, et d’un mâle enfin, un vrai (chanté par l’excellente basse Jean Teitgen). Survient La Folie (en alternance, les soprano Julie Fuchs – décevante – et Amina Edris), qui donnera toute une suite de divertissements (d’où la succession des ballets) pour maquiller cette fausse idylle. Le jour du mariage, Junon (sous les traits de la mezzo-soprano gabonaise Adriana Bignani lesca, laquelle fait ici son entrée à l’Opéra de Paris) découvre la laideur de sa rivale et, guérie de sa jalousie, rejoint Jupiter dans les nuées – mariage mixte ? – tandis que, sous les quolibets du populo, Platée la batracienne travestie (derrière le grimage, le ténor américain Lawrence Brownlee – faible puissance vocale, mais timbre et phrasé impeccables) replonge dans son cloaque…
Tonnerre d’applaudissements
Beaucoup d’effets de tempêtes dans cet univers agreste traversé par maints caprices de la Nature : « des Aquilons fougueux la dévorante haleine/ Menace à chaque instant nos champs et nos coteaux », chantera Cithéron (le roi de l’air frais de la montagne), dès la deuxième scène du premier acte. Laurent Pelly, émérite scénographe lyrique dont l’Opéra de Paris reprend en l’espèce sa toute première mise en scène, datée… 1999, faisait le choix – inédit, à l’époque – d’un plateau redoublant en miroir le volume de la salle Garnier, avec ses rangées de fauteuils d’orchestre occupés par chœurs, chanteurs et danseurs, dispositif bientôt envahi de tourbe végétale et qui ira se désagrégeant jusqu’à la scène finale. En près d’un quart de siècle, l’idée n’a pas trop mal vieilli. Au soir de la première, d’ailleurs, cette énième reprise de Platée, comme en 2015 sous la baguette de Marc Minkowski, a été saluée par un tonnerre d’applaudissements. Il est vrai qu’entre ce peuple de grenouilles aux yeux rouges exorbités, ce couple Junon-Jupiter nippés de bleu pétant comme pour un show de music-hall, cette La Folie en robe longue imprimée de partitions, ce Momus ailé en slip blanc, cette frétillante, plantureuse et comique Platée batracienne, etc. etc., bouffonnerie et travestissement font chorus, à merveille.
On s’étonnerait presque, par les temps qui courent, qu’une délégation d’activistes #MeToo ne se soit pas encore postée au pied de l’Opéra, avec banderoles et porte-voix, pour protester contre l’image dégradée de la Femme véhiculée par le grotesque de cette incarnation amphibienne à l’évidence discriminante, et qui dévalorise la disgrâce physique en reconduisant, une fois de plus, la jupitérienne domination masculine. Cancel Rameau ?
Platée. Opéra lyrique (ballet bouffon) en un prologue et trois actes, de Jean-Philippe Rameau. Direction : Marc Minkowski. Mise en scène : Laurent Pelly. Avec Lawrence Brownlee (Platée), Julie Fuchs/Amina Edris (Thalie, La Folie), Jean Teitgen (Jupiter), Adrianna Bignani Lesca (Junon)….
Opéra Garnier. Les 19, 21, 24, 26, 29 juin, 1, 5, 7, 10, 12 juillet 2022. Durée : 3h.