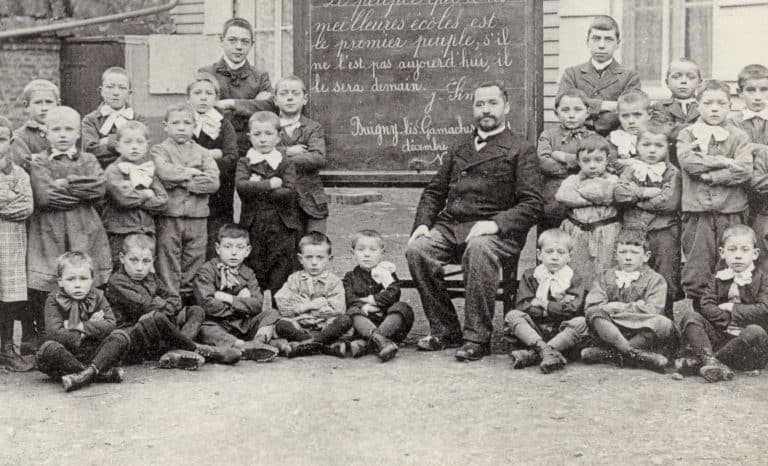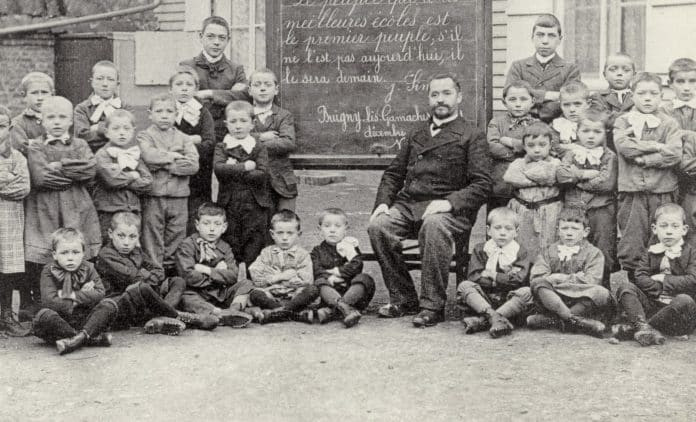Avec 8% de part de marché à la télévision, 5% à la radio et 8% dans la presse écrite, Vincent Bolloré est loin de dominer le secteur des médias français. Mais aux yeux de la ministre de la Culture, c’est déjà trop.
Si vous avez aimé le manque de fair-play de Donald Trump envers le New York Times, qu’il accusait régulièrement de « fake news » du temps de sa présidence, allez donc faire un tour sur le site web de France Inter et écoutez comment Rima Abdul-Malak s’en est pris le 9 février à Vincent Bolloré : vous allez adorer ! Au micro de Léa Salamé et Nicolas Demorand, la ministre de la Culture a, tenez-vous bien, déploré les « menaces » que ferait peser selon elle le propriétaire de Vivendi sur la « liberté d’expression et de création ». Rien de moins… Et de se prévaloir d’un « certain nombre d’exemples » survenus « dans les derniers mois et les dernières années » au sein des médias détenus par le milliardaire breton : Canal+, Europe 1, CNews, C8, Prisma Presse, Paris Match, Le Journal du dimanche.
A lire aussi : Ces tweets antisémites qui embarrassent France 24
Inutile de préciser qu’aucun des « exemples » cités ne constitue la moindre atteinte aux droits fondamentaux (à l’exception, soyons honnêtes, de la détestable émission du 10 novembre dernier sur C8, durant laquelle l’animateur Cyril Hanouna a empêché le député LFI Louis Boyard de parler). Certes, la vie n’est pas rose tous les jours chez Vivendi. Depuis que le « petit prince du cash-flow » y règne en maître, plusieurs journalistes et animateurs ont été virés, parfois brutalement. Mais n’est-ce pas le lot commun, aussi déplaisant soit-il, de toutes les rédactions et de toutes les sociétés de production audiovisuelles ? Et quand bien même Vincent Bolloré serait-il, comme le prétend Erik Orsenna dans son dernier livre, un « ogre », Mme Abdul-Malak aurait l’obligation constitutionnelle de se tenir loin de cette affaire et de laisser l’Arcom, la direction de la concurrence, les prud’hommes ou bien le fisc s’en occuper.
Fort heureusement, une ministre française ne dispose pas davantage qu’un président américain du pouvoir d’interdire à ses concitoyens quelque média privé que ce soit. Et Dieu merci, Mme Abdul-Malak a beau agiter la menace d’une fin d’autorisation d’émettre pour C8 et CNews, elle n’a en réalité aucune tutelle sur l’attribution des ondes, procédure totalement indépendante du gouvernement.
A lire aussi: Du bon usage de l’ogre
En sortant grossièrement du cadre de ses attributions, l’ancienne conseillère culturelle d’Emmanuel Macron n’a en somme fait que trahir l’inconscient illibéral de son Jupiter de président. Rendant toutefois au passage un fier service à M. Bolloré. Car non seulement celui-ci voit confortée sa réputation d’homme libre (déjà assurée depuis cinq ans par l’oxygène pluraliste qu’il a apporté au paysage médiatique français), mais surtout le voilà qui possède à présent une carte maîtresse dans sa main : si un jour la Macronie s’avisait de lui retirer telle aide ou tel agrément, ce serait pour lui un jeu d’enfant de ressortir les allégations incongrues de la ministre et de se poser en martyr du régime. Comment dit-on « judo » en breton ?