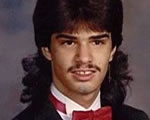Le 29 novembre 1947 l’assemblée générale des Nations unies votait une résolution mettant fin au mandat britannique en Palestine et enjoignant les protagonistes d’y créer deux Etats, l’un juif, l’autre arabe (c’est-à-dire palestinien). Pour les Juifs de Palestine, ce fut l’euphorie, pour les Arabes la consternation. Dès le lendemain commença une guerre civile qui allait rapidement embraser la région.
Soixante ans, six guerres et deux intifadas plus tard, l’idée selon laquelle la seule solution de l’impossible équation proche-orientale est la création de deux Etats paraît s’être imposée à tous les gens raisonnables et même aux autres. De part et d’autre, même les plus extrémistes savent qu’il leur faudra partager la terre. Et pourtant, la mise en œuvre de ce partage semble presque aussi hors d’atteinte qu’elle l’était en 1948 – quand les Arabes promettaient de jeter tous les Juifs à la mer. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Ehoud Olmert à son retour de la conférence de paix d’Annapolis, dans un entretien accordé à Haaretz à l’occasion du soixantième anniversaire de ce vote historique. Pour le Premier ministre israélien, un Etat bi-national sera bientôt la seule issue possible. En clair, pour le partage, c’est maintenant ou jamais. Et peut-être est-ce déjà trop tard. Peut-être que les Israéliens juifs devront un jour accepter d’être les citoyens minoritaires d’un Etat palestinien.
Il est donc possible qu’Annapolis soit la dernière chance d’un plan de partage redevenu d’actualité au début des années 90 avec les accords d’Oslo. La construction de la « barrière de sécurité » (appelée mur de séparation par les gauches européennes) aurait pu constituer une avancée significative dans ce processus de divorce raisonnable à défaut d’être à l’amiable. D’ailleurs, l’idée avait été lancée par la gauche avant d’être pervertie par la droite. « Les bonnes barrières font de bons voisins », disait Ehud Barak. Plus tard, Sharon a décidé de la construire, cette clôture de bon voisinage, mais dans le jardin des voisins, ce qui a considérablement amoindri ses effets bénéfiques.
Ehoud Olmert l’a bien compris : déjà extrêmement difficile à mettre en œuvre dans les conditions actuelles, la « solution à deux Etats » (two states solution) sera bientôt impossible à réaliser à cause de la colonisation. Sans même présumer de la volonté des Palestiniens de trouver un compromis avec Israël, il devient évident qu’un grand nombre de colonies sont aujourd’hui une réalité irréversible – un fait accompli. Autour d’un « Très grand Jérusalem », un tissu dense de villes et villages arabes et israéliens entrelacés, ainsi que deux autres conurbations au nord et au sud de la capitale, rendent peut-être déjà caduque toute solution de partage. Si Israël s’est déjà montré à deux reprises capable de démonter villes et villages (dans le Sinaï au début des années 1980 et à Gaza il y a deux ans), en Cisjordanie, certaines zones ont sans doute déjà dépassé le seuil critique et ne sont plus « démontables ». En conséquence, sauf à imaginer un scénario-catastrophe type indépendance algérienne, il n’est plus vraiment question de tracer une frontière au cordeau. Ce qui signifie qu’il n’y a plus de « solution toute simple » en vue.
Il faut prendre Olmert au sérieux. La logique actuelle des efforts de paix – dont la légitimité repose sur la résolution historique de l’ONU de novembre 1947 – a probablement vécu. Toute solution raisonnable impliquera d’une manière ou d’une autre des enclaves « binationales », tandis que les droits individuels et collectifs des uns et des autres feront l’objet d’arrangements complexes. Au lieu de tourner en rond autour d’un trésor qui n’existe plus, il faut donc placer ces zones au cœur des négociations. Le meilleur endroit pour commencer, c’est Jérusalem. Il faudra y inventer des structures communes permettant aux deux communautés de satisfaire leurs besoins pratiques et symboliques, autrement dit de répondre à leurs demandes en termes de souveraineté et de propriété. C’est la seule manière de recréer un cycle vertueux. Jérusalem ne doit plus être l’appendice empoisonné d’une négociation condamnée à ne pas aboutir, l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes à tous, Israéliens et Palestiniens. Le seul processus viable, c’est « Jérusalem d’abord ».