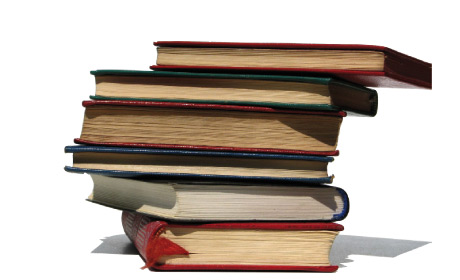Le comble de l’antisémitisme serait de croire qu’il n’y a pas chez les juifs une proportion raisonnable de brutes écervelées et de jeunes crétins. Ou encore de considérer que les auteurs de violences commises au nom d’une improbable « défense juive » sont excusables parce qu’ils sont pauvres, incultes ou traumatisés par les souvenirs d’une guerre qu’ils n’ont pas vécue.
À Causeur, l’antisémitisme, on n’est pas trop pour. En conséquence nous pensons que quand des juifs sont coupables de délits ou de crimes, ils ont le droit, comme n’importe quels Français, d’être coffrés par la police de leur pays et jugés par la justice de leur pays. Peu me chaut qu’ils invoquent Israël, la Torah, la pensée du président Mao ou leur enfance malheureuse.
On peut donc se féliciter que les auteurs présumés du saccage d’une librairie parisienne vouée à la défense de la cause palestinienne aient été interpelés et placés en garde à vue mercredi. Les idées, ça se combat avec des idées. Autrement dit, quand on n’est pas d’accord, on cause, mieux que l’adversaire, plus fort et plus malin que lui. On lui explose la tête intellectuellement. Mais on n’attaque pas une librairie. Pas chez nous les Français. Pas chez nous les juifs.
Je n’ai jamais mis les pieds dans la librairie « Résistances » sise à Paris XVIIème et je ne pense pas pallier ce manque dans un avenir proche. Ses responsables Olivia Zemor et Nicolas Shahshahani animent ou animèrent le CAPJIPO, dont une partie du sigle signifie « Pour une paix juste au Proche Orient », ce qui pour eux, passe plus ou moins clairement par la disparition d’Israël comme Etat juif – un Etat juif, c’est déjà fasciste, non ? Ces deux braves pacifistes qui furent également fort actifs dans la liste Euro-Palestine en 2004 ont une tendance marquée à « comprendre » (attention, je n’ai pas dit justifier), les « résistants » du Hezbollah et autres organisations également très pacifiques. Le genre à condamner les attentats-suicides, mais.
Pour être honnête, il faut préciser qu’ils semblent s’être arrêtés à la porte du dieudonnisme. Je n’irais ni passer des vacances avec eux ni chercher dans leur librairie de quoi lire pendant les miennes. Mais je suis prête à me battre pour qu’ils puissent continuer à vendre leur propagande anti-israélienne en toute quiétude.
Or, vendredi dernier, apprend-on par les agences de presse, « cinq hommes cagoulés et en jogging sombre sont entrés dans la librairie armés de bâtons et de bouteilles d’huile. Ils ont cassé la caisse et les ordinateurs, jeté les livres par terre et vidé leurs bouteilles d’huile sur le sol ». En prime, ils ont, sinon brutalisé au moins bousculé et effrayé les personnes qui se trouvaient là. Les agresseurs se sont réclamés de la « Ligue de défense juive » – qui nie sur son site « toute participation aux dégradations de la Librairie Résistances ». La police tranchera. Mais si la survie du peuple juif dépend d’aussi sombres abrutis, l’avenir n’est pas tout rose.
Alors, ça me fait tout drôle mais voilà : je suis d’accord avec Pascal Boniface. Dans une tribune publiée sur son blog, il exprime son « indignation à la fois par rapport à l’attaque qu’ils ont subie, et l’absence de réactions qu’elle a suscitée ». Eh bien moi aussi, je suis indignée par l’attaque et indignée par l’absence de réactions. Pour tout dire, j’aurais apprécié un communiqué du CRIF ou de la LICRA. Et puisque c’est mon jour, je ne suis pas loin d’être d’accord avec le MRAP qui demande l’interdiction de la LDJ. S’il y a de quoi, dans la loi, interdire cette association, il faut que force reste à la loi.
Et puis s’attaquer à des livres devrait être une circonstance aggravante, en particulier quand on appartient à un peuple du Livre.