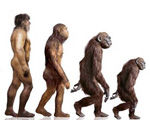En mai 68, Boris Cyrulnik était interne en psychiatrie. Il se souvient d’avoir pendant les événements accompagné un « schizophrène profond » au Quartier Latin. Lequel n’avait pu s’empêcher de prendre la parole lors d’une AG à la Sorbonne. Ce qui devait arriver arriva : l’interminable bouffée délirante du patient en goguette fut accueillie par un non moins interminable tonnerre d’applaudissements. Ce témoignage et beaucoup d’autres, tout aussi décapants (Jean-Pierre Le Goff, Annette Levy-Willard, Jean Claude Barreau), sont à voir mardi 13 à 23 h sur Canal + dans l’excellent doc « Mémoire de mai » de Philippe Harel. Naturellement, Télérama a détesté.
In vino, patatras
Selon Vinexpo, les USA deviendront en 2008 le premier consommateur de vin non pétillant. La France, elle, devra se contenter de la troisième place, derrière l’Italie. On ne sait si c’est là la conséquence logique de la multiplication des lois « hygiéniques », comme celle qui proscrit le tabac dans les lieux publics. Ou bien le fruit des erreurs stratégiques d’une profession bachique, qui avait le choix entre le modèle français du luxe (adaptation sans état d’âme culturel à la mondialisation, façon LVMH) et celui de la haute couture (i.e., défense autiste de la splendeur parisienne… au plus grand profit de Milan). Mais que les « déclinistes » ne se réjouissent pas trop hâtivement ! Selon le Bureau des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC), la France progresse à vitesse grand V en matière de consommation d’une autre « drogue coutumière », pleine d’avenir. Le cannabis.
Fumer nuit

« Violence d’un crime ! Atrocité d’un meurtre ! c’est l’assassinat qu’on assassine » : voilà près de deux cents ans que la critique unanime s’égosille devant ce tableau de Jacques Louis David représentant la mort de Marat. Les livres d’histoire prêtent aux douces mains de Charlotte Corday d’avoir perpétré cet acte de cruauté envers l’animal politique qu’était Marat.
Or, ni poignardé ni noyé dans son bain, l’ami du peuple serait mort des suites d’un tabagisme trop actif. C’est, du moins, ce qu’ont montré les historiens de l’art auditionnés par la commission parlementaire réunie l’an passé pour interdire de fumer dans les lieux publics.
Remarquez le paquet de Malborough, qui semble devoir bientôt tomber, comme si tout était figé au souffle de Marat qui est en train de le rendre. Fi des théories esthétiques et de la métaphysique de comptoir : Jacques Louis David ne peignait qu’à condition d’être subventionné par de très grandes marques. On remarquera également, négligemment posé sur le sol, un couteau suisse de la marque Rolex : on a beau être l’ami du peuple, on ne se refuse rien.
Jacques Louis David, Fumer nuit. Huile sur toile, 1794, conservée dans les réserves du musée de l’histoire du Cigare à Issy-les-Moulineaux. Ouvert le mardi et le vendredi de 10 h à 16 h. Sauf jours fériés.
Causeur change
Six mois après sa création, plus de 110 articles publiés et 5000 commentaires postés, causeur évolue. Nouvelle maquette, permettant d’intégrer des espaces publicitaires tout en conservant la lisibilité du site, nouvelles rubriques (brèves, estampes, media party), nouvelles fonctionnalités (imprimer un article, accès aux archives, boutique en ligne, etc.) : le site change dans la continuité. Ce développement s’accompagnera également du lancement de la lettre d’information et d’un rythme de publication plus soutenu.
Made in Goulag
Quelle équipe choisir pour les prochains Jeux Olympiques ? La question est délicate. Soutiendrons-nous celle des Belles âmes (meneur de jeu : Saint Ménard de Reporter Sans Frontières), toujours promptes à exploiter la souffrance des malheureux sans jamais rien changer à leur sort ? Ou bien celle des Esprits forts, qui, à systématiquement dénigrer le politiquement correct, finiront par tolérer tous les malheurs du monde ? Choix difficile, en vérité, dont seul un proverbe chinois pourrait nous libérer : « De deux solutions, la meilleure est souvent la troisième. »
Ignorer l’ampleur de la répression au Tibet est impossible. Depuis 1950, le régime chinois y conduit une politique de colonisation implacable: femmes stérilisées, élites persécutées et exilées, lieux sacrés violés, lieux de mémoire détruits, autochtones discriminés au profit de millions de Hans venus coloniser le « Toit du monde » – et ad nauseum.
Que nous propose-t-on pour nous mettre un terme, ou même simplement un frein, à la volonté du gouvernement de Pékin d’effacer de la carte ce que fut le Tibet ? D’arborer des t-shirts noirs[1. 25 € pièce. Le militantisme a un prix. La bonne conscience aussi : ils sont fabriqués en Inde. Pas par des « intouchables », on le veut croire.] figurant les cinq anneaux olympiques en autant de menottes. Soit. Et puis ? D’appeler au boycott des Jeux Olympiques organisés cet été en Chine, ou à tout le moins de refuser la participation de nos représentants politiques à la cérémonie d’ouverture desdits Jeux. Soit… Et encore ? C’est tout.
C’est tout et c’est peu. Parce que la Russie et les USA y participeront, que des records seront battus, que les médias, vertueux aussi longtemps qu’ils sont privés d’images, en assureront la couverture habituelle. Et que le Tibet, au final, en sortira perdant. Aussi sûrement qu’aura grandi le sentiment d’impunité de Pékin.
Admettons qu’il faille, pour défendre la cause du Tibet, affaiblir la dictature chinoise[2. Faut-il préciser que je parle ici du seul gouvernement chinois et non d’un peuple, aussi vénérable qu’estimable, dont le caractère industrieux serait un exemple profitable à d’autres civilisations profondément malades ? Voir à ce sujet la dernière livraison du National Geographic.]. Encore faudrait-il s’y prendre habilement… Boycotter ? Pourquoi pas. Mais pas les Jeux Olympiques. Ce serait une triple maladresse.
D’abord, parce que ce serait se couper de l’engouement populaire, qui comprend difficilement que l’on « mélange politique et sport » – et la cause du Tibet ne saurait se confondre avec celle, parfaitement crétine, des pourfendeurs du « populisme » : dans la guerre idéologique pour la liberté, il s’agit de mettre les centaines de millions de téléspectateurs, « beaufs » ou non, dans notre poche. Ensuite, parce que ce serait une entorse à nos principes que de refuser de participer à une compétition universelle, où les règles sont les mêmes pour tous et où la dictature chinoise ne pourra ni mentir ni tricher. Enfin, et dans la droite ligne de l’argument précédent, parce que ce serait se priver d’une occasion unique de mettre une raclée aux athlètes idéologiquement modifiés de la dictature chinoise sous le regard du monde entier. Sélectionnés dès l’enfance au mépris de leur dignité d’individus, conditionnés et dopés, réduits à l’état de machine de guerre au service du régime, ces compétiteurs devront s’incliner aussi souvent que possible devant les représentants des pays démocratiques. Souvenons-nous de Jesse Owens aux J.O. de 1936 : ce n’est pas un Noir qui a humilié à Berlin un régime blanc suprématiste en remportant plusieurs médailles d’or, mais le représentant des Etats-Unis qui a démontré sans appel la supériorité de la civilisation libérale, de ses processus de sélection et de formation, sur les fantasmes zoologiques des Nazis. Ne serait que pour cette raison, il faut aller aux J.O. offrir le spectacle le plus plaisant aux amateurs de sport, peuple chinois en tête, et infliger la plus cinglante des défaites au régime chinois, en prouvant que les restrictions politiques qu’il fait endurer à sa population n’ont pas même pour contrepartie la suprématie sportive. Vainqueurs en shorts, nous serons bien plus efficaces et, accessoirement, bien moins ridicules qu’en t-shirt.
Mais revenons au boycott, dont l’idée n’est pas forcément inepte, et oublions un instant l’angélisme mercantile de certaines associations françaises. Quel boycott pourrait servir utilement la cause des Tibétains ? Celui qui nuirait à la dictature chinoise, nous répond-on. Et quel boycott nuirait concrètement à Pékin ? Le boycott économique. Chaque année, des millions de Français dépensent des milliards d’euros pour faire l’acquisition de produits made in China. Ces produits à très faible valeur ajoutée (jouets, pièces de bricolages, éléments de décoration, etc.) ne nous sont en aucun cas indispensables. De plus, ils sont souvent produits dans des conditions sociales détestables, quand ils ne proviennent pas directement de l’économie carcérale – celle des laogai. Un tel boycott, qui stigmatiserait durablement le système politique chinois et l’affaiblirait économiquement, pose à l’évidence un problème de taille : il requiert de la constance dans l’engagement et aurait un coût, puisqu’il faudrait aux « militants » débourser davantage pour faire leurs emplettes auprès de fournisseurs moins compétitifs en terme de prix. Boycotter les produits made in Goulag ? Après des années d’engagement déclamatoire, il ne serait pas outrecuidant de demander aux « citoyens consommateurs » de passer enfin aux travaux pratiques.
Je n’ignore pas l’objection que l’on fera à une telle entreprise. Car il existe un pari de Montesquieu (« Le commerce adoucit les mœurs… ») comme il existe un pari de Laval. Il tient pour acquis qu’à échanger avec les pays qui bafouent les droits de l’homme, si on ne les convertit pas d’emblée à nos valeurs, au moins participe-t-on à l’émergence chez eux de classes moyennes. Lesquelles, tôt ou tard, réclameront les droits politiques correspondant à leur développement économique. La diplomatie allemande résume ce pari par une formule : Wandel durch Handel (le changement par le négoce). Une telle objection ne peut être balayée, forte d’une réalité objective qui écrase l’horizon : en l’espace d’une génération, le gouvernement chinois, aussi critiquable soit-il, aura définitivement éloigné le spectre des famines chroniques et arraché le pays au sous-développement.
Mais, dans l’ordre du pragmatisme, il existe deux autres réalités tout aussi irréfragables : primo, celle de la chronologie. Pour des milliards d’individus, et en l’espèce des centaines de millions de Chinois, l’Histoire c’est ici et maintenant. Sacrifier le présent aux ruses de l’Histoire en marche : nous ne l’acceptons plus de la part des marxistes, allons-nous l’accepter des libre-échangistes ? Secundo, celle de l’effet pervers. Il n’est pas écrit que l’enrichissement des régimes autoritaires aboutisse directement à leur embourgeoisement. Une phase intermédiaire – pour schématiser : des caisses pleines, une agressivité inentamée – doit hélas être envisagée, qui compliquerait nos affaires. C’est très précisément ce qui se passe en Chine, où l’on ne sait qui de la classe moyenne occidentalisée montante ou de l’oligarchie impérialiste[3. Le budget de la Défense augmente en Chine d’environ 20 % par an depuis le début du millénaire. On est en droit de s’interroger sur les motivations de la gérontocratie au pouvoir : s’agit-il d’anticiper une invasion mongole ou une frappe nucléaire tibétaine ? Nul ne peut nier que pour le gouvernement chinois, l’option militaire impériale reste à l’ordre du jour, qu’il s’agisse de mettre au pas Taiwan, d’intimider le Japon et la Corée du Sud, de tenir la dragée haute aux Etats-Unis ou encore de « sécuriser » ses approvisionnements en matières premières.] aura le dernier mot dans les années qui viennent. De même qu’il existe une fitna au cœur de l’islam, il existe un combat entre ces deux Chine, et nous serions bien inspirés de ne pas y prendre part maladroitement.
Or donc, il faut participer aux prochains Jeux Olympiques. Y mettre une tannée aux soldats de Pékin, hisser sur le podium les champions des sociétés libres. Pour nos médaillés friands de symboles, il restera toujours une option, inspirée par le précédent des Jeux de Mexico : brandir, en même temps que l’or, le drapeau frappé du soleil tibétain.
Le LSD est orphelin
Mardi matin, dans la vallée du Leimental, près de Bâle, le petit village de Burg était livré à sa frénésie journalière : chaque foyer remontait avec entrain le coucou domestique, les femmes s’enfiévraient à cuire des poêlées de roesti sur le feu tandis que les hommes astiquaient en chœur de bien beaux lingots.
– Je te dis qu’on nous les a donnés dans les années 1940. Tu sais bien, ces années terribles où la foudre s’est abattue par trois fois sur le chalet de Guschti.
Puis, quand la cloche de onze heures se mit à sonner, le village tout entier stoppa net son effervescence avec une droite exactitude pour se précipiter comme un seul homme à la porte du bon Dr Hofmann.
La Suisse alémanique est un pays de traditions et, à Burg, on ne plaisante pas avec elles. Depuis 1943, l’ancien chimiste de Sandoz distribue quotidiennement de petits morceaux de buvards à ses concitoyens, qui s’empressent de les mâchouiller avant de se livrer collectivement à des rituels ordinaires.
Chaque jour, donc, depuis soixante-cinq ans, le maire organise des votations toutes les quinze minutes sur des sujets de première importance (préparation de l’Expo 2000, investissement de la totalité du budget communal pour relancer Swissair, etc.), on s’enthousiasme pour des lancers de vaches et des lâchers d’enclumes, on attache la doyenne solidement à un arbre pour lui faire le coup du « Souviens-toi, Guillaume Tell », on force le guichetier-chef de la Migrosbank à lever le secret bancaire sur les gros comptes, on le remplace par Jérôme Kiervel puisqu’il n’obtempère pas, on inaugure une statue de Jean Ziegler embrassant sur la bouche Mouamar Khadafi, on donne les premiers coups de pioche sur les contreforts des Alpes pour les raser et voir la mer, on met un terme à la doctrine de la neutralité helvétique pour déclarer la guerre à l’Iran et à la Corée du Nord, on rédige un moratoire pour que l’industrie chimique bâloise ne rejette plus de polluants dans le Rhin puis on se ravise bien vite : à l’impossible nul n’est tenu.
Douze heures plus tard, quand la fatigue gagne les corps et que les esprits se refroidissent, les habitants de Burg rentrent chez eux jouir d’un repos mérité : on remonte le coucou, on réchauffe le roesti et on astique ses lingots.
Seulement, hier, rien ne s’est passé comme à l’accoutumée : à onze heures, par trois fois, on a frappé à l’huis du bon Dr Hofmann. Par trois fois, on n’eut que le silence en guise de réponse. La première à réagir fut la doyenne du village, Heidi Moriz (118 ans), qui rentra sa langue qu’elle maintenait pendante depuis vingt minutes déjà – le temps ne passe pas vite chez nos voisins helvètes, preuve de la maestria horlogère confédérale –, avant de proposer aux plus hardis de pousser la porte. Pour voir.
Hallucinant : le corps sans vie du bon Dr Hofmann gisait sur le sol. Très propre. On pleura poliment et l’on rentra chez soi, en silence, sans même avoir le cœur à étreindre ni coucou ni roesti ni lingot.
Lorsqu’au journal du soir, sur la Schweizer Fernsehen, le village apprit que le bon Dr Hofmann était le père du LSD, la drogue des hippies, ce fut une hallucination encore plus grande. Le lendemain, la descente fut d’autant plus ardue que les journaux du monde entier titraient sur la disparition d’Albert Hofmann. Comment un tel homme avait pu inventer ce produit que les drogués francophones viennent consommer, allongés sur la Platzspitz de Zurich ? Comment avait-il pu cacher ce forfait pendant autant d’années, lui auquel la Schweizerische National Bank aurait ouvert un compte sans confession ?
On se pose encore ce genre de questions à Burg, quand on n’est pas occupé à trouver des coins à champignons. Nul ne sait pourquoi, mais c’est un fait : Burg s’est pris depuis quelques jours d’une passion soudaine pour la mycologie.
Pour ma part, c’est une pensée émue que je voudrais adresser à Albert Hofmann, ce Christophe Colomb de la science, qui chercha un médicament et trouva de la came. Nous sommes certains que Jimi Hendrix, Janis Joplin et Richard Claydermann l’attendent les bras ouverts aux paradis artificiels.
Enfin le journal de Jean-Patrick Manchette !
Un livre où il est dit du mal des Cahiers du cinéma, de François Truffaut, de Jean Vautrin, des maos et des embrayages de 4L ne pouvait être qu’un régal. Ce Journal (1966-1974) de Jean-Patrick Manchette se lit comme le laboratoire de ses polars et de ses chroniques – brillantes et injustes… On se demandait comment l’auteur de romans aussi behavioristes que La position du tireur couché – où toute la psychologie passe par le comportement – pouvait coucher ses émotions. On a la réponse : même dans un Journal dit intime, ses états d’âme sont passés sous silence. Et c’est précisément ce qui confère à ces pages leur tension particulière.
Manchette a appliqué jusqu’à l’extrême la théorie de l’un de ses maîtres, Richard Stark, le créateur de Parker, qui confiait : « Je m’étais dit qu’une façon d’aborder l’émotion dans le genre policier était de la supprimer complètement. » Voilà donc, sous la plume d’un jeune homme de 25 ans à l’univers incroyablement structuré, une éphéméride clinique de la fin des années 60, sur fond de jazz, de cinémathèque, d’orgies de bière et de révolutions avortées. On aura déjà beaucoup dit en signalant que le mois de mai 68 ne compte qu’une seule entrée, plutôt sobre (« Bordel social et politique »). Tout au long de ces pages, maos, trotskystes et autres gauchistes sont fusillés – « Pas de pires flics que les artistes de gauche », observe-t-il (fort précocement ).
Mais la position « politique » de Manchette n’est pas pour autant aisée à identifier : mélange de novlangue structuraliste, d’hégélianisme post-situ, et d’aspirations petites-bourgeoises – dans son trois-pièces de Clamart, l’auteur de Nada tremble à l’idée que du café vienne tacher sa nouvelle moquette « bleu chiné gris »… Peu soucieux de cohérence, il prône l’abolition du travail salarié, de l’Etat et de la propriété privée -qui épargnerait cependant le pavillon qu’il rêve d’offrir à son épouse Mélissa et son fils Tristan… Tant de contradictions, chez ce dialecticien hors-pair, ne pouvaient produire que de bons polars…
Ne nous le cachons pas, ces pages recèlent une dimension people plutôt réjouissante. Durant les quelques années que dure ce Journal, Manchette passe du statut de parfait inconnu usinant pour Max Pécas ou l’ORTF à celui de coqueluche du cinéma français. Le moins que l’on puisse dire est qu’il ne sera pas servi par le grand écran. Mocky s’embourbe dans son adaptation, Chabrol chabrolise Nada, Bernadette Lafont lui offre une demi-brique en liquide sur une table de la Coupole pour un vague projet et Alain Delon s’apprête à massacrer le Petit bleu de la côte ouest. Lui encaisse impavidement les chèques.
Car sa véritable œuvre est ailleurs. Il la rôde entre ces pages. Non que ce Journal paraisse porter en germe le talent d’un immense romancier. Ces longs dégagements théoriques très sûrs d’eux évoquent Roland Barthes dissertant à l’infini sur le roman et incapable, malgré son désir, d’en écrire une page. Manchette, quant à lui, publiera une dizaine de polars ; le dernier, inachevé, La Princesse du sang, étant peut-être son chef d’œuvre. Il a donc réussi la transmutation du plomb « jus-de-cranien » en or romanesque, autrement dit à fabriquer de la littérature avec le fatras intellectuel qui encombre parfois ces pages. On y repère déjà certains des trucs stylistiques qui feront le charme de ses polars : interjections désuètes (« Sapristi ! ») et, surtout, usage des verbes pronominaux et des tournures impersonnelles qui seront la marque de l’écriture behavioriste.
Ce Journal ne reprend que quelques-uns des cahiers noircis au fil des ans par l’auteur de Fatale. On rêve déjà de lire les suivants. Par exemple, les années Mitterrand-Pennac vues par l’agoraphobe Manchette…
Signalons aux manchettophiles la parution d’un numéro spécial de Temps noirs truffé d’inédits.
Augustin sort de confesse
C’est un monument, une montagne que tentent d’escalader, depuis un millénaire et demi, la philosophie par la face nord, la littérature par la face sud et sur laquelle la théologie a planté bien droit son drapeau. L’écrivain Frédéric Boyer avait dirigé, en 2001, chez Bayard, la nouvelle traduction de la Bible. Il récidive en traduisant un texte écrit à la fin du IVe siècle : les Confessions de saint Augustin.
De Maître Eckhart à Luther, de Pascal à Nietzsche, de Rousseau à Blanchot : voilà mille six cents ans que les Confessions sont lues, commentées, interprétées, critiquées, traduites au fil des temps et des époques. Ces lectures et ces réceptions ont patiné le texte, lui conférant une « suave honorabilité » et faisant peser sur lui tout le poids de la tradition. Les traductions françaises ont au mieux fait passer Augustin pour un classique latin – on le traduisait comme on traduit Cicéron ou Tite-Live –, au pire pour l’as des as de la rhétorique, un simili-Bossuet de l’Empire romain finissant.
Frédéric Boyer nous le restitue pour ce qu’il est. Papa (Patricius) est citoyen romain. Maman (Monica) est une fille bien du cru, originaire de ce bled paumé de la province de l’ancienne Numidie qu’est Thagaste. Quant à Aurelius – c’est le petit nom d’Augustin –, c’est un garçon bien de son temps : il connaît ses classiques, il a lu l’Hortensius et la Vetus Africana (une mauvaise traduction de la Bible). On le retrouve professeur de grammaire puis de rhétorique, et c’est à l’esthétique qu’il consacre sa toute première œuvre : De Bono et apto. Mais Augustin a un problème : il manque de suite dans les idées. A peine une nouvelle cause se fait-elle jour qu’il l’embrasse, avec conviction. Quand l’heure est à la numérologie, il se fait numérologue. Quand les astrologues tiennent le haut du pavé, on le voit deviser de Saturne et de Vénus à Carthage et alentours. Les temps sont-ils au manichéisme qu’aussitôt Augustin s’habille en Perse pour revêtir la doctrine de Faustus.
Il lui faut de la nouveauté, de l’air frais, de l’extravagance : s’il avait fréquenté le quartier Latin dans les années 1960 on aurait vu certainement Augustin se déguiser en situ, en mao, en trotsko, en coco voire en gaulliste. Peut-être d’ailleurs les cinq. En même temps – ce qui, au demeurant et au vu de l’histoire contemporaine, n’aurait rien d’une exception.
Et Monica pleure de voir son rejeton aussi changeant et turbulent. Elle aussi doit pester contre cette « pute d’âme humaine » dont est pourvu son fils : on le voit voler des poires (qui vole des poires vole des Nike), mener une mauvaise vie (pas mieux qu’Augustin pour pécho de la tassepé), « tout dépenser par amour des putains » et engrosser une jolie fille qui lui donnera un petit Adeodatus des plus mignons.
Lorsqu’à 46 ans, Augustin écrit les Confessions, ce ne sont pourtant pas ces turpitudes qu’il entend exhiber à la face du monde : n’est pas Christine Angot ou Catherine Millet qui veut. C’est le récit d’un changement et d’une métamorphose, l’itinéraire de sa « pute d’âme humaine » qui va de la mort à la vie, une conversion dans le sens le plus fort du terme.
Certes, s’il devient chrétien, ce n’est pas de gaieté de cœur : c’est surtout pour contenter Maman Monica – pire qu’une mère juive et une mama italienne réunies. Sa conversion est plus profonde que l’adhésion à une nouvelle foi (il en a eu tellement de différentes) : elle est une libération de toutes ses addictions (sexe, fric, drugs, Rolex et Ray ban). Mieux encore : elle extirpe Augustin du simple jeu social dans lequel il se complaît (amants, causeurs, compagnons de beuveries, etc.) pour le placer dans une relation personnelle à Dieu. C’est là une idée neuve. Et c’est, peut-être là, tout le génie de l’augustinisme.
Ainsi les Confessions ne sont-elles pas uniquement des « confessions » : elles sont des aveux. Augustin ne fait pas un simple acte de pénitence : il avoue sa condition de pêcheur, sa condition humaine, cette « insolente pourriture ». Ce faisant, comme l’écrit Frédéric Boyer dans sa préface, Augustin « inscrit alors dans la littérature l’exigence de formulation d’une vérité de soi. Il fait de cette exigence un modèle de fiction vraie, et consacre l’émergence d’une forme littéraire d’enquête morale, ou de questionnement moral sur soi et sa propre existence. Il s’engouffre dans la question : qui suis-je ? »
Dans sa nouvelle traduction des Confessions, Frédéric Boyer nous restitue Augustin tel que nous ne l’avions jamais connu. Il n’est plus ce lointain évêque du IVe siècle dont les volumes mordorés tiennent bonne place dans la Patrologie latine : c’est un fils à maman (après lui, il n’y aura plus, dans le magistère chrétien que des fils à papa), un Romain du nord de l’Afrique, un écrivain d’Outre-Mer, un Latin qui aime tellement sa langue qu’il se permet de la violer et tellement Dieu qu’il le tutoie.
Le souci des animaux
Elisabeth de Fontenay récuse à la fois ceux qui, comme Jean-Marie Shaefer, annoncent « la fin de l’exception humaine » et les tenants d’une exception radicale, les « métaphysiciens anthropomanes ». Aussi cette philosophe rare est-elle un gibier pour les deux camps. Sans offenser le genre humain, son nouvel ouvrage (Albin Michel), est une réplique aux uns comme aux autres.
Comment la question animale est-elle devenue centrale pour vous ? Cet intérêt est-il passé par un amour concret des animaux ?
Bien sûr ! Contrairement à trop de militants de la cause animale qui ne sont que dans la déploration, la plainte, la dénonciation des scandales, j’ai toujours eu un rapport joyeux avec les animaux. Quand j’étais enfant, mon frère et moi passions nos vacances à la ferme. Mon père était un grand chasseur. Je n’ai jamais tenu un fusil mais je suivais la chasse et je n’osais pas être indignée que l’on y tue. Je le suis beaucoup plus aujourd’hui, surtout à la pensée qu’on lâche et qu’on tire des animaux qu’on a élevés, ce qui me semble abominable. Bref, le terreau de mon travail est une familiarité forte avec les bêtes, moins avec les bêtes sauvages qu’avec les bêtes « bien de chez nous ».
Avez-vous pensé que les animaux vous enseigneraient ce qu’est l’homme ?
Quand j’ai écrit Le silence des bêtes, j’essayais de déconstruire cette grande constante métaphysique qu’est la théorie de l’animalité. Mais depuis dix ans, j’ai découvert l’existence de ces puissants mouvements de l’écologie profonde qui tendent à ne considérer l’homme que comme une espèce animale. Entendez-moi bien : il n’est pas question de renoncer au darwinisme et aux acquis de ce qu’on appelle la théorie synthétique de l’évolution, qui, à travers la génétique, la paléoanthropologie, la primatologie, la psychologie cognitive, inscrit l’espèce humaine dans le grand courant continu des vivants. Mais encore faut-il comprendre la petite différence qui a permis à cet animal-là de dominer les autres espèces. C’est ainsi que je me suis interrogée sur ce qui pouvait constituer la singularité de l’homme alors que j’avais tenu, précédemment, à mettre en cause ce qui d’âge en âge se transmet et se transforme sous le titre : propre de l’homme.
Revenons-en à cette petite différence. Si elle ne s’appelle pas l’âme, à quoi tient-elle ?
Il faut être totalement « bête » pour ne pas reconnaître la singularité humaine. Elle tient au fait que l’homme est capable de ce langage articulé et de cet acte de parole qui le fait se déclarer genre humain et proclamer, sur le plan du droit et de la politique, qu’il se pense autrement que comme une espèce parmi les autres espèces. Nous sommes les soi-disant hommes : et il faut prendre « soi-disant » à la lettre et au sérieux. Ce contre quoi je m’élève, c’est la coupure cartésienne et kantienne à partir de laquelle on pense une spécificité humaine radicalement hétérogène à l’être vivant.
Vu que la métaphysique est attaquée de toutes parts, que le sujet n’a pas très bonne presse, ne tirez-vous pas sur une ambulance ?
Tout d’abord, détrompez-vous : la métaphysique classique est toujours au cœur de l’enseignement de la philosophie et de la croyance commune. Et n’oubliez pas les religions. Du reste, en tant que philosophe, justement, je préférerais m’incliner devant la Révélation et la Tradition que devant la métaphysique, car au moins, elles se donnent pour des pensées singulières et non pour un savoir rationnel et universel. Cela dit, je n’ai jamais varié quant à l’affirmation d’une continuité biologique et même psychique entre les hommes et les animaux.
C’est pourtant avec les représentants de l’écologie profonde et autres militants de la cause animale que vous avez le débat le plus violent. Hors de l’observation empirique de la différence humaine, qu’est-ce qui vous distingue d’eux ?
Je conteste l’idée d’un « spécisme » qui serait du même ordre que le racisme. Le racisme consiste en ce que des hommes décrètent que d’autres hommes ne sont pas pleinement ou pas du tout humains. Le spécisme, pour les tenants de l’écologie profonde, signifie que nous, êtres vivants, considérons que d’autres êtres vivants ne méritent pas de vivre au même titre que nous, les hommes. Cette analogie ne fonctionne pas et elle est injuste politiquement. Car, dans la mesure où nous ne relevons pas seulement de l’éthologie mais de l’histoire, donc de la politique, nous sommes profondément différents. Au fond, ce que je récuse, c’est le naturaliste scientiste, le positivisme qui prétend que le développement des neurosciences rendrait caduques l’ethnologie, l’histoire, la psychologie. D’accord, nous avons 99 % de patrimoine génétique en commun avec les chimpanzés. Mais ce qui est né de cette différence de 1 % est inouï, à la fois par sa malfaisance et par sa grandeur éthique !
Une infime différence d’où naît la culture. En somme, il n’y a pas d’essence métaphysique de l’homme mais une singularité qui se manifeste notamment par la capacité d’avoir pitié. Pourquoi pas par l’amour ?
Je ne parlerais pas d’amour au sujet des animaux, car l’amour a à voir avec la parole et avec le geste. Je signale du reste au passage que la perversion baptisée bestialité ou zoophilie connaît, si j’en crois ce qu’on raconte, un développement incroyable sur Internet. Bien entendu la compassion, l’amitié qu’on peut avoir pour un animal ou pour les animaux n’a rien à voir avec la sexualité. Et je suis choquée qu’on puisse parler de crime bestial à propos de crimes sexuels. Les bêtes ne connaissent pas la perversion et ne commettent pas de crimes. Elles sont souvent prédatrices, la nature est cruelle. Raison de plus pour que l’homme s’en distingue par la bienveillance, par un bon vouloir vis-à-vis d’elles.
En fait, vous récusez aussi fermement ce qui s’annonce comme « fin de l’exception humaine » que les tenants d’une exception radicale, ce qui vous vaut d’être attaquée de tous côtés ?
Les militants radicaux de la cause animale me rejettent autant que les métaphysiciens anthropomanes. C’est un juste milieu très inconfortable : je suis un gibier pour les deux camps !
La baby-boum
Et si le monde n’avait pas été créé entre mars et mai 1968 ? Hypothèse sacrilège quand l’objet mémoriel « mai 68” est devenu tellement mythique qu’on ne l’évoque plus que par son petit nom. On dit « 68” comme on dit « 89” ou « 93” (1793, enfin, pas le 9-3).
On l’aura compris, c’est à ce « 68” bardé de guillemets que l’on va s’intéresser ici et non pas à l’événement – si tant est que l’on puisse parler d’événement.
Il s’agit d’interroger cette mythification – ou cette mystification. Peut-on réduire « 68” à quelques slogans et l’interpréter seulement à l’aune de leurs supposées répercussions? Pourquoi tant d’émotions positives ou négatives ? Pourquoi ne parvenons-nous pas à tourner la page de « 68” ainsi que ne cesse de le réclamer Daniel Cohn-Bendit (sans doute contraint par quelque puissance terrible de participer aux innombrables émissions consacrées au joli mois de mai) ?
C’est peut-être dans un étrange silence qu’il faut chercher la signification profonde de ce tintamarre décennal. En effet, alors que la France aime tant les commémorations à chiffres ronds, le quarantième anniversaire de mai 1968 semble avoir totalement effacé le cinquantième anniversaire du 13 mai 1958. La Ve République ne s’intéresse ni à ses origines, ni à son fondateur. L’hôte de l’Elysée se proclame gaulliste et anti-soixante-huitard ; en vérité, il est soixante-huitard et anti-gaulliste.
Derrière cet anniversaire qui en cache un autre, il y a peut-être l’un de ces secrets de famille que l’on s’efforce d’oublier sans jamais y arriver. Avançons l’hypothèse que cette névrose nationale reflète un violent conflit intérieur entre la pesanteur de l’Histoire vécue et la légèreté d’un universel rêvé. D’un côté, la guerre d’Algérie, l’appel au Père, le Général au caractère trempé dans le sang des guerres du passé – en somme, l’histoire concrète du « cher et vieux pays » ; de l’autre, l’amour sans contrainte, le désir au pouvoir, la liberté sans limite (l’un des plus beaux oxymores de l’époque), bref le rêve d’un monde sans frontières, d’une humanité réconciliée judicieusement dépeinte par Philippe Muray sous les espèces de la post-Histoire.
« 68”, c’est la victoire du made in America sur fond de Us go home.
Dans l’imaginaire de la génération baby boom, tout, jusqu’au nom, est importé d’Amérique. Elle grandit dans un monde où la vulgate du travail du pédiatre américain Benjamin Spock fait partie de ces évidences qui constituent le « sens commun ». Les idées de Spock n’étaient pas nécessairement dénuées de pertinence au départ ; remâchées par l’industrie du divertissement, elles engendrent l’enfant-roi des années 50[1. Comment soigner et éduquer son enfant a été publié en France en 1952 par les éditions Marabout et fut un bestseller.]. Lequel deviendra, dans les décennies suivantes, un adulte impérieux et capricieux, peu soucieux d’offrir à ses descendants une place dans le monde.
Entre-temps, les rejetons de la Génération lyrique (titre d’un formidable essai du Canadien François Ricard) se sont adonnés aux joies de la pop music. Ils auront légué au monde l’audacieux concept de « culture jeune », durable eldorado pour marchands de tout. La musique est au cœur de cette identité collective scellée par l’âge. Un phénomène structurant, comme disent les marketeurs. Exemple paradigmatique du phénomène en question, le grand concert gratuit du 22 juin 1963 organisé par Europe n°1 pour le première anniversaire du mensuel Salut les copains, scelle les noces du marché, des médias ; et de l’Amérique[2. Pour une analyse fine et intéressante de ce phénomène, voir Les baby-boomers de Jean-François Sirinelli.]. Les vedettes de la soirée sont Eddy Mitchell et Johnny Hallyday, respectivement Claude Moine et Jean-Philippe Smet. Quelques jours plus tard, Edgar Morin qualifie cette musique de « yé-yé » (francisation de yeah, yeah, le yes américain). Il ne sait peut-être pas à quel point il fait mouche.
Les idées qui forment ce qu’on appelle depuis lors « l’esprit 68” sont également made in USA. Pour l’essentiel, il s’agit d’une compilation hâtive de notions tirées d’Herbert Marcuse, universitaire américain d’origine allemande et prophète du mouvement étudiant sur les campus. Dans la tradition de l’Ecole de Francfort, son analyse critique de la société américaine, donc de toutes les sociétés occidentales de l’époque, conjugue marxisme et psychanalyse pour faire du conflit entre réalité et désir le moteur de l’histoire et de la politique. D’où la place conférée à l’érotisme et à l’imagination. Bien entendu, très peu d’étudiants ont pris la peine de lire Eros et civilisation ou L’homme unidimensionnel, mais les slogans les plus identifiés à « 68” sont bien l’écho dégradé de ces ouvrages.
Logiquement, la Guerre du Vietnam (et non pas la guerre française d’Indochine qui fleure le vieux monde) apporte ce piment indispensable qu’est la contestation. On peut difficilement communier dans la consommation, un peu plus dans la libération sexuelle, mais ce qui légitime l’ensemble, c’est le refus d’un ordre structurellement injuste. Les années 60 laissent sur le ressac le modèle, inoxydable depuis lors, de la « jeunesse en lutte ». Elles inventent par la même occasion les débuts de la subversion en rangs serrés.
Même la figure du mal, donc, vient des campus américains. Le mai 68 français commence le 22 mars, deux jours après l’arrestation d’un étudiant de Nanterre coupable d’avoir brûlé publiquement un drapeau américain au cours d’une manifestation contre la guerre au Vietnam. Cohn-Bendit et ses collègues de Nanterre rebaptisent « Che Guevara » l’amphi de Nanterre dans lequel ils fondent le « mouvement de 22 mars » (rappel volontaire ou non du mouvement du 26 juillet 1954 fondé par Fidel Castro). La référence américaine est souvent agrémentée de couleur locale. Même lorsqu’ils prennent le nom d’Enragés, les étudiants qui battent le pavé parisien voudraient que Nanterre soit Berkeley et Paris San Francisco. Ils ne le savent pas. Leur rêve est américain, c’est-à-dire, croient-ils, universaliste. Il se révèlera platement mondialiste[3. Si les mêmes détestent aujourd’hui l’Amérique, c’est autant parce qu’elle prétend avoir son identité propre qu’à cause du contenu même de cette identité.].
Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi 58 a perdu la guerre des mémoires. Car 58, c’est l’incarnation parfaite du particulier, du Français, de tout ce qui fait de ce pays un phénomène singulier – son histoire. L’agonie de la IVe République est 100% française, tout autant que son dénouement sous les traits de de Gaulle. Français, l’homme de Colombey, la guerre d’Algérie, les ombres du passé, les formidables réussites d’un régime décrié (la reconstruction du pays et les dix premières des Trente Glorieuses). Beaucoup trop français.
La génération lyrique a réussi à escamoter ce qui ne venait pas d’elle, à commencer par la grande victoire républicaine et démocratique que fut 1958. Fait sans précédent en France, une République malade cédait la place à une autre sans passage par un régime autoritaire. Ce ne fut pas seulement l’œuvre d’un homme qui, à 67 ans, n’avait pas l’intention de commencer une « carrière de dictateur », mais aussi celle d’une société et d’une culture politique (celles des « pères ») qui surent éviter une guerre civile et assurer seize années supplémentaires de croissance. Or, sans confort matériel et sans sécurité des biens et des personnes, point de Johnny, ni de SLC, ni de piscine à la fac de Nanterre.
Encouragé par la prétendue « croisade » anti-soixante-huitarde lancée par Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle (croisade qui pour l’essentiel tient en un discours démenti par une foultitude d’actes présidentiels), le cru 2008 du festival 68 est un remake de plus de l’autocélébration d’une génération encensée depuis le berceau. Avant même de venir au monde, les rejetons du baby boom sont porteurs d’un immense espoir. Ne sont-ils pas ces « douze millions de beaux bébés en dix ans » que le Général, en 1945, appelait de ses vœux ? Les bébés de l’espoir deviendront les enfants de la prospérité. Nés trop tard pour 1958, beaucoup connaîtront en leurs premiers émois historiques (et autres) en 1968. Et puisque de ces événements-là, ils auront été non seulement les contemporains, mais les acteurs, ils leur donneront le nom de Révolution. On connaît la suite. Puisqu’ils prétendaient avoir changé le monde, il était bien normal que celui-ci leur appartînt.
Désinternement abusif
En mai 68, Boris Cyrulnik était interne en psychiatrie. Il se souvient d’avoir pendant les événements accompagné un « schizophrène profond » au Quartier Latin. Lequel n’avait pu s’empêcher de prendre la parole lors d’une AG à la Sorbonne. Ce qui devait arriver arriva : l’interminable bouffée délirante du patient en goguette fut accueillie par un non moins interminable tonnerre d’applaudissements. Ce témoignage et beaucoup d’autres, tout aussi décapants (Jean-Pierre Le Goff, Annette Levy-Willard, Jean Claude Barreau), sont à voir mardi 13 à 23 h sur Canal + dans l’excellent doc « Mémoire de mai » de Philippe Harel. Naturellement, Télérama a détesté.
In vino, patatras
Selon Vinexpo, les USA deviendront en 2008 le premier consommateur de vin non pétillant. La France, elle, devra se contenter de la troisième place, derrière l’Italie. On ne sait si c’est là la conséquence logique de la multiplication des lois « hygiéniques », comme celle qui proscrit le tabac dans les lieux publics. Ou bien le fruit des erreurs stratégiques d’une profession bachique, qui avait le choix entre le modèle français du luxe (adaptation sans état d’âme culturel à la mondialisation, façon LVMH) et celui de la haute couture (i.e., défense autiste de la splendeur parisienne… au plus grand profit de Milan). Mais que les « déclinistes » ne se réjouissent pas trop hâtivement ! Selon le Bureau des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC), la France progresse à vitesse grand V en matière de consommation d’une autre « drogue coutumière », pleine d’avenir. Le cannabis.
Fumer nuit

« Violence d’un crime ! Atrocité d’un meurtre ! c’est l’assassinat qu’on assassine » : voilà près de deux cents ans que la critique unanime s’égosille devant ce tableau de Jacques Louis David représentant la mort de Marat. Les livres d’histoire prêtent aux douces mains de Charlotte Corday d’avoir perpétré cet acte de cruauté envers l’animal politique qu’était Marat.
Or, ni poignardé ni noyé dans son bain, l’ami du peuple serait mort des suites d’un tabagisme trop actif. C’est, du moins, ce qu’ont montré les historiens de l’art auditionnés par la commission parlementaire réunie l’an passé pour interdire de fumer dans les lieux publics.
Remarquez le paquet de Malborough, qui semble devoir bientôt tomber, comme si tout était figé au souffle de Marat qui est en train de le rendre. Fi des théories esthétiques et de la métaphysique de comptoir : Jacques Louis David ne peignait qu’à condition d’être subventionné par de très grandes marques. On remarquera également, négligemment posé sur le sol, un couteau suisse de la marque Rolex : on a beau être l’ami du peuple, on ne se refuse rien.
Jacques Louis David, Fumer nuit. Huile sur toile, 1794, conservée dans les réserves du musée de l’histoire du Cigare à Issy-les-Moulineaux. Ouvert le mardi et le vendredi de 10 h à 16 h. Sauf jours fériés.
Causeur change
Six mois après sa création, plus de 110 articles publiés et 5000 commentaires postés, causeur évolue. Nouvelle maquette, permettant d’intégrer des espaces publicitaires tout en conservant la lisibilité du site, nouvelles rubriques (brèves, estampes, media party), nouvelles fonctionnalités (imprimer un article, accès aux archives, boutique en ligne, etc.) : le site change dans la continuité. Ce développement s’accompagnera également du lancement de la lettre d’information et d’un rythme de publication plus soutenu.
Made in Goulag
Quelle équipe choisir pour les prochains Jeux Olympiques ? La question est délicate. Soutiendrons-nous celle des Belles âmes (meneur de jeu : Saint Ménard de Reporter Sans Frontières), toujours promptes à exploiter la souffrance des malheureux sans jamais rien changer à leur sort ? Ou bien celle des Esprits forts, qui, à systématiquement dénigrer le politiquement correct, finiront par tolérer tous les malheurs du monde ? Choix difficile, en vérité, dont seul un proverbe chinois pourrait nous libérer : « De deux solutions, la meilleure est souvent la troisième. »
Ignorer l’ampleur de la répression au Tibet est impossible. Depuis 1950, le régime chinois y conduit une politique de colonisation implacable: femmes stérilisées, élites persécutées et exilées, lieux sacrés violés, lieux de mémoire détruits, autochtones discriminés au profit de millions de Hans venus coloniser le « Toit du monde » – et ad nauseum.
Que nous propose-t-on pour nous mettre un terme, ou même simplement un frein, à la volonté du gouvernement de Pékin d’effacer de la carte ce que fut le Tibet ? D’arborer des t-shirts noirs[1. 25 € pièce. Le militantisme a un prix. La bonne conscience aussi : ils sont fabriqués en Inde. Pas par des « intouchables », on le veut croire.] figurant les cinq anneaux olympiques en autant de menottes. Soit. Et puis ? D’appeler au boycott des Jeux Olympiques organisés cet été en Chine, ou à tout le moins de refuser la participation de nos représentants politiques à la cérémonie d’ouverture desdits Jeux. Soit… Et encore ? C’est tout.
C’est tout et c’est peu. Parce que la Russie et les USA y participeront, que des records seront battus, que les médias, vertueux aussi longtemps qu’ils sont privés d’images, en assureront la couverture habituelle. Et que le Tibet, au final, en sortira perdant. Aussi sûrement qu’aura grandi le sentiment d’impunité de Pékin.
Admettons qu’il faille, pour défendre la cause du Tibet, affaiblir la dictature chinoise[2. Faut-il préciser que je parle ici du seul gouvernement chinois et non d’un peuple, aussi vénérable qu’estimable, dont le caractère industrieux serait un exemple profitable à d’autres civilisations profondément malades ? Voir à ce sujet la dernière livraison du National Geographic.]. Encore faudrait-il s’y prendre habilement… Boycotter ? Pourquoi pas. Mais pas les Jeux Olympiques. Ce serait une triple maladresse.
D’abord, parce que ce serait se couper de l’engouement populaire, qui comprend difficilement que l’on « mélange politique et sport » – et la cause du Tibet ne saurait se confondre avec celle, parfaitement crétine, des pourfendeurs du « populisme » : dans la guerre idéologique pour la liberté, il s’agit de mettre les centaines de millions de téléspectateurs, « beaufs » ou non, dans notre poche. Ensuite, parce que ce serait une entorse à nos principes que de refuser de participer à une compétition universelle, où les règles sont les mêmes pour tous et où la dictature chinoise ne pourra ni mentir ni tricher. Enfin, et dans la droite ligne de l’argument précédent, parce que ce serait se priver d’une occasion unique de mettre une raclée aux athlètes idéologiquement modifiés de la dictature chinoise sous le regard du monde entier. Sélectionnés dès l’enfance au mépris de leur dignité d’individus, conditionnés et dopés, réduits à l’état de machine de guerre au service du régime, ces compétiteurs devront s’incliner aussi souvent que possible devant les représentants des pays démocratiques. Souvenons-nous de Jesse Owens aux J.O. de 1936 : ce n’est pas un Noir qui a humilié à Berlin un régime blanc suprématiste en remportant plusieurs médailles d’or, mais le représentant des Etats-Unis qui a démontré sans appel la supériorité de la civilisation libérale, de ses processus de sélection et de formation, sur les fantasmes zoologiques des Nazis. Ne serait que pour cette raison, il faut aller aux J.O. offrir le spectacle le plus plaisant aux amateurs de sport, peuple chinois en tête, et infliger la plus cinglante des défaites au régime chinois, en prouvant que les restrictions politiques qu’il fait endurer à sa population n’ont pas même pour contrepartie la suprématie sportive. Vainqueurs en shorts, nous serons bien plus efficaces et, accessoirement, bien moins ridicules qu’en t-shirt.
Mais revenons au boycott, dont l’idée n’est pas forcément inepte, et oublions un instant l’angélisme mercantile de certaines associations françaises. Quel boycott pourrait servir utilement la cause des Tibétains ? Celui qui nuirait à la dictature chinoise, nous répond-on. Et quel boycott nuirait concrètement à Pékin ? Le boycott économique. Chaque année, des millions de Français dépensent des milliards d’euros pour faire l’acquisition de produits made in China. Ces produits à très faible valeur ajoutée (jouets, pièces de bricolages, éléments de décoration, etc.) ne nous sont en aucun cas indispensables. De plus, ils sont souvent produits dans des conditions sociales détestables, quand ils ne proviennent pas directement de l’économie carcérale – celle des laogai. Un tel boycott, qui stigmatiserait durablement le système politique chinois et l’affaiblirait économiquement, pose à l’évidence un problème de taille : il requiert de la constance dans l’engagement et aurait un coût, puisqu’il faudrait aux « militants » débourser davantage pour faire leurs emplettes auprès de fournisseurs moins compétitifs en terme de prix. Boycotter les produits made in Goulag ? Après des années d’engagement déclamatoire, il ne serait pas outrecuidant de demander aux « citoyens consommateurs » de passer enfin aux travaux pratiques.
Je n’ignore pas l’objection que l’on fera à une telle entreprise. Car il existe un pari de Montesquieu (« Le commerce adoucit les mœurs… ») comme il existe un pari de Laval. Il tient pour acquis qu’à échanger avec les pays qui bafouent les droits de l’homme, si on ne les convertit pas d’emblée à nos valeurs, au moins participe-t-on à l’émergence chez eux de classes moyennes. Lesquelles, tôt ou tard, réclameront les droits politiques correspondant à leur développement économique. La diplomatie allemande résume ce pari par une formule : Wandel durch Handel (le changement par le négoce). Une telle objection ne peut être balayée, forte d’une réalité objective qui écrase l’horizon : en l’espace d’une génération, le gouvernement chinois, aussi critiquable soit-il, aura définitivement éloigné le spectre des famines chroniques et arraché le pays au sous-développement.
Mais, dans l’ordre du pragmatisme, il existe deux autres réalités tout aussi irréfragables : primo, celle de la chronologie. Pour des milliards d’individus, et en l’espèce des centaines de millions de Chinois, l’Histoire c’est ici et maintenant. Sacrifier le présent aux ruses de l’Histoire en marche : nous ne l’acceptons plus de la part des marxistes, allons-nous l’accepter des libre-échangistes ? Secundo, celle de l’effet pervers. Il n’est pas écrit que l’enrichissement des régimes autoritaires aboutisse directement à leur embourgeoisement. Une phase intermédiaire – pour schématiser : des caisses pleines, une agressivité inentamée – doit hélas être envisagée, qui compliquerait nos affaires. C’est très précisément ce qui se passe en Chine, où l’on ne sait qui de la classe moyenne occidentalisée montante ou de l’oligarchie impérialiste[3. Le budget de la Défense augmente en Chine d’environ 20 % par an depuis le début du millénaire. On est en droit de s’interroger sur les motivations de la gérontocratie au pouvoir : s’agit-il d’anticiper une invasion mongole ou une frappe nucléaire tibétaine ? Nul ne peut nier que pour le gouvernement chinois, l’option militaire impériale reste à l’ordre du jour, qu’il s’agisse de mettre au pas Taiwan, d’intimider le Japon et la Corée du Sud, de tenir la dragée haute aux Etats-Unis ou encore de « sécuriser » ses approvisionnements en matières premières.] aura le dernier mot dans les années qui viennent. De même qu’il existe une fitna au cœur de l’islam, il existe un combat entre ces deux Chine, et nous serions bien inspirés de ne pas y prendre part maladroitement.
Or donc, il faut participer aux prochains Jeux Olympiques. Y mettre une tannée aux soldats de Pékin, hisser sur le podium les champions des sociétés libres. Pour nos médaillés friands de symboles, il restera toujours une option, inspirée par le précédent des Jeux de Mexico : brandir, en même temps que l’or, le drapeau frappé du soleil tibétain.
Le LSD est orphelin
Mardi matin, dans la vallée du Leimental, près de Bâle, le petit village de Burg était livré à sa frénésie journalière : chaque foyer remontait avec entrain le coucou domestique, les femmes s’enfiévraient à cuire des poêlées de roesti sur le feu tandis que les hommes astiquaient en chœur de bien beaux lingots.
– Je te dis qu’on nous les a donnés dans les années 1940. Tu sais bien, ces années terribles où la foudre s’est abattue par trois fois sur le chalet de Guschti.
Puis, quand la cloche de onze heures se mit à sonner, le village tout entier stoppa net son effervescence avec une droite exactitude pour se précipiter comme un seul homme à la porte du bon Dr Hofmann.
La Suisse alémanique est un pays de traditions et, à Burg, on ne plaisante pas avec elles. Depuis 1943, l’ancien chimiste de Sandoz distribue quotidiennement de petits morceaux de buvards à ses concitoyens, qui s’empressent de les mâchouiller avant de se livrer collectivement à des rituels ordinaires.
Chaque jour, donc, depuis soixante-cinq ans, le maire organise des votations toutes les quinze minutes sur des sujets de première importance (préparation de l’Expo 2000, investissement de la totalité du budget communal pour relancer Swissair, etc.), on s’enthousiasme pour des lancers de vaches et des lâchers d’enclumes, on attache la doyenne solidement à un arbre pour lui faire le coup du « Souviens-toi, Guillaume Tell », on force le guichetier-chef de la Migrosbank à lever le secret bancaire sur les gros comptes, on le remplace par Jérôme Kiervel puisqu’il n’obtempère pas, on inaugure une statue de Jean Ziegler embrassant sur la bouche Mouamar Khadafi, on donne les premiers coups de pioche sur les contreforts des Alpes pour les raser et voir la mer, on met un terme à la doctrine de la neutralité helvétique pour déclarer la guerre à l’Iran et à la Corée du Nord, on rédige un moratoire pour que l’industrie chimique bâloise ne rejette plus de polluants dans le Rhin puis on se ravise bien vite : à l’impossible nul n’est tenu.
Douze heures plus tard, quand la fatigue gagne les corps et que les esprits se refroidissent, les habitants de Burg rentrent chez eux jouir d’un repos mérité : on remonte le coucou, on réchauffe le roesti et on astique ses lingots.
Seulement, hier, rien ne s’est passé comme à l’accoutumée : à onze heures, par trois fois, on a frappé à l’huis du bon Dr Hofmann. Par trois fois, on n’eut que le silence en guise de réponse. La première à réagir fut la doyenne du village, Heidi Moriz (118 ans), qui rentra sa langue qu’elle maintenait pendante depuis vingt minutes déjà – le temps ne passe pas vite chez nos voisins helvètes, preuve de la maestria horlogère confédérale –, avant de proposer aux plus hardis de pousser la porte. Pour voir.
Hallucinant : le corps sans vie du bon Dr Hofmann gisait sur le sol. Très propre. On pleura poliment et l’on rentra chez soi, en silence, sans même avoir le cœur à étreindre ni coucou ni roesti ni lingot.
Lorsqu’au journal du soir, sur la Schweizer Fernsehen, le village apprit que le bon Dr Hofmann était le père du LSD, la drogue des hippies, ce fut une hallucination encore plus grande. Le lendemain, la descente fut d’autant plus ardue que les journaux du monde entier titraient sur la disparition d’Albert Hofmann. Comment un tel homme avait pu inventer ce produit que les drogués francophones viennent consommer, allongés sur la Platzspitz de Zurich ? Comment avait-il pu cacher ce forfait pendant autant d’années, lui auquel la Schweizerische National Bank aurait ouvert un compte sans confession ?
On se pose encore ce genre de questions à Burg, quand on n’est pas occupé à trouver des coins à champignons. Nul ne sait pourquoi, mais c’est un fait : Burg s’est pris depuis quelques jours d’une passion soudaine pour la mycologie.
Pour ma part, c’est une pensée émue que je voudrais adresser à Albert Hofmann, ce Christophe Colomb de la science, qui chercha un médicament et trouva de la came. Nous sommes certains que Jimi Hendrix, Janis Joplin et Richard Claydermann l’attendent les bras ouverts aux paradis artificiels.
Enfin le journal de Jean-Patrick Manchette !
Un livre où il est dit du mal des Cahiers du cinéma, de François Truffaut, de Jean Vautrin, des maos et des embrayages de 4L ne pouvait être qu’un régal. Ce Journal (1966-1974) de Jean-Patrick Manchette se lit comme le laboratoire de ses polars et de ses chroniques – brillantes et injustes… On se demandait comment l’auteur de romans aussi behavioristes que La position du tireur couché – où toute la psychologie passe par le comportement – pouvait coucher ses émotions. On a la réponse : même dans un Journal dit intime, ses états d’âme sont passés sous silence. Et c’est précisément ce qui confère à ces pages leur tension particulière.
Manchette a appliqué jusqu’à l’extrême la théorie de l’un de ses maîtres, Richard Stark, le créateur de Parker, qui confiait : « Je m’étais dit qu’une façon d’aborder l’émotion dans le genre policier était de la supprimer complètement. » Voilà donc, sous la plume d’un jeune homme de 25 ans à l’univers incroyablement structuré, une éphéméride clinique de la fin des années 60, sur fond de jazz, de cinémathèque, d’orgies de bière et de révolutions avortées. On aura déjà beaucoup dit en signalant que le mois de mai 68 ne compte qu’une seule entrée, plutôt sobre (« Bordel social et politique »). Tout au long de ces pages, maos, trotskystes et autres gauchistes sont fusillés – « Pas de pires flics que les artistes de gauche », observe-t-il (fort précocement ).
Mais la position « politique » de Manchette n’est pas pour autant aisée à identifier : mélange de novlangue structuraliste, d’hégélianisme post-situ, et d’aspirations petites-bourgeoises – dans son trois-pièces de Clamart, l’auteur de Nada tremble à l’idée que du café vienne tacher sa nouvelle moquette « bleu chiné gris »… Peu soucieux de cohérence, il prône l’abolition du travail salarié, de l’Etat et de la propriété privée -qui épargnerait cependant le pavillon qu’il rêve d’offrir à son épouse Mélissa et son fils Tristan… Tant de contradictions, chez ce dialecticien hors-pair, ne pouvaient produire que de bons polars…
Ne nous le cachons pas, ces pages recèlent une dimension people plutôt réjouissante. Durant les quelques années que dure ce Journal, Manchette passe du statut de parfait inconnu usinant pour Max Pécas ou l’ORTF à celui de coqueluche du cinéma français. Le moins que l’on puisse dire est qu’il ne sera pas servi par le grand écran. Mocky s’embourbe dans son adaptation, Chabrol chabrolise Nada, Bernadette Lafont lui offre une demi-brique en liquide sur une table de la Coupole pour un vague projet et Alain Delon s’apprête à massacrer le Petit bleu de la côte ouest. Lui encaisse impavidement les chèques.
Car sa véritable œuvre est ailleurs. Il la rôde entre ces pages. Non que ce Journal paraisse porter en germe le talent d’un immense romancier. Ces longs dégagements théoriques très sûrs d’eux évoquent Roland Barthes dissertant à l’infini sur le roman et incapable, malgré son désir, d’en écrire une page. Manchette, quant à lui, publiera une dizaine de polars ; le dernier, inachevé, La Princesse du sang, étant peut-être son chef d’œuvre. Il a donc réussi la transmutation du plomb « jus-de-cranien » en or romanesque, autrement dit à fabriquer de la littérature avec le fatras intellectuel qui encombre parfois ces pages. On y repère déjà certains des trucs stylistiques qui feront le charme de ses polars : interjections désuètes (« Sapristi ! ») et, surtout, usage des verbes pronominaux et des tournures impersonnelles qui seront la marque de l’écriture behavioriste.
Ce Journal ne reprend que quelques-uns des cahiers noircis au fil des ans par l’auteur de Fatale. On rêve déjà de lire les suivants. Par exemple, les années Mitterrand-Pennac vues par l’agoraphobe Manchette…
Signalons aux manchettophiles la parution d’un numéro spécial de Temps noirs truffé d’inédits.
Augustin sort de confesse
C’est un monument, une montagne que tentent d’escalader, depuis un millénaire et demi, la philosophie par la face nord, la littérature par la face sud et sur laquelle la théologie a planté bien droit son drapeau. L’écrivain Frédéric Boyer avait dirigé, en 2001, chez Bayard, la nouvelle traduction de la Bible. Il récidive en traduisant un texte écrit à la fin du IVe siècle : les Confessions de saint Augustin.
De Maître Eckhart à Luther, de Pascal à Nietzsche, de Rousseau à Blanchot : voilà mille six cents ans que les Confessions sont lues, commentées, interprétées, critiquées, traduites au fil des temps et des époques. Ces lectures et ces réceptions ont patiné le texte, lui conférant une « suave honorabilité » et faisant peser sur lui tout le poids de la tradition. Les traductions françaises ont au mieux fait passer Augustin pour un classique latin – on le traduisait comme on traduit Cicéron ou Tite-Live –, au pire pour l’as des as de la rhétorique, un simili-Bossuet de l’Empire romain finissant.
Frédéric Boyer nous le restitue pour ce qu’il est. Papa (Patricius) est citoyen romain. Maman (Monica) est une fille bien du cru, originaire de ce bled paumé de la province de l’ancienne Numidie qu’est Thagaste. Quant à Aurelius – c’est le petit nom d’Augustin –, c’est un garçon bien de son temps : il connaît ses classiques, il a lu l’Hortensius et la Vetus Africana (une mauvaise traduction de la Bible). On le retrouve professeur de grammaire puis de rhétorique, et c’est à l’esthétique qu’il consacre sa toute première œuvre : De Bono et apto. Mais Augustin a un problème : il manque de suite dans les idées. A peine une nouvelle cause se fait-elle jour qu’il l’embrasse, avec conviction. Quand l’heure est à la numérologie, il se fait numérologue. Quand les astrologues tiennent le haut du pavé, on le voit deviser de Saturne et de Vénus à Carthage et alentours. Les temps sont-ils au manichéisme qu’aussitôt Augustin s’habille en Perse pour revêtir la doctrine de Faustus.
Il lui faut de la nouveauté, de l’air frais, de l’extravagance : s’il avait fréquenté le quartier Latin dans les années 1960 on aurait vu certainement Augustin se déguiser en situ, en mao, en trotsko, en coco voire en gaulliste. Peut-être d’ailleurs les cinq. En même temps – ce qui, au demeurant et au vu de l’histoire contemporaine, n’aurait rien d’une exception.
Et Monica pleure de voir son rejeton aussi changeant et turbulent. Elle aussi doit pester contre cette « pute d’âme humaine » dont est pourvu son fils : on le voit voler des poires (qui vole des poires vole des Nike), mener une mauvaise vie (pas mieux qu’Augustin pour pécho de la tassepé), « tout dépenser par amour des putains » et engrosser une jolie fille qui lui donnera un petit Adeodatus des plus mignons.
Lorsqu’à 46 ans, Augustin écrit les Confessions, ce ne sont pourtant pas ces turpitudes qu’il entend exhiber à la face du monde : n’est pas Christine Angot ou Catherine Millet qui veut. C’est le récit d’un changement et d’une métamorphose, l’itinéraire de sa « pute d’âme humaine » qui va de la mort à la vie, une conversion dans le sens le plus fort du terme.
Certes, s’il devient chrétien, ce n’est pas de gaieté de cœur : c’est surtout pour contenter Maman Monica – pire qu’une mère juive et une mama italienne réunies. Sa conversion est plus profonde que l’adhésion à une nouvelle foi (il en a eu tellement de différentes) : elle est une libération de toutes ses addictions (sexe, fric, drugs, Rolex et Ray ban). Mieux encore : elle extirpe Augustin du simple jeu social dans lequel il se complaît (amants, causeurs, compagnons de beuveries, etc.) pour le placer dans une relation personnelle à Dieu. C’est là une idée neuve. Et c’est, peut-être là, tout le génie de l’augustinisme.
Ainsi les Confessions ne sont-elles pas uniquement des « confessions » : elles sont des aveux. Augustin ne fait pas un simple acte de pénitence : il avoue sa condition de pêcheur, sa condition humaine, cette « insolente pourriture ». Ce faisant, comme l’écrit Frédéric Boyer dans sa préface, Augustin « inscrit alors dans la littérature l’exigence de formulation d’une vérité de soi. Il fait de cette exigence un modèle de fiction vraie, et consacre l’émergence d’une forme littéraire d’enquête morale, ou de questionnement moral sur soi et sa propre existence. Il s’engouffre dans la question : qui suis-je ? »
Dans sa nouvelle traduction des Confessions, Frédéric Boyer nous restitue Augustin tel que nous ne l’avions jamais connu. Il n’est plus ce lointain évêque du IVe siècle dont les volumes mordorés tiennent bonne place dans la Patrologie latine : c’est un fils à maman (après lui, il n’y aura plus, dans le magistère chrétien que des fils à papa), un Romain du nord de l’Afrique, un écrivain d’Outre-Mer, un Latin qui aime tellement sa langue qu’il se permet de la violer et tellement Dieu qu’il le tutoie.
Le souci des animaux
Elisabeth de Fontenay récuse à la fois ceux qui, comme Jean-Marie Shaefer, annoncent « la fin de l’exception humaine » et les tenants d’une exception radicale, les « métaphysiciens anthropomanes ». Aussi cette philosophe rare est-elle un gibier pour les deux camps. Sans offenser le genre humain, son nouvel ouvrage (Albin Michel), est une réplique aux uns comme aux autres.
Comment la question animale est-elle devenue centrale pour vous ? Cet intérêt est-il passé par un amour concret des animaux ?
Bien sûr ! Contrairement à trop de militants de la cause animale qui ne sont que dans la déploration, la plainte, la dénonciation des scandales, j’ai toujours eu un rapport joyeux avec les animaux. Quand j’étais enfant, mon frère et moi passions nos vacances à la ferme. Mon père était un grand chasseur. Je n’ai jamais tenu un fusil mais je suivais la chasse et je n’osais pas être indignée que l’on y tue. Je le suis beaucoup plus aujourd’hui, surtout à la pensée qu’on lâche et qu’on tire des animaux qu’on a élevés, ce qui me semble abominable. Bref, le terreau de mon travail est une familiarité forte avec les bêtes, moins avec les bêtes sauvages qu’avec les bêtes « bien de chez nous ».
Avez-vous pensé que les animaux vous enseigneraient ce qu’est l’homme ?
Quand j’ai écrit Le silence des bêtes, j’essayais de déconstruire cette grande constante métaphysique qu’est la théorie de l’animalité. Mais depuis dix ans, j’ai découvert l’existence de ces puissants mouvements de l’écologie profonde qui tendent à ne considérer l’homme que comme une espèce animale. Entendez-moi bien : il n’est pas question de renoncer au darwinisme et aux acquis de ce qu’on appelle la théorie synthétique de l’évolution, qui, à travers la génétique, la paléoanthropologie, la primatologie, la psychologie cognitive, inscrit l’espèce humaine dans le grand courant continu des vivants. Mais encore faut-il comprendre la petite différence qui a permis à cet animal-là de dominer les autres espèces. C’est ainsi que je me suis interrogée sur ce qui pouvait constituer la singularité de l’homme alors que j’avais tenu, précédemment, à mettre en cause ce qui d’âge en âge se transmet et se transforme sous le titre : propre de l’homme.
Revenons-en à cette petite différence. Si elle ne s’appelle pas l’âme, à quoi tient-elle ?
Il faut être totalement « bête » pour ne pas reconnaître la singularité humaine. Elle tient au fait que l’homme est capable de ce langage articulé et de cet acte de parole qui le fait se déclarer genre humain et proclamer, sur le plan du droit et de la politique, qu’il se pense autrement que comme une espèce parmi les autres espèces. Nous sommes les soi-disant hommes : et il faut prendre « soi-disant » à la lettre et au sérieux. Ce contre quoi je m’élève, c’est la coupure cartésienne et kantienne à partir de laquelle on pense une spécificité humaine radicalement hétérogène à l’être vivant.
Vu que la métaphysique est attaquée de toutes parts, que le sujet n’a pas très bonne presse, ne tirez-vous pas sur une ambulance ?
Tout d’abord, détrompez-vous : la métaphysique classique est toujours au cœur de l’enseignement de la philosophie et de la croyance commune. Et n’oubliez pas les religions. Du reste, en tant que philosophe, justement, je préférerais m’incliner devant la Révélation et la Tradition que devant la métaphysique, car au moins, elles se donnent pour des pensées singulières et non pour un savoir rationnel et universel. Cela dit, je n’ai jamais varié quant à l’affirmation d’une continuité biologique et même psychique entre les hommes et les animaux.
C’est pourtant avec les représentants de l’écologie profonde et autres militants de la cause animale que vous avez le débat le plus violent. Hors de l’observation empirique de la différence humaine, qu’est-ce qui vous distingue d’eux ?
Je conteste l’idée d’un « spécisme » qui serait du même ordre que le racisme. Le racisme consiste en ce que des hommes décrètent que d’autres hommes ne sont pas pleinement ou pas du tout humains. Le spécisme, pour les tenants de l’écologie profonde, signifie que nous, êtres vivants, considérons que d’autres êtres vivants ne méritent pas de vivre au même titre que nous, les hommes. Cette analogie ne fonctionne pas et elle est injuste politiquement. Car, dans la mesure où nous ne relevons pas seulement de l’éthologie mais de l’histoire, donc de la politique, nous sommes profondément différents. Au fond, ce que je récuse, c’est le naturaliste scientiste, le positivisme qui prétend que le développement des neurosciences rendrait caduques l’ethnologie, l’histoire, la psychologie. D’accord, nous avons 99 % de patrimoine génétique en commun avec les chimpanzés. Mais ce qui est né de cette différence de 1 % est inouï, à la fois par sa malfaisance et par sa grandeur éthique !
Une infime différence d’où naît la culture. En somme, il n’y a pas d’essence métaphysique de l’homme mais une singularité qui se manifeste notamment par la capacité d’avoir pitié. Pourquoi pas par l’amour ?
Je ne parlerais pas d’amour au sujet des animaux, car l’amour a à voir avec la parole et avec le geste. Je signale du reste au passage que la perversion baptisée bestialité ou zoophilie connaît, si j’en crois ce qu’on raconte, un développement incroyable sur Internet. Bien entendu la compassion, l’amitié qu’on peut avoir pour un animal ou pour les animaux n’a rien à voir avec la sexualité. Et je suis choquée qu’on puisse parler de crime bestial à propos de crimes sexuels. Les bêtes ne connaissent pas la perversion et ne commettent pas de crimes. Elles sont souvent prédatrices, la nature est cruelle. Raison de plus pour que l’homme s’en distingue par la bienveillance, par un bon vouloir vis-à-vis d’elles.
En fait, vous récusez aussi fermement ce qui s’annonce comme « fin de l’exception humaine » que les tenants d’une exception radicale, ce qui vous vaut d’être attaquée de tous côtés ?
Les militants radicaux de la cause animale me rejettent autant que les métaphysiciens anthropomanes. C’est un juste milieu très inconfortable : je suis un gibier pour les deux camps !
La baby-boum
Et si le monde n’avait pas été créé entre mars et mai 1968 ? Hypothèse sacrilège quand l’objet mémoriel « mai 68” est devenu tellement mythique qu’on ne l’évoque plus que par son petit nom. On dit « 68” comme on dit « 89” ou « 93” (1793, enfin, pas le 9-3).
On l’aura compris, c’est à ce « 68” bardé de guillemets que l’on va s’intéresser ici et non pas à l’événement – si tant est que l’on puisse parler d’événement.
Il s’agit d’interroger cette mythification – ou cette mystification. Peut-on réduire « 68” à quelques slogans et l’interpréter seulement à l’aune de leurs supposées répercussions? Pourquoi tant d’émotions positives ou négatives ? Pourquoi ne parvenons-nous pas à tourner la page de « 68” ainsi que ne cesse de le réclamer Daniel Cohn-Bendit (sans doute contraint par quelque puissance terrible de participer aux innombrables émissions consacrées au joli mois de mai) ?
C’est peut-être dans un étrange silence qu’il faut chercher la signification profonde de ce tintamarre décennal. En effet, alors que la France aime tant les commémorations à chiffres ronds, le quarantième anniversaire de mai 1968 semble avoir totalement effacé le cinquantième anniversaire du 13 mai 1958. La Ve République ne s’intéresse ni à ses origines, ni à son fondateur. L’hôte de l’Elysée se proclame gaulliste et anti-soixante-huitard ; en vérité, il est soixante-huitard et anti-gaulliste.
Derrière cet anniversaire qui en cache un autre, il y a peut-être l’un de ces secrets de famille que l’on s’efforce d’oublier sans jamais y arriver. Avançons l’hypothèse que cette névrose nationale reflète un violent conflit intérieur entre la pesanteur de l’Histoire vécue et la légèreté d’un universel rêvé. D’un côté, la guerre d’Algérie, l’appel au Père, le Général au caractère trempé dans le sang des guerres du passé – en somme, l’histoire concrète du « cher et vieux pays » ; de l’autre, l’amour sans contrainte, le désir au pouvoir, la liberté sans limite (l’un des plus beaux oxymores de l’époque), bref le rêve d’un monde sans frontières, d’une humanité réconciliée judicieusement dépeinte par Philippe Muray sous les espèces de la post-Histoire.
« 68”, c’est la victoire du made in America sur fond de Us go home.
Dans l’imaginaire de la génération baby boom, tout, jusqu’au nom, est importé d’Amérique. Elle grandit dans un monde où la vulgate du travail du pédiatre américain Benjamin Spock fait partie de ces évidences qui constituent le « sens commun ». Les idées de Spock n’étaient pas nécessairement dénuées de pertinence au départ ; remâchées par l’industrie du divertissement, elles engendrent l’enfant-roi des années 50[1. Comment soigner et éduquer son enfant a été publié en France en 1952 par les éditions Marabout et fut un bestseller.]. Lequel deviendra, dans les décennies suivantes, un adulte impérieux et capricieux, peu soucieux d’offrir à ses descendants une place dans le monde.
Entre-temps, les rejetons de la Génération lyrique (titre d’un formidable essai du Canadien François Ricard) se sont adonnés aux joies de la pop music. Ils auront légué au monde l’audacieux concept de « culture jeune », durable eldorado pour marchands de tout. La musique est au cœur de cette identité collective scellée par l’âge. Un phénomène structurant, comme disent les marketeurs. Exemple paradigmatique du phénomène en question, le grand concert gratuit du 22 juin 1963 organisé par Europe n°1 pour le première anniversaire du mensuel Salut les copains, scelle les noces du marché, des médias ; et de l’Amérique[2. Pour une analyse fine et intéressante de ce phénomène, voir Les baby-boomers de Jean-François Sirinelli.]. Les vedettes de la soirée sont Eddy Mitchell et Johnny Hallyday, respectivement Claude Moine et Jean-Philippe Smet. Quelques jours plus tard, Edgar Morin qualifie cette musique de « yé-yé » (francisation de yeah, yeah, le yes américain). Il ne sait peut-être pas à quel point il fait mouche.
Les idées qui forment ce qu’on appelle depuis lors « l’esprit 68” sont également made in USA. Pour l’essentiel, il s’agit d’une compilation hâtive de notions tirées d’Herbert Marcuse, universitaire américain d’origine allemande et prophète du mouvement étudiant sur les campus. Dans la tradition de l’Ecole de Francfort, son analyse critique de la société américaine, donc de toutes les sociétés occidentales de l’époque, conjugue marxisme et psychanalyse pour faire du conflit entre réalité et désir le moteur de l’histoire et de la politique. D’où la place conférée à l’érotisme et à l’imagination. Bien entendu, très peu d’étudiants ont pris la peine de lire Eros et civilisation ou L’homme unidimensionnel, mais les slogans les plus identifiés à « 68” sont bien l’écho dégradé de ces ouvrages.
Logiquement, la Guerre du Vietnam (et non pas la guerre française d’Indochine qui fleure le vieux monde) apporte ce piment indispensable qu’est la contestation. On peut difficilement communier dans la consommation, un peu plus dans la libération sexuelle, mais ce qui légitime l’ensemble, c’est le refus d’un ordre structurellement injuste. Les années 60 laissent sur le ressac le modèle, inoxydable depuis lors, de la « jeunesse en lutte ». Elles inventent par la même occasion les débuts de la subversion en rangs serrés.
Même la figure du mal, donc, vient des campus américains. Le mai 68 français commence le 22 mars, deux jours après l’arrestation d’un étudiant de Nanterre coupable d’avoir brûlé publiquement un drapeau américain au cours d’une manifestation contre la guerre au Vietnam. Cohn-Bendit et ses collègues de Nanterre rebaptisent « Che Guevara » l’amphi de Nanterre dans lequel ils fondent le « mouvement de 22 mars » (rappel volontaire ou non du mouvement du 26 juillet 1954 fondé par Fidel Castro). La référence américaine est souvent agrémentée de couleur locale. Même lorsqu’ils prennent le nom d’Enragés, les étudiants qui battent le pavé parisien voudraient que Nanterre soit Berkeley et Paris San Francisco. Ils ne le savent pas. Leur rêve est américain, c’est-à-dire, croient-ils, universaliste. Il se révèlera platement mondialiste[3. Si les mêmes détestent aujourd’hui l’Amérique, c’est autant parce qu’elle prétend avoir son identité propre qu’à cause du contenu même de cette identité.].
Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi 58 a perdu la guerre des mémoires. Car 58, c’est l’incarnation parfaite du particulier, du Français, de tout ce qui fait de ce pays un phénomène singulier – son histoire. L’agonie de la IVe République est 100% française, tout autant que son dénouement sous les traits de de Gaulle. Français, l’homme de Colombey, la guerre d’Algérie, les ombres du passé, les formidables réussites d’un régime décrié (la reconstruction du pays et les dix premières des Trente Glorieuses). Beaucoup trop français.
La génération lyrique a réussi à escamoter ce qui ne venait pas d’elle, à commencer par la grande victoire républicaine et démocratique que fut 1958. Fait sans précédent en France, une République malade cédait la place à une autre sans passage par un régime autoritaire. Ce ne fut pas seulement l’œuvre d’un homme qui, à 67 ans, n’avait pas l’intention de commencer une « carrière de dictateur », mais aussi celle d’une société et d’une culture politique (celles des « pères ») qui surent éviter une guerre civile et assurer seize années supplémentaires de croissance. Or, sans confort matériel et sans sécurité des biens et des personnes, point de Johnny, ni de SLC, ni de piscine à la fac de Nanterre.
Encouragé par la prétendue « croisade » anti-soixante-huitarde lancée par Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle (croisade qui pour l’essentiel tient en un discours démenti par une foultitude d’actes présidentiels), le cru 2008 du festival 68 est un remake de plus de l’autocélébration d’une génération encensée depuis le berceau. Avant même de venir au monde, les rejetons du baby boom sont porteurs d’un immense espoir. Ne sont-ils pas ces « douze millions de beaux bébés en dix ans » que le Général, en 1945, appelait de ses vœux ? Les bébés de l’espoir deviendront les enfants de la prospérité. Nés trop tard pour 1958, beaucoup connaîtront en leurs premiers émois historiques (et autres) en 1968. Et puisque de ces événements-là, ils auront été non seulement les contemporains, mais les acteurs, ils leur donneront le nom de Révolution. On connaît la suite. Puisqu’ils prétendaient avoir changé le monde, il était bien normal que celui-ci leur appartînt.