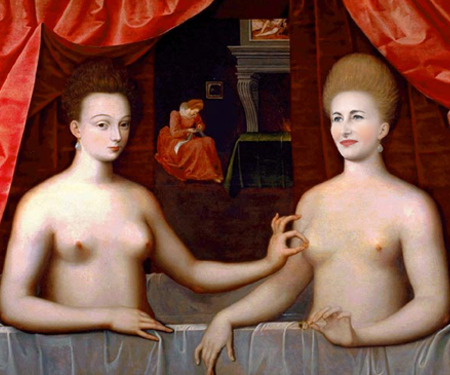En décidant de décerner la Palme d’or au film de Laurent Cantet Entre les murs, le jury du Festival de Cannes, a offert au débat actuel sur l’école et son avenir, une formidable caisse de résonance. Enfin un film qui parle du rapport entre professeurs et élèves, de ses difficultés, de ses écueils. Mais aussi de ses petits bonheurs quotidiens qui font toute la joie d’enseigner, notamment dans ces zones de relégation sociale, ces fameuses ZEP de quartiers sensibles d’où, finalement, semble se dégager une incroyable et rafraîchissante énergie. Celle de cette jeunesse à laquelle fait face le professeur, François Bégaudeau, jouant à l’écran son propre rôle de professeur de français, ce qu’il fut pendant dix ans, à Dreux puis à Paris, dans des établissements difficiles. C’est de son roman, succès de librairie de l’année 2006, qu’est adapté le scénario du film de Laurent Cantet.
Le film est salué par la presse et le milieu du cinéma, notamment parce qu’il est « en prise avec le réel », ainsi que s’en targue Bégaudeau : « J’en avais assez de tous ces livres de profs qui, sous couvert de raconter ce qui se passe, se réduisent à des essais au ton apocalyptique. Ils ne racontent rien, en fait. Ils filtrent la réalité pour la faire correspondre à leurs a priori idéologiques, le plus souvent réactionnaires. » La classe, voilà la réalité, celle du quotidien. Bégaudeau promet de nous donner à voir « la vraie vie d’une classe ordinaire d’aujourd’hui ». Les filtreurs de réalité disent que l’Ecole va mal et nous empêchent donc de rêver éveillés, ils nous empêchent de croire que tout le monde a du talent, que chacun a de formidables qualités qu’il suffirait de faire éclore au grand jour, que de la spontanéité maladroite et un brin charmante de ces élèves puisse sortir quelque chose de positif. J’exagère ? Bégaudeau ne nie pas les difficultés de l’école ; lui l’héritier, le fils d’enseignants, se fait le porte-parole d’un courant de pensée qui récuse la baisse de niveau et avec elle, toute nostalgie dont seraient nécessairement empreints ceux qui pensent qu’il faut donner aux élèves, à tous les élèves, de grands textes et de grands auteurs à connaître. « Il faut les prendre comme ils sont ces élèves », lui fait dire un journaliste du Monde. Ils s’expriment mal, font des fautes de syntaxe à toutes les phrases, ont un vocabulaire très limité ? Donnons-leur à lire ce qu’ils ont envie de lire (c’est déjà bien qu’ils lisent, s’ils lisent), échangeons sur ce qui les intéresse et les touche en premier lieu, ancrons notre enseignement dans leur réalité et non dans un réel abstrait qui aurait pour effet de les braquer, qui agirait comme un repoussoir. C’est touchant, c’est émouvant, c’est généreux.
Curieusement, le roman de Bégaudeau est bien plus « juste » que les propos de son auteur. Entre les Murs ne se complait ni dans le fantasme, ni dans l’idéologie. Bref, l’écrivain Bégaudeau (et sans doute le prof Bégaudeau) est dans le vrai, dans la réalité, dans le réel.
De fait, dans ces établissements sensibles de banlieue (qui depuis une décennie ont aussi essaimé dans les quartiers populaires de Paris), la défaite de l’Ecole se traduit d’abord par une défaite du langage, fort bien dépeinte par l’écrivain dans son roman. Celui-ci sonne vrai, juste. On s’y croirait.
Il pointe ainsi fort habilement la minimisation du langage, la détresse linguistique dans laquelle sont plongés nombre de jeunes gens et ses corollaires, l’incompréhension et la violence. Incompréhension du langage du professeur et au-delà, de ce qui les entoure et du monde extérieur. Les jeunes élèves dont parle Bégaudeau n’envisagent les rapports sociaux que sous l’angle du rapport de force, incapables de se plier à une autorité, comprenant les remarques comme autant de défis, les injonctions comme autant d’agressions. Oui, c’est de cette réalité-là que parle, Bégaudeau, du racisme de certains, de l’antisémitisme de beaucoup, de l’homophobie comme norme. Bref, il décrit ce que nombre de professeurs vivent au quotidien, lesquels, et cela aussi il le montre parfaitement, sont de plus en plus las, fatigués, abandonnés et impuissants face au flot de problèmes qui submerge même les plus aguerris.
Quiconque fréquente les collèges aura un sentiment de déjà-vu en lisant la fin du livre. Celui-ci s’achève par la traditionnelle pièce de théâtre et l’annuel match de foot profs-élèves qui réconcilie tout le monde sur le pré. Oui, le vécu affleure sans cesse du roman de mon ex-collègue : j’y reconnais mon quotidien.
Je n’ai pas vu le film qui ne sortira que le 18 octobre prochain, mais je suis assez perplexe. J’avoue ne pas trouver, ni dans la vraie vie, ni dans les pages d’Entre les murs de quoi me rassurer sur l’avenir, celui de ces gamins comme le nôtre. Alors, qu’est-ce qui peut bien être, dans ce film, si « amazing », comme l’a annoncé Sean Penn ? Qu’est-ce qui mériterait qu’on le montre à tous les élèves dans toutes les écoles, comme l’a demandé à Christine Albanel un journaliste de Canal + ? Qu’est-ce qui semble rassurer tout un petit monde qui vit bien loin de cette fameuse réalité tant louée ? J’ose espérer que ce n’est pas, justement, la réalité.