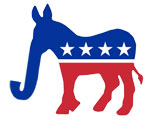C’est, à en croire un reportage de La Repubblica (5 juin), ce qu’on peut lire sur un mur de Gorreto (Ligurie), le village le « plus vieux d’Europe ». Village qui, selon le journaliste, anticiperait le futur de l’Europe : peuplement de vieillards, effondrement des naissances, marasme économique, fuite des (derniers) cerveaux et bien sûr mariages rarissimes (et encore, explique La Repubblica « entre septuagénaires et aides soignantes venues de l’Est »)…
Ma France Culture à moi
A France Culture, on aime le débat. Surtout avec les gens qui pensent comme soi. Enfin, soyons juste. Il n’est pas ici question de tout France Culture mais seulement de l’un de ses producteurs, Frédéric Martel. Frédéric Martel, donc, est un garçon cultivé et travailleur qui officie chaque samedi matin sur France Culture, juste avant Alain Finkielkraut, dans une émission appelée Masse Critique[1. Il ne m’échappe pas que cet aimable garçon m’a succédé à l’antenne de France Culture où l’a nommé David Kessler après m’avoir virée. A ceux qui diront que je livre là une basse vengeance, qu’il me soit permis de répondre par avance : primo, si j’avais voulu me venger, j’aurais trouvé depuis longtemps dans l’émission de Martel de quoi le faire ; deuxio, la logique de cet argument est que je ne saurais critiquer Frédéric Martel puisqu’il occupe la place dont j’ai été chassée : et puis quoi encore ? Tertio, je n’en ai jamais voulu à Martel mais à la direction de France Culture. J’ai même accepté de sa part une aimable invitation à un déjeuner au cours duquel j’ai été fort amusée de l’entendre m’expliquer que, si David Kessler l’avait choisi, lui, pour occuper la case qui avait été la mienne deux ans durant, c’était pour ne pas me peiner.]. Il y a quelques années, il avait montré un certain courage en publiant un ouvrage intitulé Le Rose et le Noir dans lequel il revenait sur la longue marche des homosexuels, tout en rentrant dans le cadre du communautarisme gay. Cela lui avait valu de prendre pas mal de coups – et il faut rappeler qu’à l’époque, et Alain Finkielkraut et votre servante avaient pris sa défense.
Martel a retenu la leçon. Il préfère maintenant être du côté du manche. Samedi dernier, pour annoncer « Répliques », l’émission d’Alain Finkielkraut qui est le fleuron de la chaîne, voilà en effet la petite déclaration dont il s’est fendu, déclaration que chacun peut écouter sur le site : « Aujourd’hui, Alain Finkielkraut débat avec Renaud Camus. Personnellement, je ne trouve pas d’ailleurs qu’il y ait matière à débat avec Renaud Camus, surtout après le livre qu’il vient de publier. Mais c’est un avis très personnel. Allez passons, oublions. Finie l’amertume de la pseudo-déculturation. Et tiens, je vous propose de se quitter avec un bon antidote, généreux, un hymne à la diversité. Et je vous le dis comme je le pense : c’est plutôt ça, ma France à moi, celle que j’aime, et pas celle de Renaud Camus. » On ne s’en étonnera pas : producteur dans une chaîne qui s’appelle France Culture, Frédéric Martel n’a rien trouvé de mieux à opposer à la passionnante réflexion de Camus sur La grande déculturation (Fayard) que la chanson de la grande artiste Diam’s Ma France à moi.
Passons sur cette mauvaise manière faite par un producteur à un autre – encore que c’est sans doute une première. Ce n’est pas à moi qu’il revient de veiller à la confraternité sur l’antenne de France Culture. Oublions même la mauvaise foi caractérisée qui a fait oublier à Martel que, comme c’est le cas dans 90 % de ses émissions, Alain Finkielkraut n’avait pas un invité mais deux, puisque Renaud Camus avait comme contradicteur Stéphane Martin, président du Musée du quai Branly.
Pas de quoi se mettre Martel en tête, dira-t-on. Sans doute. Sauf que son propos ne laisse pas d’être significatif. Monsieur Martel ne trouve pas qu’il y ait matière à débat avec Renaud Camus. Peut-être faut-il en conclure que tous les gens qui ne pensent pas comme Frédéric Martel doivent être réduits au silence. Sans doute Frédéric Martel n’a-t-il pas la chance de connaître le bonheur du désaccord intelligent. Dans le monde de Martel, la tolérance (vertu qu’il croit certainement posséder au plus haut point) a des limites : on ne saurait tolérer que ce que la doxa a défini comme tolérable. A moins qu’il ne s’agisse de basse politique : ayant été lui-même la cible des vigilants, Frédéric Martel a dû en tirer la conclusion qu’il était préférable d’être du côté de la meute que de celui du gibier. Il ira loin, Martel.
Il n’est pas inutile de revenir sur les deux termes dont se prévaut Frédéric Martel – générosité et diversité.
Commençons par la générosité. Entre Frédéric Martel et Renaud Camus, le rapport des forces est on ne peut plus équilibré : d’un côté, le producteur d’une émission hebdomadaire sur France Culture et directeur d’un site d’information (qui, comme gage de son indépendance, bénéficie d’une subvention du secrétariat aux Affaires européennes, sans doute pour son bon esprit) ; de l’autre, un écrivain talentueux mais isolé contre lequel le Tout-Paris s’est déchaîné il y a quelques années, mais qui a le cran de défendre des idées qui ne sont point dans l’air du temps. Quelle générosité, en effet, que celle qui consiste à s’indigner de ce que cet amoureux de la langue soit, pour une fois, invité dans une grande émission sans avoir à craindre un guet-apens ! Et ne parlons pas du courage consistant à livrer un combat gagné d’avance, le tout, bien sûr, en « se la jouant » grand résistant. Comme mutin de Panurge, il est très bien, Frédéric Martel.
Quant à la diversité, on saura désormais qu’elle doit concerner toutes les composantes de la vie à la seule exception des idées. Vive la diversité, à condition que tout le monde pense pareil ! Le pluralisme, ce n’est pas très tendance.
Il fut un temps où France Culture pouvait s’enorgueillir de donner la parole à des individus singuliers capables de penser par eux-mêmes plutôt que d’ânonner les poncifs érigés en vérités. Certes, tous n’ont pas disparu de l’antenne. Je le dis comme je le pense : ma France Culture à moi, c’était celle-là, pas celle de Frédéric Martel.
On a marché sur le Oui
Où qu’il se trouve à présent, notre ami Philippe Muray reste le meilleur chroniqueur de la kafkaïsation de l’Europe. Les Irlandais ne s’y sont pas trompés, qui avaient certainement relu Moderne contre Moderne (Belles Lettres, 2005) avant le référendum :
« De quelque manière qu’on le prenne, le non était plus drôle que le oui. Certes pas le non défendu par les représentants officiels du non, mais le non offert comme une tentation aux électeurs d’en bas aussi bien que d’en haut et même du fond du couloir. Le non comme occasion de rire un bon coup en voyant s’écrouler le château de cartes des notabilités du Juste Milieu, se dégonfler des représentants qui ne représentent plus personne, se fracturer des médiatiques à têtes de logiciel, se lézarder les idoles du cercle vertueux. Le non comme plaisanterie radicale par rapport à un oui tellement sûr de gagner qu’il avait même condescendu à jouer une dernière fois au jeu du oui-ou-non comme on joue avec le feu.
En fin de compte, le non avait été proposé aux Français un peu à la manière dont le Dieu de la Bible laisse à la portée du premier homme, dans le Jardin d’Eden, la possibilité de pécher : en escomptant bien qu’il n’usera pas de cette possibilité. On connaît la suite ; et comment Adam et Eve, dans le dos de Dieu, abusèrent de cette liberté qui leur avait été octroyée. Des milliers et des milliers de pages de théologie découlent de cet épisode originel fracassant qui vit l’usage de la liberté se transformer en péché, et l’exercice de celui-ci devenir tout bonnement l’histoire humaine. C’est ce qu’on appelle le problème du Mal et on n’a toujours pas fini de l’interroger.
Mais les infortunés pèlerins du oui européen sont de bien trop petits démiurges pour qu’on les assimile si peu que ce soit au Créateur (qui dispose d’ailleurs toujours de la grâce pour effacer ce péché). N’empêche que c’est bien un Paradis, si dérisoire soit-il, qu’ils ont voulu fourguer aux électeurs, c’est-à-dire un monde sans dualité structurante, sans conflit, un monde sans non. A quoi les électeurs ont préféré, par leur non, recréer de l’extériorité, de la relativisation, du « désordre » par rapport à un ordre idéal et imposé. Ce désordre ne vaut guère mieux que l’ordre sans alternative qui s’offrait aux suffrages, et il n’est certes pas le recommencement de l’Histoire (ni la renaissance de la France), mais il procède de quelque chose qui a partie liée avec la farce, ce dont ne relevait certes pas le oui macéré dans la pompe et dans l’angélisme (et tourné maintenant à l’aigre, à la haine et au mépris pour ceux qui ont osé voter non). Décidément, quel que soit l’angle sous lequel on le regarde, le non est plus drôle que le oui. Ce n’est pas grand-chose. C’est déjà mieux que rien. C’est en tout cas bien mieux que oui. »
Retrouvez ce texte de Philippe Muray et mille autres pépites sur son réjouissant site.
Moderne contre moderne (Exorcismes spirituels, tome IV)
Price: 25,50 €
31 used & new available from 5,00 €
Ils sont foot, ces Roumains
Hold-up parfait dans la poule C : la Roumanie bat les Pays-Bas, éliminant au passage les champions du monde italiens et les vice-champions du monde français. Les Roumains, des voleurs de pool ?
Vaincre le terrorisme international ? Fastoche !
Et si l’on décrétait que la guerre contre le terrorisme international engagée après le 11 septembre 2001 s’est conclue par une victoire sans appel des démocraties agressées sur Al Qaïda et ses succursales ? Le dirigeant américain ou européen qui oserait proférer cette énormité se verrait immédiatement invité par les commentateurs habituels à ravaler ces paroles sacrilèges, voire à consulter d’urgence un psychiatre. On lui opposerait sur le champ « le bourbier irakien », « l’impasse afghane », « le blocage israélo-palestinien », et les pieds-de-nez audiovisuels réguliers d’Oussama Ben Laden transmis depuis son repaire des zones tribales pakistanaises. S’il objecte qu’aucun attentat de grande ampleur n’a été perpétré hors des zones de conflit depuis celui de Bali, le 1er octobre 2005, on lui rétorquera que « Plus l’on s’éloigne du dernier attentat, plus on se rapproche du suivant… » A l’heure du principe de précaution triomphant, l’optimisme, même relatif, devient une maladie honteuse et se prévaloir d’un réel succès peut vous valoir un procès en obscénité.
Au yeux de certains, les mêmes qui nous invitent lourdement à la repentance pour les abominations commises pendant la période coloniale, l’immoralité même de cette victoire en abolit la réalité: c’est le discours – maintes fois réfuté, mais toujours réitéré – affirmant que le terrorisme est l’arme des faibles, des dominés, qu’il prospère sur le terreau de la misère et de l’oppression. S’il se calme aujourd’hui, c’est pour mieux frapper demain. Sa disparition ne tiendrait qu’à nous, les riches, les nantis, les puissants qui devraient faire une place au soleil et à table pour tous ces miséreux pour qu’ils cessent de venir se faire exploser dans nos métropoles gavées.
Victoire ne signifie pas éradication : il existe bel et bien, dispersées à travers le monde, des cellules terroristes, actives ou dormantes, qui attendent le moment favorable pour commettre leurs méfaits. Les informations qui filtrent des services de lutte anti-terroriste font état régulièrement de démantèlements de réseaux islamistes radicaux, ce qui implique qu’il s’en reconstitue tout aussi régulièrement.
Victoire signifie d’abord que s’est peu à peu imposée une idée aussi simple à exposer que difficile à admettre avant que le traumatisme des twins towers et de leurs trois mille victimes se soit estompé : la guerre totale déclarée à l’Occident impie par Ben Laden et consorts n’a causé que des dommages infinitésimaux à la puissance globale des pays agressés: leur capacité militaire n’en a nullement été affectée, et les dégâts économiques provoqués, principalement dans l’industrie touristique, ont été bien plus rapidement métabolisés que l’éclatement, concomitant, de l’attentat de New York, de la bulle internet.
Les mesures préventives – contrôle accru du trafic aérien, plan Vigipirate, renforcement des services de renseignement – se sont montrées efficaces, même si l’on a dû déplorer les attentats meurtriers de Londres et de Madrid. La crainte de voir se développer des réseaux terroristes « spontanés » parmi les jeunes musulmans fanatisés des métropoles européennes, à l’image des auteurs de l’attentat de Londres, s’est fort heureusement révélée infondée.
Le moral des populations visées n’en a pas été affecté au point de provoquer des mouvements populaires massifs exigeant que l’on cède aux exigences des terroristes, ni que l’on pratique à leur égard et à ceux des pays qui les soutiennent une politique d’apeasement. La seule victoire partielle dont peut se prévaloir Al Qaïda est le retrait précipité du contingent espagnol d’Irak par le gouvernement Zapatero après l’attentat de Madrid.
Daddy, reviens !
Pour sûr, il ne dépareillerait pas en prédicateur évangéliste. Barack Obama a la tête de l’emploi. Il a, d’ailleurs, la tête de tous les emplois. C’est ce qu’il a montré dimanche encore, en s’adressant à Chicago, aux ouailles de l’Apostolic Church of God, à l’occasion de la Fête des Pères.
Ouvrant son discours par une citation du Sermon sur la Montagne, il a célébré à sa manière les vertus familiales dans un propos que ne renierait pas un républicain texan : « Oui, nous avons besoin de plus de flics dans les rues. Oui, nous avons besoin de moins d’armes entre les mains de gens qui ne devraient pas en avoir… Mais nous avons besoin aussi des familles pour élever nos enfants. Nous avons besoin de pères qui prennent conscience que leur responsabilité ne s’arrête pas à la conception. Nous avons besoin qu’ils prennent conscience que ce qui fait un homme n’est pas la capacité d’avoir un gosse, mais le courage de l’éduquer. »
Selon les statistiques avancées par Barack Obama, l’enfant d’une famille monoparentale court cinq fois plus de risques de finir dans la délinquance qu’un enfant élevé par ses deux parents. Obama le dit lui-même sur le ton de la confession publique : il est bien placé pour savoir quelle est l’importance d’un père (à l’âge de deux ans, il a vu le sien quitter sa famille)…
Devant les évangélistes, le portrait qu’il dresse de l’Amérique contemporaine n’est pas rose : « Combien de fois dans les dernières années cette ville a vu des enfants tués par les mains d’autres enfants ? Combien de fois nos cœurs se sont-ils arrêtés de battre en plein milieu de la nuit à cause du bruit d’un coup de feu ou de celui d’une sirène ? Combien d’adolescents avons-nous vu zoner au coin de la rue alors qu’ils auraient dû être en classe ? Combien d’entre eux sont en prison quand ils devraient travailler ou chercher un boulot ? Combien sont-ils, ceux de cette génération qui vont finir dans la pauvreté, la violence ou la drogue ? Combien ? »
Invitant les familles et, plus particulièrement les pères de la communauté afro-américaine, à jouer à nouveau pleinement leur rôle social et éducatif, il va jusqu’à paraphraser ce que disait Kennedy lors de son discours d’investiture le 20 janvier 1961 : « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » La sécurité et la lutte contre la délinquance ne sont plus, pour Barack Obama, le domaine réservé de l’Etat et des pouvoirs publics : ils relèvent de la responsabilité de tous.
Pourtant, à Chicago, Barak Obama n’accomplit aucune rupture. Il se contente de répéter l’un des poncifs les plus rebattus par tous les tribuns de la fierté noire : la black male responsability. Chemin faisant, il reprend également à son compte quelques idées bien senties des « mouvements de pères », comme celui de la Million Father March, un mouvement black né précisément dans la capitale de l’Illinois et militant pour la reconnaissance du rôle paternel dans l’éducation des enfants – imaginez un million d’Aldo Naouri, mais united colors of Benetton et en moins psy.
En déployant à ce moment précis de sa campagne les thèmes sécuritaires et en revalorisant les valeurs familiales, Obama ne droitise donc pas son discours : il ne fait que l’adapter à un auditoire particulièrement sensible au thème du « retour des pères », dans la ville où le taux de criminalité demeure le plus élevé des Etats-Unis.
Ce que l’on retiendra également du discours du candidat démocrate, c’est qu’il n’est pas un lecteur très attentif des éditoriaux du Monde. Il devrait. Ainsi saurait-il que quand un gosse tue un autre gosse comme cela s’est passé à Vitry-le-François, ce n’est pas la faute à l’éducation déficiente ni au cercle familial ni même celle d’un rapport défaillant à l’autorité : c’est la faute au gouvernement, à Mme Amara, à sa ministre de tutelle, Christine Boutin, au « comité interministériel qui devait se tenir le 16 juin » et, en dernier ressort à Nicolas Sarkozy[1. Le Monde, 17 juin 2008.]. Qu’il s’agisse de crimes de droit commun ou de « banlieues en rage », il ne faut jamais, au Monde, se demander ce que l’on peut faire pour son pays, mais ruminer sur ce qu’il ne fait pas pour nous.
Le Father’s Day Speech de Barack Obama
[youtube]Hj1hCDjwG6M[/youtube]
Héroïque Kléber
Heureux Strasbourgeois ! Lieu de passage obligé des écrivains français (une rencontre est organisée chaque jour), la librairie Kléber lance le 19 juin à 19 heures, pour la deuxième année consécutive, le Livre de ma vie : 148 lecteurs, connus et anonymes, y racontent leur coup de foudre littéraire. Loin des catalogues promotionnels, où les nouveautés en vogue sont mises en avant, ce sont les livres de fond qui se taillent la part du lion de ce « catalogue déraisonné ». Causeur.fr est partenaire de l’événement. Un peu de copinage ne nuit pas, surtout quand on a des copains aussi talentueux.
Roses-bruns
Si la presse parisienne a abondamment conspué la « coalition hétéroclite » victorieuse en Irlande, elle s’est montrée beaucoup plus discrète sur l’étonnante alliance passée cette semaine entre le Premier ministre britannique, Gordon Brown et les extrémistes protestants nord-irlandais du Democratic Unionist Party. Sans craindre de diffamer, on peut dire que le DUP et son leader historique, le pasteur Ian Paisley, n’ont pas grand chose à envier au FN et à Le Pen, y compris en matière d’antisémitisme. Pas bégueule, le New Labor leur a fait mille mamours pour faire passer de concert aux Communes une nouvelle loi d’exception anti-terroriste, dont le vote avait été rendu impossible par de nombreuses défections chez les députés de la gauche travailliste…
Quatre garçons dans le vent
Avis aux jeunes chômeurs : un poste d’avenir se dégage en septembre ! Celui de président des « Jeunes Pop » (branche acnéïque de l’UMP[1. Le scoop je le dois, ainsi que les guillemets, à Arnaud Folch, Valeurs Actuelles, 23 mai 2008.]). Dépêchez-vous quand même : il y a déjà quatre candidats. Laissez-moi vous les présenter – par ordre alphabétique, pour n’être pas soupçonné de favoritisme.
Franck Allisio pense (pardon, dit) tout et le contraire : 1) « La droite ne doit pas avoir honte de ses valeurs » ; 2) « Elle a le devoir d’aller vers des idées nouvelles en suivant l’évolution de la société. » En bref, « accompagner le changement », comme Giscard ; et sans savoir précisément où on va, comme d’hab’.
Et puis il y a Mathieu Guillemin, dauphin officiel du précédent « Mister Jeune Pop », brusquement atteint par la limite d’âge dans la fleur du même métal. Mathieu au moins affiche la couleur : n’est-il pas membre actif de Gay Lib, branche armée homo de l’UMP ? Du coup il n’a rien à prouver, et c’est son concurrent, Benjamin Lancar, responsables des « Jeunes Pop » dans les Grandes écoles, qui doit s’y coller.
Le 31 mai dernier donc, pour montrer qu’il n’était pas en reste question « libéralisme sociétal » (au sens delanoïste du terme), l’ami Benjamin a organisé rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie[2. A deux pas du Central, pour les connaisseurs.], entre jeunes umpistes, un débat participatif (au sens royaliste du terme), genre : « Homoparentalité: pour ou con[3. En revanche, rien sur l’after dans le flyer ! C’est aussi ça, la droite…] ? »
Les seuls qui aient accepté, un peu à reculons, de jouer les méchants, c’est les jeunes boutinistes du FRS (?!). Mais il est vrai que ces gens-là n’ont guère à perdre…
Reste David-Xavier Weiss, chouchou des médias et accessoirement chef de cabinet de Roger Karoutchi, qui arrive à dire sans rire : « Je veux être un responsable à l’image de la France, celle des skyblogs et de Radio FG. »
Alors, que choisir : Franck, Mathieu, Benjamin ou David-Xavier ? Qu’importe ? De toute façon, c’est Nicolas Sarkozy qui désignera démocratiquement l’heureux « élu » à la rentrée… A dire vrai ça m’arrange, parce que la nuance m’échappe un peu ; non pas entre les prénoms, mais entre les programmes. Même sur dépliants, je n’arriverais pas à départager ces quatre garçons dans le vent. Il faut dire aussi, à ma décharge, que je suis de moins en moins jeune et que je n’ai jamais été UMP, sans me vanter.
Pourquoi tant de bruit plutôt que rien ?
Heureux pays que la France où tout a une fête, même la philosophie. La sienne, c’est le jour de l’incontournable « bac philo ». Ce jour-là qu’il pleuve, qu’il vente, que la bourse dévisse ou que le pétrole monte, c’est sur la philosophie ou plutôt sur l’épreuve de philosophie du baccalauréat – ce qui, on le verra, n’est pas tout à fait la même chose – que se penche une grande partie des forces vives de l’intelligence médiatique nationale.
Qui dit fête, dit rituel. D’abord l’énoncé des sujets sur lesquels les têtes blondes (et brunes et rousses, etc. ne vexons personne, ou plutôt ne laissons pas la langue française et ses vieilles expressions vexer quiconque) ont dû composer. Une fois les épreuves terminées, des essaims de journalistes attendent les candidats à la sortie des salles d’examen pour leur demander quel sujet ils ont choisi et comment ils s’en sont sorti, i.e. ce qu’ils ont fait et s’ils pensent que c’est ce qu’il fallait faire. Question idiote s’il en est. S’ils avaient pensé qu’il fallait autrement, il y a fort à penser qu’ils eussent fait autrement ! Enfin, des spécialistes sont conviés sur les plateaux de télévision et derrière les microphones des antennes de radiodiffusion pour analyser les sujets, prévenir des pièges et faire croire à tout ce petit monde anxieux et suspendu à leurs lèvres qu’il y avait une copie type qui « avait bon », tout le reste étant faux.
Parfois, l’audace conduit les médias les plus en pointe à inviter un renégat, souvent M. Onfray, qui vient dire tout le mal qu’il pense du baccalauréat, de la philosophie scolaire (qu’il dut fort mal enseigner à en juger par le nombre de bêtises historiques et doctrinales qu’il débite dans ses livres et dans ses cours et par l’image caricaturale qu’il en peint) au grand ravissement des puissances hôtesses de la manifestation. Rituel immuable donc, orné de fioritures très ragoûtantes, telles que l’avis du chanteur présent sur le plateau, celui du présentateur météo, sans oublier, bien sûr, la clausule ironico-distante de l’auteur du petit reportage.
Devons-nous nous réjouir de cette grand-messe, nous autres professeurs de philosophie ? Ne jouissons-nous pas d’un privilège immense au regard de nos collègues des autres disciplines dont on ne connaît jamais les sujets ? Qui se souvient d’avoir jamais entendu l’avis de quiconque sur les sujets d’économie, d’histoire, de mathématique, de physique, d’éducation physique et sportive… ? A peine connaît-on les sujets de français, et encore, il faut un scandale, comme lorsqu’on donna à commenter la chanson de Pierre Perret Lili ?
Pourquoi ne nous réjouissons-nous pas d’un tel privilège ? Pourquoi ne sommes-nous pas heureux le jour de notre fête ? Pourquoi préférerions-nous être très loin ce jour-là ? Sans doute parce que cette fête est trop pincée, trop gênée, sonne trop faux pour qu’on puisse s’en réjouir. Sa vérité est d’ailleurs sans doute dans les questions qu’on adresse à un Onfray dans l’espoir qu’il fera son numéro, ce qu’il ne manque jamais de faire (l’animal est très docile aux commandements des caméras et des microphones) : son mérite à lui est de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas.
En effet, pour tous, cette épreuve est un archaïsme, une bizarrerie dont on ne comprend pas qu’elle n’ait pas déjà été supprimée. C’est cependant une bizarrerie qui fédère : nul n’a oublié ses mauvais souvenirs de l’épreuve de philosophie du baccalauréat et beaucoup ne pardonnent pas la mauvaise note qu’ils obtinrent sans bien comprendre pourquoi. Les questions tordues auxquelles sont soumis les candidats paraissent à ceux-là une torture à laquelle ils sont contents que d’autres soient soumis. Quitte à avoir souffert, autant que d’autres souffrent à leur tour.
Dans tous les reportages, dans tous les commentaires, ce qui s’entend ce n’est pas un questionnement exigeant ni une interrogation profonde, mais un bavardage où ne perce qu’une chose : la haine sourde de la philosophie.
Percent l’incompréhension de la survivance de l’épreuve et de la discipline elle-même (réputée inutile par les élèves, les parents et un grand nombre de collègues), l’incompréhension des questions posées et une certaine animosité contre ce souci de comprendre, d’expliquer et d’interroger qui fait tant défaut aux journalistes, aux professeurs, aux dirigeants politiques, aux syndicalistes, aux dirigeants d’entreprise et à tous les autres, prisonniers qu’ils sont souvent de l’image qu’ils ont de leur fonction et de leur image tout court.
La preuve de cette animosité parfois mêlée d’une certaine fascination, c’est le besoin éprouvé par toute personne à qui vous annoncez votre profession de vous raconter son année de terminale, de vous apprendre sa note en philosophie au baccalauréat quand elle ne vous inflige pas, parfois des années après, le contenu de sa copie. Je ne sache pas que les professeurs de mathématique aient droit à de tels détails, que les avocats aient à subir les confessions des anciens étudiants en droit ni que les écrivains subissent les souvenirs de CP de leurs lecteurs.
Nous autres, professeurs de philosophie, avons souvent l’impression d’être face à des anciens élèves. Le jour du « bac philo », c’est la France entière qui se souvient émue, anxieuse et parfois rageuse, qu’elle dut en passer par des épreuves pour sortir de l’enfance. Ce faisant, redevenue élève, elle bavarde au lieu de penser. Aussi mériterait-elle le coin, comme les enfants pas sages.
Vieux cons : crevez et disparaissez !
C’est, à en croire un reportage de La Repubblica (5 juin), ce qu’on peut lire sur un mur de Gorreto (Ligurie), le village le « plus vieux d’Europe ». Village qui, selon le journaliste, anticiperait le futur de l’Europe : peuplement de vieillards, effondrement des naissances, marasme économique, fuite des (derniers) cerveaux et bien sûr mariages rarissimes (et encore, explique La Repubblica « entre septuagénaires et aides soignantes venues de l’Est »)…
Ma France Culture à moi
A France Culture, on aime le débat. Surtout avec les gens qui pensent comme soi. Enfin, soyons juste. Il n’est pas ici question de tout France Culture mais seulement de l’un de ses producteurs, Frédéric Martel. Frédéric Martel, donc, est un garçon cultivé et travailleur qui officie chaque samedi matin sur France Culture, juste avant Alain Finkielkraut, dans une émission appelée Masse Critique[1. Il ne m’échappe pas que cet aimable garçon m’a succédé à l’antenne de France Culture où l’a nommé David Kessler après m’avoir virée. A ceux qui diront que je livre là une basse vengeance, qu’il me soit permis de répondre par avance : primo, si j’avais voulu me venger, j’aurais trouvé depuis longtemps dans l’émission de Martel de quoi le faire ; deuxio, la logique de cet argument est que je ne saurais critiquer Frédéric Martel puisqu’il occupe la place dont j’ai été chassée : et puis quoi encore ? Tertio, je n’en ai jamais voulu à Martel mais à la direction de France Culture. J’ai même accepté de sa part une aimable invitation à un déjeuner au cours duquel j’ai été fort amusée de l’entendre m’expliquer que, si David Kessler l’avait choisi, lui, pour occuper la case qui avait été la mienne deux ans durant, c’était pour ne pas me peiner.]. Il y a quelques années, il avait montré un certain courage en publiant un ouvrage intitulé Le Rose et le Noir dans lequel il revenait sur la longue marche des homosexuels, tout en rentrant dans le cadre du communautarisme gay. Cela lui avait valu de prendre pas mal de coups – et il faut rappeler qu’à l’époque, et Alain Finkielkraut et votre servante avaient pris sa défense.
Martel a retenu la leçon. Il préfère maintenant être du côté du manche. Samedi dernier, pour annoncer « Répliques », l’émission d’Alain Finkielkraut qui est le fleuron de la chaîne, voilà en effet la petite déclaration dont il s’est fendu, déclaration que chacun peut écouter sur le site : « Aujourd’hui, Alain Finkielkraut débat avec Renaud Camus. Personnellement, je ne trouve pas d’ailleurs qu’il y ait matière à débat avec Renaud Camus, surtout après le livre qu’il vient de publier. Mais c’est un avis très personnel. Allez passons, oublions. Finie l’amertume de la pseudo-déculturation. Et tiens, je vous propose de se quitter avec un bon antidote, généreux, un hymne à la diversité. Et je vous le dis comme je le pense : c’est plutôt ça, ma France à moi, celle que j’aime, et pas celle de Renaud Camus. » On ne s’en étonnera pas : producteur dans une chaîne qui s’appelle France Culture, Frédéric Martel n’a rien trouvé de mieux à opposer à la passionnante réflexion de Camus sur La grande déculturation (Fayard) que la chanson de la grande artiste Diam’s Ma France à moi.
Passons sur cette mauvaise manière faite par un producteur à un autre – encore que c’est sans doute une première. Ce n’est pas à moi qu’il revient de veiller à la confraternité sur l’antenne de France Culture. Oublions même la mauvaise foi caractérisée qui a fait oublier à Martel que, comme c’est le cas dans 90 % de ses émissions, Alain Finkielkraut n’avait pas un invité mais deux, puisque Renaud Camus avait comme contradicteur Stéphane Martin, président du Musée du quai Branly.
Pas de quoi se mettre Martel en tête, dira-t-on. Sans doute. Sauf que son propos ne laisse pas d’être significatif. Monsieur Martel ne trouve pas qu’il y ait matière à débat avec Renaud Camus. Peut-être faut-il en conclure que tous les gens qui ne pensent pas comme Frédéric Martel doivent être réduits au silence. Sans doute Frédéric Martel n’a-t-il pas la chance de connaître le bonheur du désaccord intelligent. Dans le monde de Martel, la tolérance (vertu qu’il croit certainement posséder au plus haut point) a des limites : on ne saurait tolérer que ce que la doxa a défini comme tolérable. A moins qu’il ne s’agisse de basse politique : ayant été lui-même la cible des vigilants, Frédéric Martel a dû en tirer la conclusion qu’il était préférable d’être du côté de la meute que de celui du gibier. Il ira loin, Martel.
Il n’est pas inutile de revenir sur les deux termes dont se prévaut Frédéric Martel – générosité et diversité.
Commençons par la générosité. Entre Frédéric Martel et Renaud Camus, le rapport des forces est on ne peut plus équilibré : d’un côté, le producteur d’une émission hebdomadaire sur France Culture et directeur d’un site d’information (qui, comme gage de son indépendance, bénéficie d’une subvention du secrétariat aux Affaires européennes, sans doute pour son bon esprit) ; de l’autre, un écrivain talentueux mais isolé contre lequel le Tout-Paris s’est déchaîné il y a quelques années, mais qui a le cran de défendre des idées qui ne sont point dans l’air du temps. Quelle générosité, en effet, que celle qui consiste à s’indigner de ce que cet amoureux de la langue soit, pour une fois, invité dans une grande émission sans avoir à craindre un guet-apens ! Et ne parlons pas du courage consistant à livrer un combat gagné d’avance, le tout, bien sûr, en « se la jouant » grand résistant. Comme mutin de Panurge, il est très bien, Frédéric Martel.
Quant à la diversité, on saura désormais qu’elle doit concerner toutes les composantes de la vie à la seule exception des idées. Vive la diversité, à condition que tout le monde pense pareil ! Le pluralisme, ce n’est pas très tendance.
Il fut un temps où France Culture pouvait s’enorgueillir de donner la parole à des individus singuliers capables de penser par eux-mêmes plutôt que d’ânonner les poncifs érigés en vérités. Certes, tous n’ont pas disparu de l’antenne. Je le dis comme je le pense : ma France Culture à moi, c’était celle-là, pas celle de Frédéric Martel.
On a marché sur le Oui
Où qu’il se trouve à présent, notre ami Philippe Muray reste le meilleur chroniqueur de la kafkaïsation de l’Europe. Les Irlandais ne s’y sont pas trompés, qui avaient certainement relu Moderne contre Moderne (Belles Lettres, 2005) avant le référendum :
« De quelque manière qu’on le prenne, le non était plus drôle que le oui. Certes pas le non défendu par les représentants officiels du non, mais le non offert comme une tentation aux électeurs d’en bas aussi bien que d’en haut et même du fond du couloir. Le non comme occasion de rire un bon coup en voyant s’écrouler le château de cartes des notabilités du Juste Milieu, se dégonfler des représentants qui ne représentent plus personne, se fracturer des médiatiques à têtes de logiciel, se lézarder les idoles du cercle vertueux. Le non comme plaisanterie radicale par rapport à un oui tellement sûr de gagner qu’il avait même condescendu à jouer une dernière fois au jeu du oui-ou-non comme on joue avec le feu.
En fin de compte, le non avait été proposé aux Français un peu à la manière dont le Dieu de la Bible laisse à la portée du premier homme, dans le Jardin d’Eden, la possibilité de pécher : en escomptant bien qu’il n’usera pas de cette possibilité. On connaît la suite ; et comment Adam et Eve, dans le dos de Dieu, abusèrent de cette liberté qui leur avait été octroyée. Des milliers et des milliers de pages de théologie découlent de cet épisode originel fracassant qui vit l’usage de la liberté se transformer en péché, et l’exercice de celui-ci devenir tout bonnement l’histoire humaine. C’est ce qu’on appelle le problème du Mal et on n’a toujours pas fini de l’interroger.
Mais les infortunés pèlerins du oui européen sont de bien trop petits démiurges pour qu’on les assimile si peu que ce soit au Créateur (qui dispose d’ailleurs toujours de la grâce pour effacer ce péché). N’empêche que c’est bien un Paradis, si dérisoire soit-il, qu’ils ont voulu fourguer aux électeurs, c’est-à-dire un monde sans dualité structurante, sans conflit, un monde sans non. A quoi les électeurs ont préféré, par leur non, recréer de l’extériorité, de la relativisation, du « désordre » par rapport à un ordre idéal et imposé. Ce désordre ne vaut guère mieux que l’ordre sans alternative qui s’offrait aux suffrages, et il n’est certes pas le recommencement de l’Histoire (ni la renaissance de la France), mais il procède de quelque chose qui a partie liée avec la farce, ce dont ne relevait certes pas le oui macéré dans la pompe et dans l’angélisme (et tourné maintenant à l’aigre, à la haine et au mépris pour ceux qui ont osé voter non). Décidément, quel que soit l’angle sous lequel on le regarde, le non est plus drôle que le oui. Ce n’est pas grand-chose. C’est déjà mieux que rien. C’est en tout cas bien mieux que oui. »
Retrouvez ce texte de Philippe Muray et mille autres pépites sur son réjouissant site.
Moderne contre moderne (Exorcismes spirituels, tome IV)
Price: 25,50 €
31 used & new available from 5,00 €
Ils sont foot, ces Roumains
Hold-up parfait dans la poule C : la Roumanie bat les Pays-Bas, éliminant au passage les champions du monde italiens et les vice-champions du monde français. Les Roumains, des voleurs de pool ?
Vaincre le terrorisme international ? Fastoche !
Et si l’on décrétait que la guerre contre le terrorisme international engagée après le 11 septembre 2001 s’est conclue par une victoire sans appel des démocraties agressées sur Al Qaïda et ses succursales ? Le dirigeant américain ou européen qui oserait proférer cette énormité se verrait immédiatement invité par les commentateurs habituels à ravaler ces paroles sacrilèges, voire à consulter d’urgence un psychiatre. On lui opposerait sur le champ « le bourbier irakien », « l’impasse afghane », « le blocage israélo-palestinien », et les pieds-de-nez audiovisuels réguliers d’Oussama Ben Laden transmis depuis son repaire des zones tribales pakistanaises. S’il objecte qu’aucun attentat de grande ampleur n’a été perpétré hors des zones de conflit depuis celui de Bali, le 1er octobre 2005, on lui rétorquera que « Plus l’on s’éloigne du dernier attentat, plus on se rapproche du suivant… » A l’heure du principe de précaution triomphant, l’optimisme, même relatif, devient une maladie honteuse et se prévaloir d’un réel succès peut vous valoir un procès en obscénité.
Au yeux de certains, les mêmes qui nous invitent lourdement à la repentance pour les abominations commises pendant la période coloniale, l’immoralité même de cette victoire en abolit la réalité: c’est le discours – maintes fois réfuté, mais toujours réitéré – affirmant que le terrorisme est l’arme des faibles, des dominés, qu’il prospère sur le terreau de la misère et de l’oppression. S’il se calme aujourd’hui, c’est pour mieux frapper demain. Sa disparition ne tiendrait qu’à nous, les riches, les nantis, les puissants qui devraient faire une place au soleil et à table pour tous ces miséreux pour qu’ils cessent de venir se faire exploser dans nos métropoles gavées.
Victoire ne signifie pas éradication : il existe bel et bien, dispersées à travers le monde, des cellules terroristes, actives ou dormantes, qui attendent le moment favorable pour commettre leurs méfaits. Les informations qui filtrent des services de lutte anti-terroriste font état régulièrement de démantèlements de réseaux islamistes radicaux, ce qui implique qu’il s’en reconstitue tout aussi régulièrement.
Victoire signifie d’abord que s’est peu à peu imposée une idée aussi simple à exposer que difficile à admettre avant que le traumatisme des twins towers et de leurs trois mille victimes se soit estompé : la guerre totale déclarée à l’Occident impie par Ben Laden et consorts n’a causé que des dommages infinitésimaux à la puissance globale des pays agressés: leur capacité militaire n’en a nullement été affectée, et les dégâts économiques provoqués, principalement dans l’industrie touristique, ont été bien plus rapidement métabolisés que l’éclatement, concomitant, de l’attentat de New York, de la bulle internet.
Les mesures préventives – contrôle accru du trafic aérien, plan Vigipirate, renforcement des services de renseignement – se sont montrées efficaces, même si l’on a dû déplorer les attentats meurtriers de Londres et de Madrid. La crainte de voir se développer des réseaux terroristes « spontanés » parmi les jeunes musulmans fanatisés des métropoles européennes, à l’image des auteurs de l’attentat de Londres, s’est fort heureusement révélée infondée.
Le moral des populations visées n’en a pas été affecté au point de provoquer des mouvements populaires massifs exigeant que l’on cède aux exigences des terroristes, ni que l’on pratique à leur égard et à ceux des pays qui les soutiennent une politique d’apeasement. La seule victoire partielle dont peut se prévaloir Al Qaïda est le retrait précipité du contingent espagnol d’Irak par le gouvernement Zapatero après l’attentat de Madrid.
Daddy, reviens !
Pour sûr, il ne dépareillerait pas en prédicateur évangéliste. Barack Obama a la tête de l’emploi. Il a, d’ailleurs, la tête de tous les emplois. C’est ce qu’il a montré dimanche encore, en s’adressant à Chicago, aux ouailles de l’Apostolic Church of God, à l’occasion de la Fête des Pères.
Ouvrant son discours par une citation du Sermon sur la Montagne, il a célébré à sa manière les vertus familiales dans un propos que ne renierait pas un républicain texan : « Oui, nous avons besoin de plus de flics dans les rues. Oui, nous avons besoin de moins d’armes entre les mains de gens qui ne devraient pas en avoir… Mais nous avons besoin aussi des familles pour élever nos enfants. Nous avons besoin de pères qui prennent conscience que leur responsabilité ne s’arrête pas à la conception. Nous avons besoin qu’ils prennent conscience que ce qui fait un homme n’est pas la capacité d’avoir un gosse, mais le courage de l’éduquer. »
Selon les statistiques avancées par Barack Obama, l’enfant d’une famille monoparentale court cinq fois plus de risques de finir dans la délinquance qu’un enfant élevé par ses deux parents. Obama le dit lui-même sur le ton de la confession publique : il est bien placé pour savoir quelle est l’importance d’un père (à l’âge de deux ans, il a vu le sien quitter sa famille)…
Devant les évangélistes, le portrait qu’il dresse de l’Amérique contemporaine n’est pas rose : « Combien de fois dans les dernières années cette ville a vu des enfants tués par les mains d’autres enfants ? Combien de fois nos cœurs se sont-ils arrêtés de battre en plein milieu de la nuit à cause du bruit d’un coup de feu ou de celui d’une sirène ? Combien d’adolescents avons-nous vu zoner au coin de la rue alors qu’ils auraient dû être en classe ? Combien d’entre eux sont en prison quand ils devraient travailler ou chercher un boulot ? Combien sont-ils, ceux de cette génération qui vont finir dans la pauvreté, la violence ou la drogue ? Combien ? »
Invitant les familles et, plus particulièrement les pères de la communauté afro-américaine, à jouer à nouveau pleinement leur rôle social et éducatif, il va jusqu’à paraphraser ce que disait Kennedy lors de son discours d’investiture le 20 janvier 1961 : « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » La sécurité et la lutte contre la délinquance ne sont plus, pour Barack Obama, le domaine réservé de l’Etat et des pouvoirs publics : ils relèvent de la responsabilité de tous.
Pourtant, à Chicago, Barak Obama n’accomplit aucune rupture. Il se contente de répéter l’un des poncifs les plus rebattus par tous les tribuns de la fierté noire : la black male responsability. Chemin faisant, il reprend également à son compte quelques idées bien senties des « mouvements de pères », comme celui de la Million Father March, un mouvement black né précisément dans la capitale de l’Illinois et militant pour la reconnaissance du rôle paternel dans l’éducation des enfants – imaginez un million d’Aldo Naouri, mais united colors of Benetton et en moins psy.
En déployant à ce moment précis de sa campagne les thèmes sécuritaires et en revalorisant les valeurs familiales, Obama ne droitise donc pas son discours : il ne fait que l’adapter à un auditoire particulièrement sensible au thème du « retour des pères », dans la ville où le taux de criminalité demeure le plus élevé des Etats-Unis.
Ce que l’on retiendra également du discours du candidat démocrate, c’est qu’il n’est pas un lecteur très attentif des éditoriaux du Monde. Il devrait. Ainsi saurait-il que quand un gosse tue un autre gosse comme cela s’est passé à Vitry-le-François, ce n’est pas la faute à l’éducation déficiente ni au cercle familial ni même celle d’un rapport défaillant à l’autorité : c’est la faute au gouvernement, à Mme Amara, à sa ministre de tutelle, Christine Boutin, au « comité interministériel qui devait se tenir le 16 juin » et, en dernier ressort à Nicolas Sarkozy[1. Le Monde, 17 juin 2008.]. Qu’il s’agisse de crimes de droit commun ou de « banlieues en rage », il ne faut jamais, au Monde, se demander ce que l’on peut faire pour son pays, mais ruminer sur ce qu’il ne fait pas pour nous.
Le Father’s Day Speech de Barack Obama
[youtube]Hj1hCDjwG6M[/youtube]
Héroïque Kléber
Heureux Strasbourgeois ! Lieu de passage obligé des écrivains français (une rencontre est organisée chaque jour), la librairie Kléber lance le 19 juin à 19 heures, pour la deuxième année consécutive, le Livre de ma vie : 148 lecteurs, connus et anonymes, y racontent leur coup de foudre littéraire. Loin des catalogues promotionnels, où les nouveautés en vogue sont mises en avant, ce sont les livres de fond qui se taillent la part du lion de ce « catalogue déraisonné ». Causeur.fr est partenaire de l’événement. Un peu de copinage ne nuit pas, surtout quand on a des copains aussi talentueux.
Roses-bruns
Si la presse parisienne a abondamment conspué la « coalition hétéroclite » victorieuse en Irlande, elle s’est montrée beaucoup plus discrète sur l’étonnante alliance passée cette semaine entre le Premier ministre britannique, Gordon Brown et les extrémistes protestants nord-irlandais du Democratic Unionist Party. Sans craindre de diffamer, on peut dire que le DUP et son leader historique, le pasteur Ian Paisley, n’ont pas grand chose à envier au FN et à Le Pen, y compris en matière d’antisémitisme. Pas bégueule, le New Labor leur a fait mille mamours pour faire passer de concert aux Communes une nouvelle loi d’exception anti-terroriste, dont le vote avait été rendu impossible par de nombreuses défections chez les députés de la gauche travailliste…
Quatre garçons dans le vent
Avis aux jeunes chômeurs : un poste d’avenir se dégage en septembre ! Celui de président des « Jeunes Pop » (branche acnéïque de l’UMP[1. Le scoop je le dois, ainsi que les guillemets, à Arnaud Folch, Valeurs Actuelles, 23 mai 2008.]). Dépêchez-vous quand même : il y a déjà quatre candidats. Laissez-moi vous les présenter – par ordre alphabétique, pour n’être pas soupçonné de favoritisme.
Franck Allisio pense (pardon, dit) tout et le contraire : 1) « La droite ne doit pas avoir honte de ses valeurs » ; 2) « Elle a le devoir d’aller vers des idées nouvelles en suivant l’évolution de la société. » En bref, « accompagner le changement », comme Giscard ; et sans savoir précisément où on va, comme d’hab’.
Et puis il y a Mathieu Guillemin, dauphin officiel du précédent « Mister Jeune Pop », brusquement atteint par la limite d’âge dans la fleur du même métal. Mathieu au moins affiche la couleur : n’est-il pas membre actif de Gay Lib, branche armée homo de l’UMP ? Du coup il n’a rien à prouver, et c’est son concurrent, Benjamin Lancar, responsables des « Jeunes Pop » dans les Grandes écoles, qui doit s’y coller.
Le 31 mai dernier donc, pour montrer qu’il n’était pas en reste question « libéralisme sociétal » (au sens delanoïste du terme), l’ami Benjamin a organisé rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie[2. A deux pas du Central, pour les connaisseurs.], entre jeunes umpistes, un débat participatif (au sens royaliste du terme), genre : « Homoparentalité: pour ou con[3. En revanche, rien sur l’after dans le flyer ! C’est aussi ça, la droite…] ? »
Les seuls qui aient accepté, un peu à reculons, de jouer les méchants, c’est les jeunes boutinistes du FRS (?!). Mais il est vrai que ces gens-là n’ont guère à perdre…
Reste David-Xavier Weiss, chouchou des médias et accessoirement chef de cabinet de Roger Karoutchi, qui arrive à dire sans rire : « Je veux être un responsable à l’image de la France, celle des skyblogs et de Radio FG. »
Alors, que choisir : Franck, Mathieu, Benjamin ou David-Xavier ? Qu’importe ? De toute façon, c’est Nicolas Sarkozy qui désignera démocratiquement l’heureux « élu » à la rentrée… A dire vrai ça m’arrange, parce que la nuance m’échappe un peu ; non pas entre les prénoms, mais entre les programmes. Même sur dépliants, je n’arriverais pas à départager ces quatre garçons dans le vent. Il faut dire aussi, à ma décharge, que je suis de moins en moins jeune et que je n’ai jamais été UMP, sans me vanter.
Pourquoi tant de bruit plutôt que rien ?
Heureux pays que la France où tout a une fête, même la philosophie. La sienne, c’est le jour de l’incontournable « bac philo ». Ce jour-là qu’il pleuve, qu’il vente, que la bourse dévisse ou que le pétrole monte, c’est sur la philosophie ou plutôt sur l’épreuve de philosophie du baccalauréat – ce qui, on le verra, n’est pas tout à fait la même chose – que se penche une grande partie des forces vives de l’intelligence médiatique nationale.
Qui dit fête, dit rituel. D’abord l’énoncé des sujets sur lesquels les têtes blondes (et brunes et rousses, etc. ne vexons personne, ou plutôt ne laissons pas la langue française et ses vieilles expressions vexer quiconque) ont dû composer. Une fois les épreuves terminées, des essaims de journalistes attendent les candidats à la sortie des salles d’examen pour leur demander quel sujet ils ont choisi et comment ils s’en sont sorti, i.e. ce qu’ils ont fait et s’ils pensent que c’est ce qu’il fallait faire. Question idiote s’il en est. S’ils avaient pensé qu’il fallait autrement, il y a fort à penser qu’ils eussent fait autrement ! Enfin, des spécialistes sont conviés sur les plateaux de télévision et derrière les microphones des antennes de radiodiffusion pour analyser les sujets, prévenir des pièges et faire croire à tout ce petit monde anxieux et suspendu à leurs lèvres qu’il y avait une copie type qui « avait bon », tout le reste étant faux.
Parfois, l’audace conduit les médias les plus en pointe à inviter un renégat, souvent M. Onfray, qui vient dire tout le mal qu’il pense du baccalauréat, de la philosophie scolaire (qu’il dut fort mal enseigner à en juger par le nombre de bêtises historiques et doctrinales qu’il débite dans ses livres et dans ses cours et par l’image caricaturale qu’il en peint) au grand ravissement des puissances hôtesses de la manifestation. Rituel immuable donc, orné de fioritures très ragoûtantes, telles que l’avis du chanteur présent sur le plateau, celui du présentateur météo, sans oublier, bien sûr, la clausule ironico-distante de l’auteur du petit reportage.
Devons-nous nous réjouir de cette grand-messe, nous autres professeurs de philosophie ? Ne jouissons-nous pas d’un privilège immense au regard de nos collègues des autres disciplines dont on ne connaît jamais les sujets ? Qui se souvient d’avoir jamais entendu l’avis de quiconque sur les sujets d’économie, d’histoire, de mathématique, de physique, d’éducation physique et sportive… ? A peine connaît-on les sujets de français, et encore, il faut un scandale, comme lorsqu’on donna à commenter la chanson de Pierre Perret Lili ?
Pourquoi ne nous réjouissons-nous pas d’un tel privilège ? Pourquoi ne sommes-nous pas heureux le jour de notre fête ? Pourquoi préférerions-nous être très loin ce jour-là ? Sans doute parce que cette fête est trop pincée, trop gênée, sonne trop faux pour qu’on puisse s’en réjouir. Sa vérité est d’ailleurs sans doute dans les questions qu’on adresse à un Onfray dans l’espoir qu’il fera son numéro, ce qu’il ne manque jamais de faire (l’animal est très docile aux commandements des caméras et des microphones) : son mérite à lui est de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas.
En effet, pour tous, cette épreuve est un archaïsme, une bizarrerie dont on ne comprend pas qu’elle n’ait pas déjà été supprimée. C’est cependant une bizarrerie qui fédère : nul n’a oublié ses mauvais souvenirs de l’épreuve de philosophie du baccalauréat et beaucoup ne pardonnent pas la mauvaise note qu’ils obtinrent sans bien comprendre pourquoi. Les questions tordues auxquelles sont soumis les candidats paraissent à ceux-là une torture à laquelle ils sont contents que d’autres soient soumis. Quitte à avoir souffert, autant que d’autres souffrent à leur tour.
Dans tous les reportages, dans tous les commentaires, ce qui s’entend ce n’est pas un questionnement exigeant ni une interrogation profonde, mais un bavardage où ne perce qu’une chose : la haine sourde de la philosophie.
Percent l’incompréhension de la survivance de l’épreuve et de la discipline elle-même (réputée inutile par les élèves, les parents et un grand nombre de collègues), l’incompréhension des questions posées et une certaine animosité contre ce souci de comprendre, d’expliquer et d’interroger qui fait tant défaut aux journalistes, aux professeurs, aux dirigeants politiques, aux syndicalistes, aux dirigeants d’entreprise et à tous les autres, prisonniers qu’ils sont souvent de l’image qu’ils ont de leur fonction et de leur image tout court.
La preuve de cette animosité parfois mêlée d’une certaine fascination, c’est le besoin éprouvé par toute personne à qui vous annoncez votre profession de vous raconter son année de terminale, de vous apprendre sa note en philosophie au baccalauréat quand elle ne vous inflige pas, parfois des années après, le contenu de sa copie. Je ne sache pas que les professeurs de mathématique aient droit à de tels détails, que les avocats aient à subir les confessions des anciens étudiants en droit ni que les écrivains subissent les souvenirs de CP de leurs lecteurs.
Nous autres, professeurs de philosophie, avons souvent l’impression d’être face à des anciens élèves. Le jour du « bac philo », c’est la France entière qui se souvient émue, anxieuse et parfois rageuse, qu’elle dut en passer par des épreuves pour sortir de l’enfance. Ce faisant, redevenue élève, elle bavarde au lieu de penser. Aussi mériterait-elle le coin, comme les enfants pas sages.