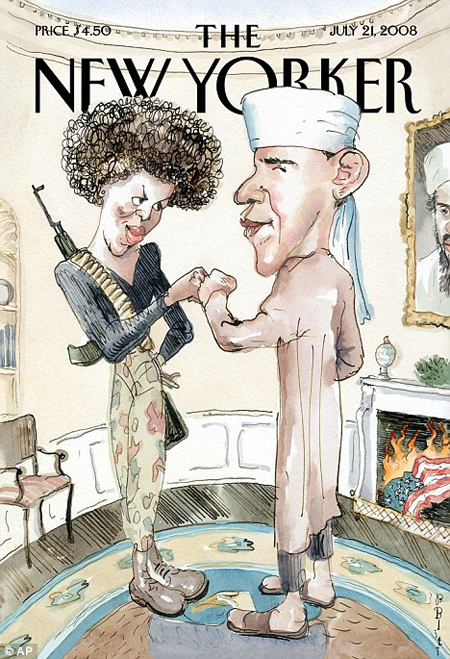Luis Moreno-Ocampo, le procureur de la Cour pénale internationale, a présenté lundi 14 juillet « des éléments de preuve qui démontrent que le Président du Soudan, Omar Al Bachir, a commis des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre au Darfour. En substance, a déclaré le procureur, les motivations du chef de l’Etat soudanais étaient, avant tout, politiques. Il prenait prétexte de la lutte contre l’insurrection pour « mettre un point final à l’histoire des peuples four, masalit et zaghawa… En fait, il visait le génocide ».
Passons sur l’appréciation selon laquelle les motivations du général Al Bachir étaient d’ordre « politique », ce qui semble constituer une circonstance aggravante, pour examiner l’évolution récente de la notion de génocide. En droit, celle-ci désigne « toute entreprise criminelle visant à détruire, en tout ou en partie, un type particulier de groupe humain, comme tel, par certains moyens. L’intention spéciale exigée pour le crime de génocide comporte un double élément : l’acte ou les actes doit (vent) viser un groupe national, ethnique, racial ou religieux ; l’acte ou les actes doit (vent) chercher à détruire tout ou partie de ce groupe. »
Le premier accusé ayant eu à répondre, en Europe, de crimes de génocide est le général Radislav Krstic, l’homme qui commandait les forces serbes lors du massacre de huit mille musulmans bosniaques à Srebrenica, en juillet 1995. « Vous avez consenti au mal… Vous êtes coupable d’avoir consenti au plan d’exécution de masse de tous les hommes [de Srebrenica] en âge de combattre. Vous êtes donc coupable de génocide, Général Krstic », a dit à l’accusé le président du tribunal, le juge Almiro Rodrigues. Rappelons que les femmes, les enfants, les vieillards ont été épargnés et que des blessés ont été évacués. Cela n’excusait évidemment pas ce terrible massacre, mais aurait pu être considéré comme une mesure humanitaire, puisqu’une distinction était faite entre combattants et non-combattants. Ce fut le contraire : cette séparation fut retenue comme élément à charge supplémentaire pour l’incrimination de génocide, puisque les victimes avaient été assassinées pour leur appartenance à un groupe, celui des musulmans bosniaques mâles en âge de porter les armes. Par ailleurs, la seule existence de préparatifs logistiques (véhicules, carburant, matériel pour le creusement des charniers, etc.) y suffisait à prouver l’intention de détruire le groupe, essentielle pour qualifier le génocide, comme on sait.
Mais un crime de masse – quelle guerre n’en connaît pas ? – n’est jamais commis par distraction. Il est le résultat d’une action préparée, donc nécessairement d’une intention. Et un groupe, même lorsqu’il est stable, est toujours une construction arbitraire : il est par définition le produit d’une sélection d’attributs parmi d’autres, comme l’âge, le statut social, la filiation religieuse, la localisation géographique, la pigmentation cutanée et bien d’autres. Sous une telle jurisprudence, tout crime provoquant un « nombre substantiel » de victimes parmi un groupe défini par des critères stables peut être qualifié de génocide. La condamnation de Krstic avait été saluée par nombre d’observateurs et d’organisations de défense des droits de l’Homme comme une avancée de la justice et de la morale. En pratique, elle annonçait que toute guerre peut désormais être considérée comme un génocide, sauf à imaginer de « bons » conflits, armés où l’on se donne rendez-vous en un lieu et un temps donné pour s’affronter comme en un duel. Du Libéria à la Tchétchénie et de la Birmanie aux deux Congo, en passant par le Rwanda et l’Ouganda (dont les dirigeants actuels sont coupables l’un et l’autre de massacres au Congo RDC), les situations pouvant donner lieu à cette incrimination devraient désormais se multiplier. Si l’on suit la logique de la Cour pénale internationale, les guerres d’Espagne, d’Algérie, du Vietnam, d’Afghanistan entre autres, marquées elles aussi par des massacres de civils, l’usage de milices, la torture et les déplacements forcés de population relèvent du crime de génocide. On ne voit pas pourquoi les victimes de ces crimes ne réclameraient pas la reconnaissance de leurs génocides. Le président Bouteflika a commencé, d’autres devraient suivre.
Outre l’inflation judiciaire qu’elle ouvre, le défaut majeur de cette perception des conflits comme « génocides » (ex-Yougoslavie, Soudan, en attendant les suivants) est qu’elle les soustrait à l’histoire et à la politique, pour les soumettre au seul jugement moral. Qualifier une guerre de génocide, c’est quitter le terrain du politique, de ses rapports de forces, de ses compromis et de ses contingences pour se situer dans un au-delà métaphysique où s’affrontent le Bien et le Mal : fanatiques contre modérés, hordes sanguinaires contre civils innocents. Que des massacres aient été perpétrés par le régime soudanais dans le cadre d’une guerre de contre-insurrection, qu’une stratégie de terreur ait été mise en œuvre par l’armée et des milices, ce sont des faits avérés. Qu’il y ait eu intention d’exterminer les peuples du Darfour en tant que tels, voilà qui relève de la spéculation. Comment, si tel était le cas, comprendre le fait que plus de deux millions de Darfouriens se sont regroupés autour des principales villes de garnison de leur province, qu’un million d’entre eux vivent à Khartoum, où ils n’ont jamais été inquiétés tout au long de cette guerre, ou encore qu’un énorme dispositif humanitaire a été mis en place et qu’il a permis d’épargner des dizaines de milliers de vies humaines ? Imagine-t-on des Tutsis cherchant abri auprès des forces armées rwandaises en 1994, ou des juifs auprès de la Wehrmacht en 1943 ? Il est vrai qu’au cours de son intervention au Conseil de sécurité le 5 juin dernier, le procureur est allé jusqu’à parler des camps de réfugiés comme de lieux où se perpétrait le génocide, ce qui est à proprement parler délirant. Ces manifestations d’incontinence intellectuelle ne sont pas les premières en ce qui concerne le Darfour, et celui-ci n’en a pas le monopole, bien qu’il les suscite en nombre. Reste qu’avec de tels arguments au service d’une telle incrimination, la qualification juridique et la compréhension politique se séparent radicalement au point que la première fait écran à la seconde. On peut se demander ce que signifie le droit dans de telles conditions.
Il y a fort à parier, de plus, que les protagonistes du conflit durcissent maintenant leurs positions. Les mouvements rebelles ont le sentiment justifié d’avoir emporté une bataille et n’ont aucune raison de s’arrêter là. Qui pourrait leur reprocher de ne pas vouloir négocier avec un régime génocidaire ? Qui pourrait les critiquer de lancer des attaques qui seront nécessairement considérées comme de la légitime défense ? Cet encouragement au combat enclencherait alors un nouveau cycle de violences et de représailles dont les conséquences seraient humainement et politiquement désastreuses. Les défenseurs de la Cour pénale internationale font valoir, non sans raison, que nul n’en sait rien à ce stade, et que cette décision pourrait au contraire entraîner une mise à l’écart des durs du régime, au profit d’une faction modérée. Quand bien même cette hypothèse peu probable serait la bonne, le problème politique posé par cette qualification resterait entier.
C’est maintenant aux juges de la Cour pénale internationale de décider de la suite à donner. Rien ne dit qu’ils vont émettre le mandat d’arrêt demandé par le procureur. S’ils le faisaient, le Conseil de sécurité aurait encore la possibilité, prévue dans les statuts de la cour, de suspendre les poursuites pour une durée d’un an renouvelable. Autant dire qu’en pratique, il y a loin de la requête du procureur au prétoire. D’autant plus que la Chine et la Russie ne sont probablement pas seules, au Conseil de sécurité, à vouloir stopper la procédure. Les Etats-Unis pourraient bien aller dans ce sens également, dans le but de préserver leur coopération avec les services secrets de Khartoum, partenaire important de la lutte contre le terrorisme.