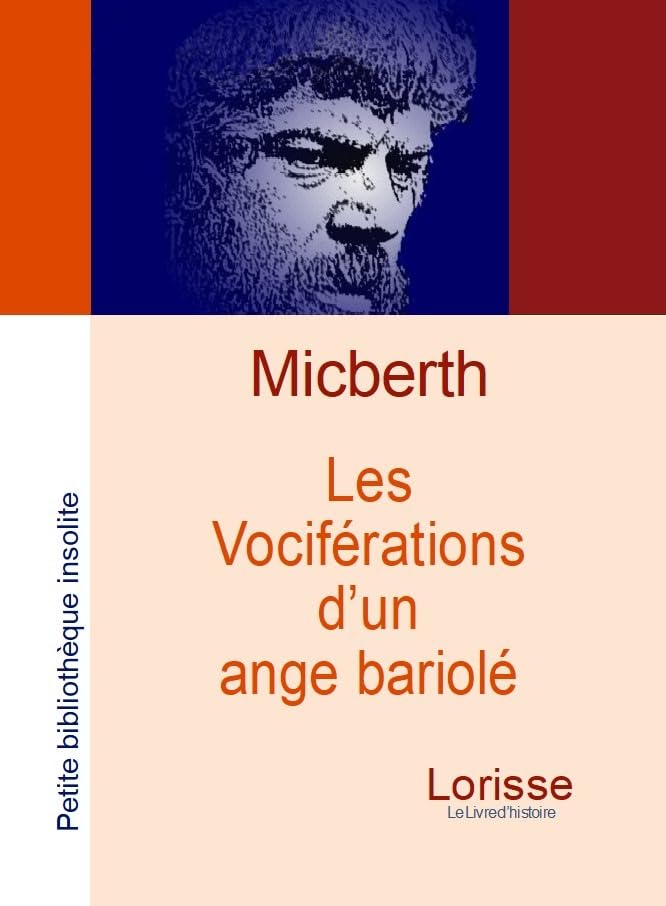Il n’y a pas que les activités illégales et le narcotrafic qui alimentent les réseaux terroristes, nous apprend la sénatrice UDI de l’Orne
Causeur. Madame la sénatrice, votre livre L’argent du terrorisme soulève des questions cruciales sur le financement des activités terroristes. Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage ?
Nathalie Goulet. À partir de 2011-2012, j’ai commencé à travailler sur la délinquance financière et la fraude fiscale. En 2014, j’ai lu un livre de David Thompson, journaliste, sur les Français djihadistes, notamment ceux qui se convertissaient à l’islam pour partir en Syrie et en Irak. J’ai alors réalisé que nous ne disposions pas des outils juridiques nécessaires pour lutter contre cette nouvelle menace. J’ai donc demandé et obtenu, en juin 2014, la création d’une commission d’enquête sur les réseaux djihadistes, soit six mois avant les attentats de Charlie Hebdo.
En travaillant à la fois sur la fraude fiscale, l’évasion fiscale et le terrorisme, j’ai découvert qu’au croisement de ces deux domaines se trouvait le financement du terrorisme. En réalité, les terroristes exploitent les réseaux de la criminalité financière. Pendant la pandémie de Covid-19, lorsque les activités se sont ralenties, j’ai décidé de consolider tout le travail accumulé au fil des années : rapports, amendements, et une quinzaine d’années de travail parlementaire. Cela m’a semblé important.
Initialement, j’avais l’intention d’écrire un livre classique sur le financement du terrorisme, mais je n’y suis pas parvenue. Finalement, j’ai opté pour un format de dictionnaire, car il me paraissait plus clair et accessible. C’est ainsi qu’est née la version 2022 de L’Abécédaire du financement du terrorisme, que j’ai mise à jour cette année sous le titre L’argent du terrorisme. Bien que ce livre se concentre sur le terrorisme, les mécanismes et outils décrits sont les mêmes que ceux utilisés dans la grande criminalité financière.
Après les attentats de Charlie Hebdo, avez-vous observé un changement dans la politique et les actions menées au Sénat et à l’Assemblée nationale sur ces questions ?
Absolument. Le budget du ministère de l’Intérieur pour le Projet de loi de finances pour 2015, voté en novembre 2014, ne mentionnait même pas le mot « terrorisme ». J’étais alors intervenue au Sénat pour souligner que, bien que ce budget soit bon, il n’était pas adapté aux nouveaux défis auxquels nous faisions face. Nous étions donc avant les attentats de Charlie Hebdo. Après Charlie Hebdo et les attaques du Bataclan, la France a dépensé près d’un milliard d’euros pour rééquiper les forces de police, réorganiser les services de renseignement et sensibiliser les agents. Plusieurs lois ont été votées, notamment sur l’état d’urgence, dont certaines dispositions ont ensuite été intégrées dans le droit commun. Les coopérations internationale et européenne se sont considérablement améliorées. Les avancées les plus significatives dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sont d’ailleurs survenues parce qu’il était nécessaire de lutter contre le financement du terrorisme, créant ainsi un cercle vertueux.
Quels sont les mécanismes les plus courants que vous avez identifiés en matière de financement du terrorisme ?
Je parlerais plutôt des mécanismes les plus ordinaires, c’est-à-dire ceux de notre vie quotidienne détournés à des fins criminelles :
- Les cagnottes en ligne : une fois l’argent collecté, il peut être détourné de ses objectifs initiaux. Les services de renseignement surveillent désormais de près ces cagnottes.
- La contrefaçon : ce phénomène est mal connu. L’achat de produits contrefaits (vêtements, médicaments, pièces détachées, jouets) alimente souvent les réseaux criminels et terroristes. Par exemple, le Hezbollah se finance en partie par la vente de faux produits, y compris des faux médicaments comme le Viagra, générant des millions de dollars chaque mois.
- Le trafic de migrants : l’afflux de migrants en Europe alimente également des réseaux criminels dont une partie des bénéfices peut financer des activités terroristes.
En 2023, en France, 20 millions de produits contrefaits ont été retirés du marché : jouets, vêtements, produits de soin, denrées alimentaires… La contrefaçon coûte 26 milliards d’euros par an aux industries européennes, représentant 2,5 % du commerce mondial, soit 652 milliards de dollars. Cette forme de criminalité est particulièrement attractive pour les réseaux terroristes car les sanctions sont bien moins sévères que celles appliquées au trafic de drogue ou d’armes. Ce déséquilibre rend cette activité d’autant plus rentable.
En somme, ces mécanismes montrent que le financement du terrorisme repose souvent sur des activités économiques apparemment anodines mais aux conséquences profondes et inquiétantes.
Le terrorisme est donc aussi en lien avec le trafic d’êtres humains et de migrants ?
Le trafic d’êtres humains génère entre 5,5 et 7 milliards de dollars par an. C’est donc un marché énorme, dont fait partie, bien sûr, le trafic de migrants. Nous disposons de chiffres qui ne sont pas tout à fait récents. Dans la zone ouest, le passage d’un migrant coûte environ 2500 euros. Sur la route centrale, c’est 2220 euros. Quant à l’est de la Méditerranée, cela s’élève à 2200 euros. Cette année, plus de 4000 passeurs ont été arrêtés. Oui, 4000 passeurs ! Il y a une vaste opération d’Interpol qui s’appelle « Liberterra II », ayant conduit à 2500 arrestations l’année dernière, avec un procès-verbal du 6 novembre 2024. C’est donc tout récent.
Effectivement, il y a un lien direct entre le financement du terrorisme et le trafic de migrants. C’est particulièrement vrai avec Daesh, qui non seulement a organisé le trafic de migrants, mais a aussi orchestré un trafic d’organes. Ils ont émis une fatwa autorisant le prélèvement d’organes sur des apostats pour en faire profiter un musulman, considérant cela comme vertueux, ce qui a constitué un financement de leur économie.
Concernant le démantèlement des réseaux de trafic d’êtres humains, nous avons récemment eu de nombreux chiffres. Par exemple, en Espagne, le 23 février dernier, un réseau de trafic impliquant un millier de femmes colombiennes et vénézuéliennes a été démantelé. Et il y a aussi eu un trafic d’organes.
J’ai un autre chiffre à partager : en avril 2024, un réseau irako-palestinien a été arrêté à la frontière polonaise avec la Biélorussie. 36 membres de ce réseau ont été interpellés. L’enquête a révélé qu’en examinant les flux financiers, la somme des crypto-actifs s’élevait à 581 millions de dollars. De plus, les procureurs ont détecté un virement de 30 millions de dollars vers le Hezbollah et 13 millions vers le Djihad islamique palestinien.
Quelle est l’importance des crypto-monnaies dans le financement du crime organisé ?
Il s’agit d’un vecteur majeur, surtout qu’elles permettent de contourner facilement les sanctions internationales. L’Iran, la Russie, et d’autres pays utilisent largement les crypto-monnaies. Gaza et le Hezbollah, entre autres, en ont largement bénéficié. TRACFIN, notre service de renseignement financier, dispose désormais d’une équipe dédiée aux crypto-actifs. En outre, le texte sur la lutte contre le narcotrafic que nous avons récemment voté prévoit notamment de saisir des crypto-monnaies dans le cadre de certaines infractions. L’Europe a mis en place des directives, comme MiCA, pour un meilleur contrôle des crypto-actifs, mais je suis sceptique quant à leur efficacité, tout comme je suis assez critique envers les futures directives qui risquent, selon moi, de créer une cacophonie, laissant les fraudeurs continuer leur activité.
Sur ce point j’appelle à une action d’ampleur nationale pour la formation des responsables de la sécurité, police, gendarmerie, mais aussi des élus qui n’ont pas encore bien appréhendé ce phénomène qui est incontournable et doivent être en mesure de la comprendre pour mieux réprimer la fraude qui peut en découler de l’utilisation des crytos. Je prends le pari que moins d’un parlementaire sur 10 est capable de vous expliquer la blockchain…
Que pouvez-vous faire pour participer à la lutte du financement du terrorisme à votre échelle ?
Mon livre sera disponible en plusieurs langues, dont l’arabe et l’anglais. Il sort la semaine prochaine en arabe. Mon éditeur arabe a même choisi une illustration percutante pour la couverture, un dessin d’Emmanuel Chaunu – ce qui devrait avoir un bon impact. Le livre sera vendu principalement en ligne.
Il est parfois très difficile de se faire entendre sur des sujets comme la fraude et l’évasion fiscale, qui sont complexes et difficiles à appréhender. La commission d’enquête sur le narcotrafic a permis d’écrire des éléments intéressants, mais beaucoup de points étaient déjà bien connus de ceux qui travaillent sur ces questions. D’ailleurs, le rapport de cette commission d’enquête affirme qu’il n’est pas prouvé que la drogue finance le terrorisme, ce qui va à l’encontre de ce que le ministre de l’Intérieur avait affirmé. Cependant, je trouve que le travail de la commission a été un électrochoc salutaire.
En ce qui concerne le terrorisme qui est financé par la fraude, s’agit-il d’organisations terroristes, assez structurées, qui opèrent par exemple au Moyen-Orient, en Asie, ou est-ce qu’on parle aussi d’un certain financement des terroristes en Europe ? Et est-ce qu’il y a aussi de l’argent qui va dans le trésor d’organisations à tendance séparatiste, comme les Frères musulmans ?
Il y a bien sûr des financements qui vont à des organisations terroristes comme le Hamas, le Hezbollah, Boko Haram, Al-Qaïda. Ceux-ci sont identifiables. Mais, il existe aussi des financements, y compris en Europe, qui vont vers des organismes liés aux Frères musulmans. Ce ne sont pas des organisations terroristes à proprement parler, mais elles prônent des idées séparatistes. Et ce séparatisme est dangereux car il est très inflammable. Prenons l’exemple du tourisme halal. En théorie, il peut sembler acceptable : vous pouvez vouloir manger halal, porter un voile ou pratiquer votre foi comme vous l’entendez, ce qui est tout à fait respectable. Cependant, sur le terrain, dans certains endroits, comme en Ouzbékistan, où l’islam n’a pas une place aussi prépondérante, j’ai pu observer des phénomènes inquiétants. Par exemple, il y a quelques années, ils servaient de la vodka dans des théières pour ne pas exposer les bouteilles d’alcool. Et l’année dernière, dans un restaurant où je vais régulièrement, un panneau indiquait « halal ». Ce genre de phénomène peut facilement déstabiliser des sociétés où la culture et la religion sont en jeu, et alimenter des tensions qui préparent le terrain pour des radicalisations futures. Le chiffre d’affaires du tourisme halal atteint 126 milliards en 2022 avec une projection à 174 milliards de $ pour 2027. C’est un élément de séparatisme : ce n’est pas critiquable en soi, mais cela nourrit quelque chose qui est contraire à ce qui fait la société.
Quant aux Frères musulmans, j’y consacre un long article cette année. Lorsqu’on observe le nombre d’atteintes à la laïcité, le nombre d’incidents, comme cette personne assassinée l’année dernière pendant le ramadan simplement parce qu’elle buvait. C’est une forme de police des mœurs. Les organisations comme les Frères musulmans testent constamment la solidité de la République et ses limites. Et ces derniers sont malheureusement financés avec nos impôts parfois, et aussi par l’Union européenne. Au nom de la diversité, on finance nos propres ennemis !
La France peut-elle éradiquer le financement du terrorisme ?
D’abord, il faut que ce soit une action internationale, sinon cela ne fonctionnera pas. Ensuite, avec les fractures sociales actuelles, il est extrêmement difficile de faire entendre un discours cohérent.
Il y a le binôme Darmanin-Retailleau, qui représente une sorte de « dream team » sur la question du narcotrafic, mais cela ne suffira pas, parce qu’il faut des moyens de renseignement, des moyens judiciaires, des moyens policiers, de gendarmerie, ainsi que des moyens carcéraux.
Il faut travailler, non seulement sur le narcotrafic, mais sur le blanchiment d’argent et donc sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale qui sont au cœur de plusieurs dispositifs. Toute cette criminalité, qui semble parfois sans victime, est présente à l’échelle nationale, européenne et mondiale. Cela pose des problèmes diplomatiques car, par exemple, quand le président Trump prend la décision de supprimer l’identification des bénéficiaires effectifs des entreprises et libère totalement les crypto-actifs, on arrive dans un système complètement dérégulé. Cette dérégulation profite à des intérêts internationaux. En France, 12% des Français possèdent un portefeuille en crypto-actifs, ce qui est énorme.
Le blanchiment d’argent représente entre 2 et 5% du PIB, ce qui correspond à 2 000 milliards d’euros par an, 2 000 milliards qui échappent à l’économie réelle, aux écoles, aux infrastructures comme les routes, aux forces de l’ordre, aux armées…
Vous insistez également sur la question des milices d’extrême droite…
J’ai effectivement consacré un chapitre à ce sujet. Mais je tiens à préciser que ce n’est pas un chapitre où l’objectif est simplement de dénoncer. Je l’ai écrit parce que c’est un sujet d’actualité.
Existe-t-il une forme de résistance au sein même de l’appareil d’État ?
Oui, il existe une forme de conflictualité. L’audition du journaliste d’investigation Fabrice Arfi le 4 mars a été un rappel douloureux. Il a rappelé que nous devions être le seul pays en Europe, voire au monde, à avoir eu deux présidents et deux Premiers ministres définitivement condamnés pour atteinte à la probité. Il a également mentionné un ministre du Budget condamné pour fraude fiscale. Cela révèle un climat assez particulier… Cette audition était, en effet, très marquante. Mais c’est Fabrice Arfi, et j’apprécie beaucoup son travail.
Au niveau de l’UE, il y a la question du « Qatar Gate » au Parlement européen. Qu’est-il advenu des protagonistes ? On a trouvé un million et demi en espèces dans un bureau, et pourtant, il ne se passe rien. Il y a un vrai tabou sur cette affaire.
496 pages