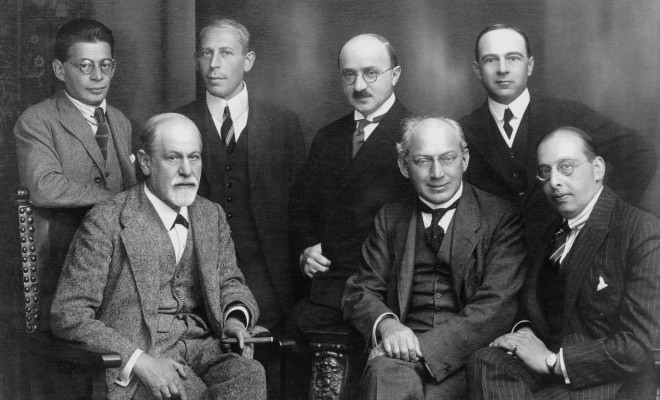
Une adolescente de 14 ans se voit administrer une gifle par son père qu’elle a traité de « gros con ». Une scène de genre qui sous Giscard d’Estaing se serait terminée banalement par une bouderie muette vire inéluctablement au psychodrame quatre décennies plus tard. Dans une France soumise à l’omniprésence de la « culture thérapeutique », un pays où les « bigots cathos » ont été remplacés par les « bigots psycho », selon la formule consacrée du psychanalyste suisse Alain Valterio, le père « maltraitant » n’a eu d’autre choix que de faire son mea-culpa devant sa fille, en présence d’un aréopage officiel de spécialistes des conflits familiaux. Faute de quoi, divorcé, il aurait perdu son droit de visite. L’exorcisme n’aurait tout de même pas été accompli pleinement si le tyrannique géniteur n’avait été contraint d’entamer une psychothérapie pour « régler son problème de violence ».
Le dernier ouvrage de Valterio, Brèves de psy, fait suite à son édifiante Névrose psy. On peut observer de multiples « effets de la psychologisation sur les mentalités ». Véhiculée par le fantasme d’une vie sans chagrins dont nous aurions le droit de « profiter », comme on profite de ses vacances, la verbeuse mentalité thérapeutique désignée par l’auteur sous le néologisme de « psyrose », « entretient ses propres mythes, ses propres interdits et donc ses propres abus, derrière les discours compassés qui se sont imposés dans toutes les sphères de la société ». Nier l’emprise du « psychologiquement correct » reviendrait certes à refuser la réalité.
L’anti-tragédie
Valterio est loin d’être le seul spécialiste à le reconnaître, bien qu’il soit un des rares à la dénoncer, comme le souligne Éric Vartzbed, qui pratique la psychothérapie psychanalytique en cabinet privé : « La culture thérapeutique exprime la société qui a renoncé au rayonnement, à la grandeur, à la conquête, au salut ou à la révolution politique. Elle met l’accent sur le soin, le bien-être, l’éradication de la maladie et de la souffrance. À ce titre, elle est une utopie anti-tragique. Car l’humain est incurable. Ce qui n’empêche pas de connaître des petits soulagements provisoires. » Que celui qui n’a jamais « consulté », qui n’a jamais ressenti « un coup de déprime » ou autre « anxiété » jette la première pierre !
Difficile de ne pas voir le combat d’Alain Valterio comme celui d’une arrière-garde, tant les mentalités individuelles semblent imbibées de la sensibilité thérapeutique orientée vers l’« estime de soi » et la traque des traumas refoulés.[access capability= »lire_inedits »] Sans en faire reproche à l’auteur, le docteur Jacques Thuile, psychiatre, note néanmoins le caractère définitivement révolu d’un modèle social où les problèmes éducatifs des enfants se réglaient au sein d’une famille nucléaire à la seule force de l’autorité parentale. « Le seuil de tolérance a diminué considérablement. Le président de la République se déplace quand il y a un accident de car dans les Landes avec des petits vieux à l’intérieur. On assiste à une hystérisation permanente de tout drame, de toute difficulté de la vie. Or élever les enfants c’est difficile ! » Si le nombre des parents qui ont du mal à y parvenir accuse une constante inflation, les « psys » n’en sont pas les uniques responsables. Et le docteur Thuile de préciser : « Il faut prendre en compte le contexte économique dans lequel nous vivons. Dans une société de plein emploi on pouvait plus facilement minimiser les dérapages des enfants, sachant qu’ils s’en sortiraient d’une manière ou d’une autre et finiraient par trouver un travail. À présent, ces incidents de parcours nous font peur et moins pour ce qu’ils sont que par rapport à ce qu’ils prédisent de l’avenir de l’enfant. »
Tous détraqués ?
Alain Valterio a certainement raison d’affirmer que l’éducation est le domaine le plus exposé aux dégâts de la « psyrose », avec des conséquences catastrophiques chez l’enfant. Mais, encore une fois, reste à déterminer à qui la faute. S., mère d’un adolescent de 17 ans scolarisé dans une annexe du lycée Lakanal à Sceaux, destinée à accueillir des jeunes entre 16 et 25 ans souffrant de troubles de l’humeur, de la personnalité, alimentaires et névrotiques, renvoie la responsabilité en premier lieu à l’école : « Personne ne vous laisse libre d’éduquer votre enfant ! Suite au décrochage scolaire de mon fils, l’établissement qu’il fréquente m’a obligée à l’envoyer voir un psy. Et là, grande surprise, il ne va pas mieux mais la question de savoir s’il est fait pour les études ou si, peut-être, il serait plus heureux en travaillant, n’a pas encore été formulée. En clair, les psys paraissent tout aussi perdus que les parents ! » Valterio le constate de manière formelle : « Croire qu’un thérapeute va réussir là où les parents ont échoué est une illusion. » De son côté, le docteur Thuile éprouve de la méfiance face à des propos trop péremptoires : « On passe sous silence un élément fondamental, à savoir qu’on ne maîtrise pas grand-chose de l’évolution psychologique de son enfant et, surtout, que celle-ci dépend pour une part non négligeable de son patrimoine génétique. Étrangement, Alain Valterio en fait l’économie dans son livre alors que nous savons désormais, grâce à la recherche, que la capacité de quelqu’un à supporter l’angoisse, à réagir face à un événement, est sous-tendue par les gènes. » Un tabou à la fois religieux et républicain que le vaillant psychanalyste suisse n’ose malheureusement pas lever.
Éric Vartzbed tente d’adoucir le tableau : « La bonne nouvelle est que les parents font toujours nécessairement un peu faux. Cela les déculpabilise et laisse à l’enfant un lieu imparfait où trouver une place. Pour l’enfant, une mère trop parfaite ne vaudrait pas mieux qu’une hallucination, disait Winnicott. » Il arrive même qu’au sein de la nouvelle cellule familiale, à sa façon « reconstituée » car complétée par un psy, les parents se révoltent. Tel a été le cas de ce père de famille qui a refusé de continuer à payer les honoraires du psychothérapeute de sa fille mineure, faute d’être tenu au courant de la progression du travail. « Soit vous acceptez de me voir et de me parler, soit vous demandez à ma fille de signer les chèques ! » a bravement lâché l’homme, obtenant finalement gain de cause. Loin d’être sans risque, le recours à l’aide d’un spécialiste semble néanmoins promu à un bel avenir. Comme a eu le chic de le soutenir la psychanalyste Claude Halmos, une consultation, si elle n’est pas forcément justifiée par un problème réel de l’enfant, l’est toujours par l’angoisse de ses parents. Bref, chaque bien-portant serait un malade qui s’ignore, surtout à l’ère de la menace terroriste, où les individus les moins affectés psychologiquement par la violence auraient, nous disent les professionnels, le plus besoin d’être entendus ! Autant retenir le propos d’Éric Vartzbed avant de franchir le seuil d’un cabinet thérapeutique : « Le bon psy ne dicte pas une vérité, il aide les parents à découvrir la leur et à inventer des solutions. Le thérapeute n’est pas un parent de substitution, mais un appui pour des parents souvent complètement dépassés. » Cependant, la première piste pour aller mieux est encore de lire Alain Valterio.
Brèves de psy, Alain Valterio, éditions Favre.


































