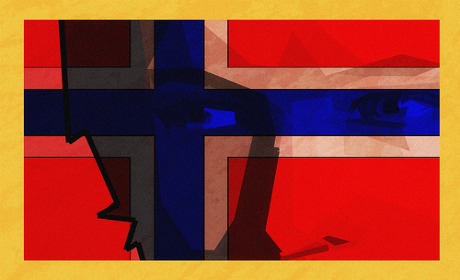
Le massacre d’Oslo nous laisse stupéfaits. Jusqu’à ces derniers jours, la Norvège était une seconde Suisse qui décernait paisiblement les prix Nobel de la paix. Dans pareil havre de paix, difficile d’imaginer qu’un homme soit capable de traquer et d’abattre froidement des dizaines des jeunes dans une horrible partie de chasse de presque deux heures. Or, si appuyer sur la détente est le fait d’un individu isolé, à la psychologie et au parcours singuliers, le choix de telle ou telle cible exprime un malaise collectif.
Ainsi, Anders Behring Breivik a mis sa folie au service d’une cause populaire en Norvège : la peur de l’immigration qui entraîne un sentiment d’insécurité identitaire. A première vue, on peut s’étonner que ces questions touchent une terre de plein emploi aussi prospère que la Norvège. Certes, l’économie norvégienne a connu un faible niveau de croissance depuis 2009, mais le pays affiche un taux de chômage inférieur à 4% et un excédent commercial annuel oscillant entre deux et trois milliards d’euros. Serions-nous donc face à un « paradoxe norvégien » : un rejet de l’immigration sans crise économique en arrière-plan ?
Quatre semaines avant l’abominable tuerie, le quotidien norvégien Aftenposten publiait les résultats d’une enquête menée par l’Agence nationale de l’immigration. Ils étaient sans appel : plus de la moitié des personnes interrogées (53.7%) ne voulaient plus d’immigrés tandis que 80% des sondés souhaitaient l’obtention de la nationalité norvégienne à la maîtrise de la langue nationale. Dans le même temps, 48% exprimaient leur doute quant à l’efficacité de la politique d’intégration, estimant que ses résultats n’étaient pas satisfaisants. Selon les chiffres officiels de l’État norvégien, les immigrés formeraient 10% de la population (500 000 sur cinq millions de personnes), pour la plupart venus de Pologne ou d’autres pays de l’Union Européenne, et massivement attirés par la perspective de trouver facilement un emploi bien payé.
Dans la capitale Oslo, les immigrés constituent 27% de la population. Parmi eux, les migrants venus d’Afrique et d’Asie y sont surreprésentés (rassemblant 40% des immigrés de la capitale contre moins de 20% de la population immigrée à l’échelle du pays), principalement en raison de la générosité norvégienne en matière de droit d’asile. Avec 10 000 demandeurs en transit en 2010 (ils étaient 17 000 en 2009), la Norvège est en effet le pays au monde qui connaît le plus haut taux de demandeurs d’asile par habitant.
Seul problème, mais de taille : les Norvégiens « de souche » ne partagent pas la philanthropie de leur gouvernement, chose qui, en démocratie, ne va pas sans effets pervers. En toute logique, les inquiétudes des Norvégiens se traduisent par l’émergence d’un mouvement politique qui entend restreindre de l’immigration. Le Parti du Progrès, deuxième force politique du pays (qui a rassemblé 23% des suffrages aux législatives de 2009), a ainsi fait campagne en promouvant la double peine, c’est-à-dire l’expulsion des criminels étrangers dès la fin de leur séjour en prison, arguant que la majorité des détenus ne sont pas norvégiens. Face au succès du parti du Progrès, la gauche au pouvoir depuis plusieurs années a commencé à durcir sa politique migratoire mais, comme le démontre le sondage publié par Aftenposten, n’arrive toujours pas à convaincre une majorité de Norvégiens.
Au-delà son caractère exceptionnellement dramatique, cette tragédie nous pousse à nous interroger sur l’extraordinaire défi culturel, voire anthropologique -plus encore qu’économique- que nous pose la mondialisation. Dans notre monde globalisé, chacun devrait se demander comment l’individu peut encore s’articuler avec le collectif pour faire société.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !





