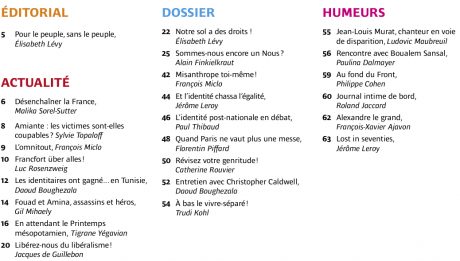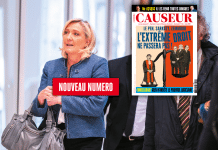« C’est moi qui décide ! ». Cette formule, inscrite sur le T-shirt que m’a offert un ami socialiste et facétieux pour la « primaire citoyenne », pourrait être une définition de la « laïcité libérale » dont Alain Finkielkraut montre qu’elle domine l’esprit du temps et que, sans notre pratique obstinée du « doux commerce des sexes », elle aurait peut-être intégralement triomphé de son ancêtre républicaine. C’est moi qui décide. Qui résisterait à cette séduisante injonction ? Fais ce qui te plaît. Sois ce que tu veux. Seulement voilà, comment fabriquer un « nous » avec ce patchwork de moi qui décident, ne répondant qu’à l’appel impérieux de leurs désirs ? Nous ne le savons pas, peut-être même que nous ne le voulons pas et c’est cela qu’on appelle la crise du vivre-ensemble, expression probablement forgée par un communicant chargé de vanter la « politique de la ville » − entendez de la banlieue − soucieux de tisser du lien social, de ré-enchanter l’avenir et de brasser les différences. Cette pénible invention lexicale s’est imposée au cours des dernières décennies, la fortune du mot allant curieusement de pair avec la déroute de la chose.
Il faut bien faire avec les mots disponibles. Va, donc, pour « vivre-ensemble ». Lorsqu’Alain Finkielkraut m’a parlé du cours magistral qu’il devait donner sur ce sujet devant la nouvelle promotion de l’École Polytechnique, j’ai pensé que, décidément, il n’avait peur de rien. J’avais tort, bien sûr. Il avait peur. Il aurait fallu être inconscient pour s’aventurer sans crainte dans ce champ de mines balisé par la doxa, où tout pas de côté peut valoir brevet d’infamie. Mais il ne suffisait pas de déjouer les pièges du politiquement correct pour percer la vérité profonde d’un phénomène qui se déploie dans la grammaire fragmentée de l’actualité. Cheminant à travers les événements du présent en compagnie des auteurs du passé, explorant les soubassements, repérant les minuscules fissures qui deviendront des lézardes béantes, Alain Finkielkraut expose la généalogie cachée de ce qui nous arrive.
On gâcherait bêtement le plaisir du lecteur en essayant de résumer ce propos foisonnant. On tentera plutôt d’ébaucher un état des lieux en plongeant les mains dans le cambouis du réel.
Inutile de se raconter des histoires. Si la crise prend ses racines dans le moment où, sous les injonctions de la modernité libérale, la France entreprend de défaire les liens qui l’unissaient à son passé, c’est à travers les transformations engendrées par l’afflux massif d’immigrants musulmans, venus d’Afrique et du monde arabe, que la déroute du vivre-ensemble s’invite aujourd’hui dans notre quotidien. Qu’une partie de la population désigne ses concitoyens par l’expression « les Français » montre bien que nous avons échoué à « faire France ».
Au moment où nous mettons sous presse, on ne connait pas les auteurs de l’incendie qui a détruit le siège de Charlie Hebdo, coupable de crime de lèse-Mahomet. De tels actes sont heureusement exceptionnels et minoritaires. Certes, les musulmans conviés à s’exprimer sur les plateaux de télévision ont unanimement condamné l’agression, mais parfois du bout des lèvres et toujours avec un mais permettant de renvoyer dos à dos coupables et victimes : « La violence est inacceptable mais les attaques de Charlie Hebdo aussi. » Et au lendemain du sinistre, ce n’est pas par des messages de sympathie ou de soutien que la page Facebook de l’hebdomadaire était envahie, mais par des menaces et autres récriminations de musulmans en colère. Ce refus de la critique ou de la caricature, systématiquement disqualifiées sous le signe de « l’islamophobie », est tout sauf anodin. L’incapacité à distinguer la loi humaine de la loi divine, et la revendication qui en découle d’un statut particulier plaçant la religion à l’abri de la critique, sont parmi les principaux obstacles à l’acculturation de l’islam. En même temps, la solidarité affichée avec le journal, même dans les franges de la gauche, habituellement promptes à dégainer l’accusation de « stigmatisation », témoigne d’un attachement viscéral à la liberté d’expression et à la laïcité.
Il ne s’agit pas, cependant, de nourrir la mythologie d’une guerre ethnique larvée qui menacerait à chaque instant d’enflammer nos banlieues. Plus qu’à une montée des tensions et des frictions, on assiste à la progression d’un séparatisme culturel et géographique qui voit une fraction de la population immigrée vivre dans l’entre-soi. Comme l’explique Christopher Caldwell dans sa minutieuse enquête sur cette révolution qui se déroule sous nos yeux, ce n’est pas l’immigration en tant que telle qui pose problème, mais son ampleur et sa rapidité qui ont abouti à créer des enclaves ethniquement homogènes dans lesquelles on peut, grâce aux technologies de la communication, vivre à la mode du bled ou du village. À la différence de ceux qui l’ont précédé dans les années 1960 et 1970, l’immigré d’aujourd’hui n’est nullement incité à couper les ponts avec sa culture d’origine. La même prudence s’impose avec le vocable d’« islamisation » volontiers brandi par certains. Cette islamisation est à la fois une réalité et un fantasme, une réalité car, quand le nombre de musulmans augmente, la société s’islamise « naturellement », et un fantasme, car elle suggère une volonté consciente et organisée dont il n’existe pas la moindre preuve.
Si l’on admet, avec Alain Finkielkraut, que la tradition ancienne de visibilité des femmes est au cœur de l’habitus français − ou ce qu’il en reste −, on comprend que la question du voile ait été et soit encore l’enjeu des plus vives polémiques. Ce qui est en cause, au-delà de l’égalité entre les sexes, c’est un régime particulier de leur coexistence qui se caractérise par « la circulation de la coquetterie et de l’hommage », selon l’heureuse formule de Claude Habib – et qui, à vrai dire, scandalise autant les Américains que les musulmans. Dans les années 1980, on pensait que les femmes seraient le fer de lance de l’intégration − et elles l’ont été dans une large mesure. Depuis une décennie au moins, on a l’impression que le balancier est reparti dans l’autre sens et que le groupe a repris ses droits sur l’individu, surtout quand celui-ci est une femme.
Reste que dans la négociation, implicite ou explicite, qui définit les modalités de la coexistence des cultures, c’est à l’accueillant de fixer les règles du jeu, l’accueilli ne pouvant que s’engouffrer dans les brèches existantes. Or, la France s’est volontairement dépouillée de ce qui faisait son identité, au point que le terme lui-même a été proscrit, comme s’il ne véhiculait rien d’autre qu’une histoire criminelle, comme s’il était dangereux par nature de se demander qui on est. Bien entendu, cette mise au ban de l’identité française est allée de pair avec l’exaltation de toutes les autres identités, pour peu qu’elles pussent invoquer un passé de dominé. C’est ainsi que l’ancienne conception du pluralisme a cédé la place à l’idéologie de la diversité qui assigne chacun à résidence ethnique ou religieuse. C’est ainsi que la méritocratie républicaine s’est sabordée en accédant à l’exigence de « reconnaissance » de toutes les singularités. Dans ce sens, le délitement du vivre-ensemble est l’autre nom de la « fatigue d’être soi » française.
Le texte qui suit a été écrit par Alain Finkielkraut à partir du cours qu’il a donné en septembre et octobre à l’Ecole polytechnique qui nous a aimablement accordé l’autorisation de le publier. Nous remercions particulièrement Dominique Rincé et Roselyne Bernard du département « H2S », ainsi, bien sûr, qu’Alain Finkielkraut.
Cet article en accès libre est issu de Causeur magazine n°41.
Pour acheter ce numéro, cliquez ici.
Pour s’abonner à Causeur, cliquez ici.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !