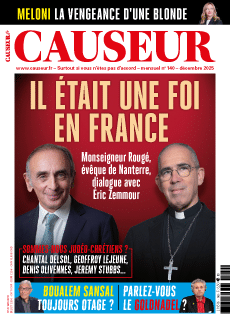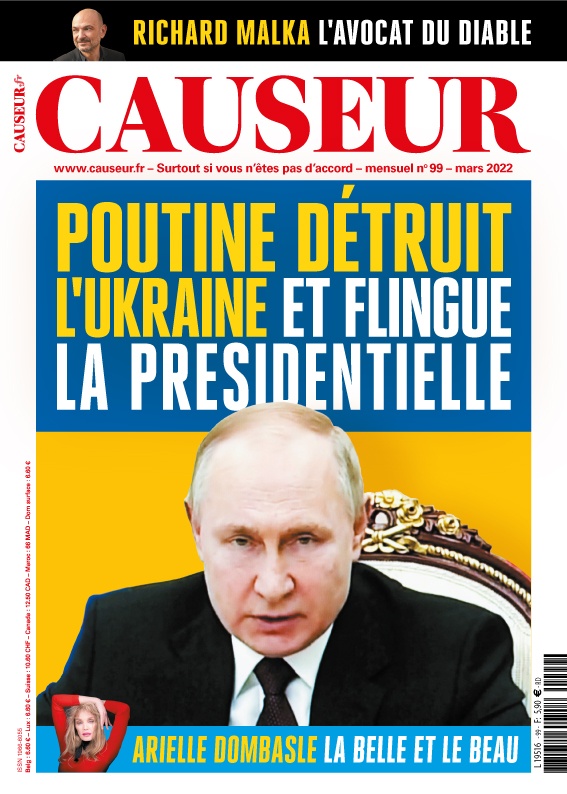Connemara, le dernier roman du prix Goncourt 2018, brosse dans la grande tradition du roman réaliste le portrait d’une société qui voudrait espérer mais qui ne le peut pas.
C’est la période qui veut ça : on ne cesse de radiographier la France. On voudrait la comprendre, anticiper ses humeurs, recenser ses métamorphoses. Les observateurs s’épuisent. On appelle à la rescousse les historiens, les géographes, les sociologues, les philosophes, les psychologues pour nous expliquer ce pays qui envoie tellement de messages contradictoires. On pense trop rarement aux écrivains pour effectuer ce travail, c’est dommage. Que saurions-nous exactement de la condition ouvrière au xixe siècle sans le Zola de Germinal ou de L’Assommoir, de la France de 1848 sans le Flaubert de L’Éducation sentimentale, de la société des années 1880 sans le Maupassant de Bel-Ami ? Pas grand-chose, sauf si nous étions des spécialistes de ces périodes. C’est là la force du roman : il renseigne, bien sûr, mais surtout, il incarne. Les statistiques, les graphiques, les cartes deviennent des personnages. Bien sûr, il faut être un bon romancier pour réussir ce qu’on pourrait appeler le paradoxe du voisin. À la fin de votre lecture, vous connaissez mieux des personnages fictifs que votre voisin de palier.
A lire aussi : La littérature est morte, vive la littérature!
Prenons le dernier roman de Nicolas Mathieu, Connemara, comme la chanson de Michel Sardou qu’un des personnages écoute dans sa voiture – alors qu’il est en train de se demander s’il ne rate pas sa vie. Une chanson qui le renvoie à l’enfance, quand sa mère l’écoutait sur un transistor le dimanche matin en écossant des petits pois pendant que lui dessinait un château fort sur la toile cirée. On mésestime la variété et on a tort, elle dit beaucoup de notre sensibilité et de notre société. Fanny Ardant, dans La Femme d’à côté de Truffaut, l’avait bien compris : les romances disent toujours la vérité.
Prix Goncourt 2018
Nicolas Mathieu est un écrivain qui réussit à donner corps à ses personnages, à montrer comment ils se débattent face aux déterminismes de classe et d’époque. En 2018, on s’était réjouis que le prix Goncourt couronne Leurs enfants après eux, un roman social qui explore les effets dévastateurs de la désindustrialisation lorraine sur deux générations, mesure ses effets sur les lieux et sur les corps, les désirs, les espérances et les désillusions de toute une population. On ne transforme pas impunément le monde de la fierté ouvrière en celui du chômage de masse sans provoquer quelques réactions. Elles se traduisent dans les résultats électoraux ou dans des manifestations sociales parfois violentes comme celles des Gilets jaunes. De quoi paniquer les observateurs et provoquer chez eux une incompréhension teintée de mépris.
Flaubert, Zola ou Maupassant avaient inventé une méthode : ils se documentaient puis oubliaient leur documentation. Le lecteur ignorait ce travail colossal et ne voyait que l’extraordinaire épaisseur des personnages et la justesse des situations. Il en est de même avec Nicolas Mathieu. Il nous plonge dans le milieu du consulting, celui de ces gens très diplômés et très bien payés pour expliquer à des entreprises ou des collectivités locales comment « se réorganiser » – ce qui signifie généralement licencier. Il est tout aussi à l’aise pour nous parler de la « common decency » des classes populaires dont il est issu que d’une équipe locale de hockey sur glace où se joue beaucoup plus que les matchs disputés. Preuve que l’on touche ici au grand art, celui qui ne connaît rien au hockey se prendra à se passionner pour des circonvolutions avec crosses et palet.
Un romancier de la France des « Grandes régions »
Pourquoi avons-nous l’impression de connaître aussi bien Hélène et Christophe, les deux héros de Connemara ? Parce qu’ils sont les fruits d’une histoire, d’un milieu, d’un territoire que l’auteur autopsie avec minutie. Connemara est un roman où il ne se passe rien de romanesque et où, pourtant, la vie affleure à chaque page. Nicolas Mathieu a renouvelé pour la France d’aujourd’hui la méthode naturaliste du xixe siècle, celle que Maupassant exposait dans la préface de son roman Pierre et Jean : « Le romancier qui prétend nous donner une image exacte de la vie, doit éviter avec soin tout enchaînement d’événements qui paraîtrait exceptionnel. Il montrera de cette façon, tantôt comment les esprits se modifient sous l’influence des circonstances environnantes, tantôt comment se développent les sentiments et les passions, comment on s’aime, comment on se hait, comment on se combat dans tous les milieux sociaux, comment luttent les intérêts bourgeois, les intérêts d’argent, les intérêts de famille, les intérêts politiques. »
A lire aussi : Mona Chollet réinvente l’amour, l’eau tiède et la roue
Hélène et Christophe vont avoir 40 ans. On ne s’interroge pas assez sur la polysémie de la quarantaine, un âge mais aussi un isolement forcé entre la jeunesse et la maturité. Nous sommes à l’époque où le quinquennat Hollande prépare la création des « Grandes Régions ». Nicolas Mathieu montre au passage, notamment pour la région Grand Est où se déroule son histoire, l’aberration technocratique de la chose. Une réorganisation autoritaire du territoire sous prétexte d’économies budgétaires, qui va coûter une fortune, se révéler inefficace et, surtout, achever de désorienter des habitants qui n’avaient pas besoin de ça.
Hélène et Christophe sont originaires de Cornécourt, ville moyenne fictive sise à une encablure d’Épinal. 15 000 habitants, un maire sans étiquette qui est là depuis toujours et qui élève des chiens en espérant que l’usine de papeterie tenue par des Norvégiens ne ferme pas, car c’est le dernier gisement d’emplois, comme on dit. Christophe, divorcé, habite chez son père. Il vend des croquettes pour animaux domestiques. Il est plutôt bon dans sa partie malgré les « objectifs » de plus en plus inatteignables. La part de poésie dans sa vie ? Son fils Gabriel, 7 ans, dont il a la garde alternée avec sa mère qui va bientôt quitter la région. Il y a aussi les copains, célibataires, francs buveurs, qui tirent avec des carabines à plomb sur des pinces à linge. Les hommes restent toujours des mômes qui s’affolent d’avoir grandi trop vite. Et puis il y a surtout le hockey. Il a été un champion dans sa jeunesse et songe à remonter sur la glace parce que l’équipe va vraiment mal. À moins qu’il accepte de rejoindre le maire qui le verrait bien sur sa liste électorale.
Hélène, c’est la transfuge, passée des classes populaires à la classe moyenne supérieure malgré des parents qui auraient bien voulu que « la petite bêcheuse » reste à sa place. Elle est devenue consultante à Paris, s’est mariée, a eu deux filles. Évidemment, serait-on tentés de dire, elle est dépressive. Elle a réussi à convaincre son mari de retourner à Nancy, mais ne trouve pas la sérénité dans sa Lorraine natale : les open spaces sont les mêmes partout.
A lire aussi : La France n’est pas un open space
Impasse mélancolique
Nicolas Mathieu excelle dans les portraits de femmes, comme l’a prouvé notamment une novela noire (Mathieu vient du polar), Rose Royal, publiée en 2019, comme pour se ménager une pause après le Goncourt. Pour un peu, avec Hélène, dont il rend parfaitement les sensations les plus intimes, on l’accuserait – c’est à la mode – d’appropriation culturelle, voire de genre. C’est oublier que les vrais écrivains, quand ils écrivent, n’ont plus de sexe, d’origine, d’âge. Il faut souligner aussi, dans Connemara, la finesse de l’observation de ces rivalités minuscules qui signent les différences de milieu social, même si on va à la même école. L’émancipation d’Hélène se fait par une amie, une fille de cadre qui lui apprend à se tenir différemment, à comprendre une série de codes aussi imperceptibles qu’impitoyables. Hélène n’est pas Madame Bovary : quand elle va rejoindre Christophe et qu’ils vont devenir amants alors qu’ils ne faisaient, ados, que se côtoyer, elle ne recherche pas une vie de rêve. Comme Christophe, dans ces chambres d’hôtel de zones commerciales, ce qu’elle retrouve, au moins pour un moment, c’est la jeunesse.

En déployant une ample narration dans le temps et dans l’espace, tout en apportant un soin particulier à ses personnages secondaires, Nicolas Mathieu brosse le portrait d’un « aujourd’hui français ». Un pays inquiet et résigné malgré ses bouffées de colère, un pays désenchanté avec des gens de bonne volonté qui cherchent à trouver une raison de vivre à travers leurs enfants, dans l’amour mais certainement pas dans des métiers dépourvus de sens, ni même dans la politique. Un pays dans une impasse mélancolique qui n’attend plus grand-chose ou qui ne sait peut-être même plus au juste ce qu’il attend, ce qui est encore pire.