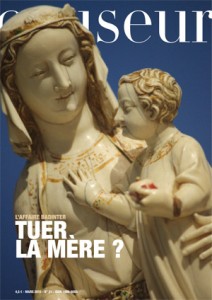Pour un carême, ça commence bien. On s’était promis de faire maigre et de tenir quarante jours durant. Voilà que l’actualité nous sert une pleine platée de carne.
La semaine dernière, le maire socialiste de Roubaix, René Vandierendonck, faisait une drôle de découverte : le restaurant Quick de sa ville ne sert plus que des hamburgers halal à ses clients et le scandale dure depuis trois mois déjà. Aussitôt, l’élu hurle à la discrimination et envoie son avocat porter plainte contre Quick.
Du coup, le pays tout entier s’est pris d’une irrésistible envie d’aller manger au Quick halal de Roubaix un hamburger pas halal. Les uns pour défendre la laïcité : « Préservons notre droit de manger du cochon le Vendredi-Saint ! » D’autres pour défendre les traditions multiséculaires de la France éternelle : « Défendons les valeurs du terroir qu’incarne le hamburger strong bacon. » Certains enfin, parce que l’islamisme ne passera pas : « J’étais au Quick de Roubaix et Ben Laden était planqué dans les chiottes. » Le salafisme s’attrape par la viande halal aussi sûrement que le cancer se transmet par une poignée de main.
Laïcité, islamisation, discrimination : lorsque les grands mots sont sortis à mauvais escient, ils deviennent des gros mots. L’islam n’est pas l’affaire de Quick. Quick fait des affaires avec l’islam.
Si, aujourd’hui, au nom de la lutte contre les « discriminations », le maire de Roubaix porte plainte contre un restaurant halal, pourquoi ne le ferait-il pas, demain, contre un restaurant casher ? Il n’aurait, en effet, aucune raison de s’arrêter en si bon chemin.
L’autre jour, je vais dîner au restaurant casher Les Ailes, rue Richer, dans le 9e. Le mal du pays sans doute, je commande au garçon un jarret de porc. Il n’a pas voulu me servir. Furieux, je sors et je prends place, rue Hénard, dans le 12e, à l’excellent restaurant indien Jodhpur : c’est à peine s’ils m’ont mis dehors quand j’ai commandé un faux-filet saignant. En désespoir de cause, j’ai essayé de trouver un restaurant végétarien digne de ce nom, histoire de manger un tartare bien épicé. J’ai fini, chez moi, devant un bol de soupe.
Les interdits et les prescriptions alimentaires n’appartiennent pas à la sphère publique : elles relèvent de la sphère privée. Sauf pour les cannibales, auxquels la civilisation interdit d’assouvir leurs penchants culinaires – encore une « discrimination » ! Pourquoi, au nom de la laïcité, voudrait-on forcer un catholique pratiquant à manger de la viande un vendredi de Carême, un musulman à avaler du boudin et un juif à faire braiser chaque sabbat un filet mignon de porc ? Seraient-ils plus français, mieux intégrés à la communauté nationale, s’ils le faisaient ? Bien sûr que non. Le rapport que nous entretenons avec l’alimentation – et, plus généralement, avec ce que Jankélévitch plaçait sous les catégories du pur et de l’impur – est certainement ce que nous avons de plus intime. De plus intime, sinon de plus essentiel.
On est toujours gêné aux entournures lorsque l’une ou l’autre instance officielle (ministère et organismes de la Santé) édicte des prescriptions alimentaires. Même si elles sont hygiéniquement fondées (« tu t’es vu quand t’as bu », « cinq fruits et légumes par jour », « quand il fait chaud, mangez gras »), elles semblent empiéter sur notre libre détermination. Kant résumait parfaitement ce sentiment dans Qu’est-ce que les Lumières ? : « Si j’ai un livre qui me tient lieu d’entendement, un directeur qui me tient lieu de conscience, un médecin qui décide pour moi de mon régime, etc., je n’ai vraiment pas besoin de me donner de peine moi-même. » Les exemples choisis par le Chinois de Königsberg ne sont pas pris au hasard : entendement, conscience et alimentation sont ici placés sur un pied d’égalité, car, en fin de compte, c’est de l’autonomie du sujet qu’il est question.
Cette autonomie, elle trouve sa source dans le christianisme, qui opère ici un véritable renversement anthropologique : « Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche d’un homme qui le rend impur. Mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui le rend impur[1. Matthieu, 15.]. »
Lorsqu’elles sont religieuses, c’est-à-dire culturelles, les prescriptions ne sont pas extérieures au sujet. Il les a intégrées dans son identité-même. Elles sont devenues, pour lui, des obligations. Faire manger du porc à un juif ou à un musulman observant, ce n’est pas lui faire simplement injure, c’est nier sa propre individualité.
En venir à parler de Kant dans un Quick, ça fait un peu tâche. Revenons à nos moutons – avant de les égorger dans la baignoire. Dans l’affaire roubaisienne, ce n’est ni la religion ni les prescriptions alimentaires qui sont en jeu. C’est de fric, de pognon, de grisbi qu’il s’agit avant tout.
Le Quick de Roubaix n’est pas un cas isolé. Sur les 362 fast-food de la marque, huit sont passés au burger halal depuis novembre dernier – à titre expérimental, nous dit-on. Les huit sont situés dans des quartiers où vivent, en grande majorité, des musulmans. Quick a adapté son offre commerciale au segment le plus porteur. L’entreprise aurait l’une de ses enseignes dans un quartier à fort peuplement hindou qu’elle ne servirait plus de bœuf dans son restaurant.
Tout ce ramdam pour s’apercevoir que dans certains quartiers vit une majorité de musulmans. Quelle stupéfiante découverte ! Pas besoin de statistiques ethniques : le service commercial de Quick s’en est chargé à votre place. Cependant, il ne faut jamais désespérer de rien. Peut-être que, de progrès en progrès, de mal en pis, on s’apercevra un jour que, halal ou pas, la merde que vendent les fast-food sous forme de hamburgers reste de la merde. Et, en cette matière, il n’y a aucune discrimination : tout le monde est servi.
Une question cependant demeure. Pourquoi un maire, comme René Vandierendonck, se met-il martel en tête de porter plainte contre un fast-food halal ? Il est publiciste et sait parfaitement que la composition de la carte d’un restaurant n’est pas inscrite dans la Constitution. Il sait également que Quick n’est pas un restaurant d’Etat et que le seul maître à bord c’est l’entrepreneur privé lui-même[2. Que le principal actionnaire de Quick soit une filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations n’en fait pas une société publique. D’ailleurs, rachetée en 2006 à Albert Frère par Qualium investissement, la cession de Quick est annoncée depuis plus d’un mois par la Caisse des Dépôts.].
La réponse est, peut-être, à trouver chez le philosophe canadien Charles Taylor : dans un quartier où la légitimité des institutions publiques est en crise, un fast-food n’est plus une simple enseigne commerciale. Il devient lui-même – aussi paradoxal que cela puisse paraître – une institution. Il se charge des fonctions autrefois assumées par les institutions en crise : il socialise, il transmet une culture, il pourvoie chacun de modèles sociaux.
Dès lors, la question n’est plus juridique (un fast-food discrimine-t-il en ne servant que des produits halal ?). Elle est uniquement politique : quelles instances jouent, dans nos quartiers, le rôle traditionnellement dévolu aux institutions ?
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !