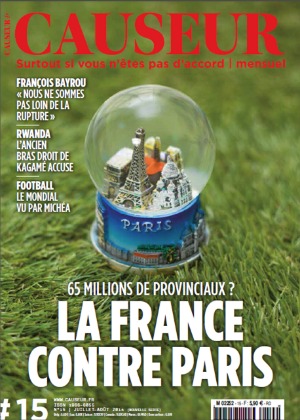On pourrait s’étonner de rencontrer Annick et Louis Doucet chez eux, à Paris, au moment même où l’une des foires d’art contemporain les plus courues et les plus branchées de la planète se tient à Bâle. C’est que ces collectionneurs n’ont rien du couple branché qui investit dans un lapin géant en inox signé Jeff Koons. N’ayant pas d’argent à blanchir, acquérir des pièces de quelque artiste vendu sous le label « approuvé par François Pinault » ne les intéresse pas plus. Les Doucet ne sont pas des spéculateurs. Ce sont des Français moyens, banals serait-on tenté de dire, si on ne se fiait qu’aux apparences. Mais à la différence du ménage lambda, les Doucet, au lieu d’investir une fortune qu’ils ne possèdent pas dans l’achat d’une grosse cylindrée, achètent de l’art.
Nés en province où ils ont grandi à l’époque de l’après-guerre, quand l’offre culturelle y était absente, ils ne semblaient pas prédestinés à fréquenter le monde de l’art. « Tous les deux, explique Louis, nous avons eu la chance d’être tombés sur des profs d’histoire qui nous ont sensibilisés à l’art et, évidemment, pas seulement à l’art contemporain. Et puis, par bonheur, nous avons eu l’un comme l’autre, des parents curieux des choses et qui nous emmenaient pendant les vacances visiter les musées un peu partout en France et à l’étranger. » Le résultat ? Dans leur appartement, s’entassent près de 6000 œuvres, majoritairement des dessins. Leur histoire n’est pas sans rappeler la destinée de ce couple d’Américains, Dorothy et Herbert Vogel, que d’aucuns ont qualifiés de « proletarian art collectors ». D’origine et de statut plutôt modestes, les Vogel, fonctionnaires de l’État de New York, avaient réussi à amasser, pièce par pièce, une des plus importantes collections d’art minimaliste et conceptuel des États-Unis. Louis Doucet ne cache pas son admiration pour eux. Peut-être que l’aventure extraordinaire de la collection Vogel, longtemps ignorée, avant d’être âprement disputée par des musées prestigieux, aide les Doucet à relativiser les regards moqueurs ou les remarques « entendues » de leurs relations : « Ça vaudra combien, plus tard ? » Et Louis de raconter : « Il y a quelqu’un qui est venu chez nous, récemment, et s’est mis à contempler l’œuvre accrochée sur le mur d’en face. « Oh, vous avez un Niki de Saint Phalle ! » J’ai répondu que ce n’était pas Niki de Saint Phalle, mais une artiste marseillaise de 50 ans. Immédiatement, la personne s’est désintéressée de la pièce ! » [access capability= »lire_inedits »]
Coupables de se laisser dévorer par une passion excentrique, les Doucet ont aggravé leur cas en s’inventant mécènes. Que ce soit par le biais d’institutions artistiques telles que MacParis et la galerie associative du Haut-Pavé, ou par l’intermédiaire de l’association Cynorrhodon, qu’ils ont fondée avec le noble objectif de troubler « les scléroses intellectuelles et les conservatismes esthétiques », Annick et Louis tentent l’impossible : susciter l’intérêt du public pour l’art contemporain et préserver la diversité de la création en France. L’éclectisme demeure d’ailleurs la caractéristique première de leur collection. Et pour cause : « Jeune, j’ai vu à Paris trois expositions qui m’ont marqué, explique Louis. Il s’agissait de Charles Lapicque, de Pierre Soulages et des trois frères Duchamp. Difficile d’avoir un goût plus varié. Mais depuis lors, autrement dit dès les années 1960, je suis resté très hétérogène dans mes choix. ». Ainsi, la collection est hétéroclite : on y trouve des travaux de qualité exceptionnelle, tout comme d’autres, plus médiocres, qui risquent de ne pas résister à l’épreuve du temps. Paradoxalement, le caractère inégal des œuvres garantit peut-être la richesse de l’ensemble. : « Les gens disent que Jeff Koons, c’est l’imposture, et ils n’ont pas forcément tort, argumente Louis. Le problème, c’est qu’ils jettent le bébé avec l’eau du bain, s’obstinant à répéter que, de manière générale, l’art contemporain est une imposture. Mais l’art de demain, ce n’est ni Jeff Koons ni les peintres de la place du Tertre. L’art de demain, c’est tous ceux qui sont au milieu. »
Si, un plaisir purement individuel est le moteur de toute collection, les Doucet ont dépassé le stade de l’hédonisme pour adopter une posture quasi militante. Contribuer au changement de la mauvaise réputation de l’art contemporain, inciter les jeunes à pousser les portes des galeries, aider les artistes, multiplier les lieux d’exposition − autant d’objectifs que la politique culturelle de l’État ne fait même plus semblant de viser. Cependant, l’art officiel en France reste néanmoins une affaire essentiellement étatique. Sans hésiter à dénoncer la doxa totalitaire de l’art d’État, Louis Doucet écrit, dans la lettre d’information de son association Cynorrhodon : « Ce que l’État décide de nous montrer, ce sont des artistes plasticiens qui ont, à ses yeux, réussi. La définition de la réussite − et, par conséquent, de l’échec − reste aux mains de commis qui disposent du double pouvoir de reconnaître et de récompenser ladite réussite et de donner les moyens matériels de (sur)vivre aux seuls plasticiens qui se conforment aux dogmes qu’ils ont eux-mêmes fixés. »
Au moins, à l’époque des impressionnistes, ne manquait-il pas de voix fortes pour s’élever contre la pensée unique qu’incarnait alors le Salon de Paris. Il suffit d’évoquer les Zola, les Mallarmé, les Baudelaire… Or, depuis de nombreuses années, la critique ne suscite plus ni débats ni antagonismes, pourtant essentiels au maintien d’une scène artistique réellement inventive. Les rédacteurs responsables des pages « Arts » s’emploient à promouvoir la vision de l’art contemporain imposée par l’État, s’enthousiasmant devant les artistes « à succès » et passant sous silence tous les autres. Louis Doucet en donne un exemple éloquent : « Il n’y a pas longtemps, deux expositions se sont déroulées simultanément au Centre Pompidou, une de Roy Lichtenstein et une de Simon Hantaï. Le critique du Monde a loué l’exposition de Lichtenstein, tout en déplorant qu’il ne lui ait été réservé qu’une petite salle tandis que la grande salle avait été attribuée à celui qu’il a qualifié d’ »artiste mineur », à savoir Hantaï. Certes, Hantaï est peu connu, mais c’est un artiste immense ! Au final, nous avons eu une queue de 300 mètres devant Lichtenstein et trois personnes pour voir Hantaï.».
Que faire ? Surtout réfléchir. Car avant de « dénoncer le système », ce qu’Annick et Louis Doucet font très intelligemment, chacun de nous devrait se demander s’il ressent un besoin d’art.
Un besoin qui ne se manifeste pas forcément par la volonté de posséder une œuvre, mais simplement par la nécessité d’en découvrir, dans les musées comme dans les galeries, où l’entrée, comme la sortie, est libre. [/access]
* Photo : Hannah
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !