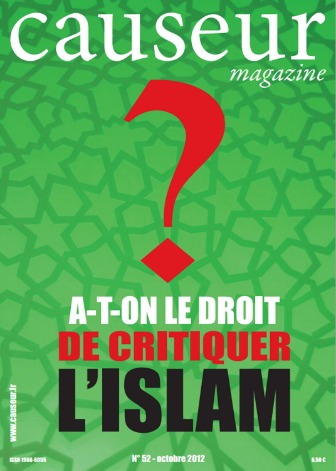Depuis sa mort, Philippe Muray est dans une santé éclatante. Comme toujours. Plus que jamais. D’une foulée joviale, féroce et détendue, il gravit quatre à quatre les marches de la gloire. Il écoute d’une oreille distraite les trompettes de la renommée en continuant tranquillement à fumer son cigare. Terrassés par son verbe, l’animal médiatique et la bête universitaire, ses deux antiques ennemis, s’agenouillent l’un après l’autre à ses pieds. Il leur tend sa main auguste afin d’y recevoir avec longanimité leurs tardifs baisers. Mais quand personne ne regarde, il se départit un instant de la noblesse qui est de mise dans les contrées éternelles et en profite aussi tout de même pour leur filer quelques baffes ou leur enfoncer cruellement un doigt dans l’oreille.
Muray ne se trompait pas lorsqu’il disait à Mark Greene ou à Dominique Noguez, quelques mois avant sa mort : « Moi, je vais bien : c’est la mort qui va très mal. » Après les multiples ouvrages consacrés à son oeuvre en 2011, 2012 est encore une année faste pour lui.[access capability= »lire_inedits »]. À une
première traduction de Muray en langue espagnole devraient faire suite plusieurs autres, en allemand et en coréen notamment.
Mais il y a surtout cet inquiétant phénomène qui a sinistré le tourisme parisien de mars à juin. De nombreux touristes ont préféré quitter la ville après avoir observé des feux follets – parfois même en plein jour – au-dessus de l’emplacement de l’ancien Cimetière des Saints-Innocents. Certains autres, qui s’apprêtaient innocemment à photographier le Panthéon et qui en ont hélas perdu leur short d’épouvante, se rappelleront longtemps les craquements sinistres qu’ils ont entendu remonter des profondeurs du temple de l’occulto-socialisme, juste avant que le respectable édifice, soulevé par un éclat de rire tellurique, ne se mette à danser la gigue sous leurs yeux. À l’évidence, les tables ne tournent plus rond. La religion de la mort est aux abois. Ceux qui ont inconsidérément donné lieu à ces phénomènes par un dialogue un peu trop vivant avec l’esprit de Philippe Muray ne sont autres que Philippe Boutry et Guillaume Cuchet. Ces deux éminents et sémillants historiens ont en effet mis Muray à l’honneur à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales) en consacrant leur séminaire à une étude détaillée et remarquable de son XIXe siècle à travers les âges. À leurs yeux, les intuitions géniales et cavalières de Muray sur le XIXe siècle s’avèrent le plus souvent justes et pourraient constituer une source féconde d’inspiration pour le travail des jeunes historiens.
« La décadence, c’était le bon temps ! Maintenant, c’est la déliquescence… » L’auteur de ce verdict lucide, drôle et réactionnaire sur l’époque n’est pas Philippe Muray mais celui qui fut, durant vingt
ans, son ami, avant de devenir son plus indéfectible ennemi, un certain Philippe Sollers, invité par Philippe Boutry et Guillaume Cuchet, lors de la séance du 12 juin, à évoquer Le XIXe siècle à travers les âges, édité en 1984. Muray a 25 ans lorsqu’il découvre avec enthousiasme ce qu’il nomme la « littérature vivante de l’époque », celle de Sollers et Tel Quel. La rencontre entre les deux hommes a lieu quelques années plus tard, vers 1975. C’est le début d’une amitié, intellectuellement et esthétiquement féconde. L’amitié passionnée et houleuse de deux solitaires invétérés. Muray écrit dans Tel Quel et Sollers publie, en 1981, son Céline.
Mais, dès 1987, Muray accomplit un premier pas de côté stratégique. Il s’éloigne de Sollers en s’alliant à un autre parrain de la mafia des lettres, Bernard-Henri Lévy. Il publie ainsi Postérité, en 1988, et La Gloire de Rubens, en 1991, chez Grasset. Il se rapproche également de Jean-Edern Hallier et conspue avec lui, en 1992, l’Europe ultralibérale et le traité de Maastricht. En néo situationniste décidément hors norme, Sollers n’hésite pas, en revanche, à en chanter les louanges.
En mai 1993, c’est la rupture définitive, la fin d’un long et irrésistible désensollersement au terme duquel « l’abbé Muray » rend sa soutane au diable. Dans un acte sacrilège, il abandonne sur un trottoir les oeuvres complètes de Bataille et d’Artaud (Ah ! l’heureux clochard qui les découvrit !). Il brise en deux le chalumeau du Joueur de flûte de Talence. Il prend abruptement congé en écrivant à Sollers qu’il n’est pas « un nègre échappé de sa plantation ». Avec sa modestie coutumière, Muray évoquait toujours cette rupture en la comparant à celle de Nietzsche avec Wagner. Celle-ci constitue sans
doute, avec les six mois miraculeux de la rédaction du XIXe siècle, sa deuxième naissance la plus notoire.
Au sein de la sainte Église murayienne, je me signale par deux singularités presque tératologiques : mon attachement à l’extrême gauche et mon admiration pour l’oeuvre de Sollers. Celle-ci ne date pas d’hier − mais d’avant-hier. J’ai commencé à lire Sollers à 15 ans. J’ai lu Muray à 20. À l’un comme à l’autre, je dois tant de bouleversements et de découvertes décisives, tant d’heures de lecture éblouie et de « solitude dorée », tant d’éclats de rire musicaux et libérateurs. Plus les temps s’obscurcissent et plus
la voix de Sollers m’est chère, et plus je me rappelle que ma dette envers son oeuvre est grande. Mes dettes envers l’oeuvre et la personne de Muray m’ont conduit pendant un temps à oublier et sous-estimer l’autre. Parfois, un Philippe peut en cacher un autre. Ces frères ennemis ont toujours été à mes yeux plus frères qu’ennemis, comme s’ils avaient voulu rendre un long hommage à la phrase fameuse de Carl
Schmitt : « L’ennemi est notre propre question ayant pris figure. »
Frères murayiens, je suis las de votre anti-sollersisme primaire ! Frères murayiens, les temps s’obscurcissent, lisez Sollers sans attendre ! Commencez par Femmes, que Muray a toujours considéré comme un chef-d’oeuvre. Traversez Le Coeur absolu, Portrait du joueur,
Paradis II ! Votre corps le réclame ! Lisez Théorie des exceptions, Studio et Discours parfait ! Je vous en conjure ! Je n’irai cependant pas jusqu’à vous inviter à embrasser sur le champ l’européo-maoïsme ségoléno-balladurien de Sollers, qui me laisse assurément plus circonspect. Le Sollers que j’aime n’est pas celui-là : il est catholique et taoïste.
Mais pourquoi Muray a-t-il rompu avec lui ? La mauvaise foi innée et énergique des deux intéressés rend assurément toute tentative de réponse difficile et hasardeuse. Maastricht ? Le goût croissant de Sollers pour le pouvoir et les médias, que Muray vilipendait souvent après leur rupture ? Son manque de probité et de common decency ? Muray s’est-il soudain transformé en monstre réactionnaire ? Il écartait cette hypothèse en riant et affirmait qu’il en était un depuis le berceau et qu’à cet égard, seul Sollers était pire que lui, en dépit de ses danses du ventre progressistes dans les médias.
Un Philippe peut en cacher un autre, et ces deux-là sont plus frères qu’ennemis. Pour ma part, je ne crois pas que la fatalité de leur rupture ait été inscrite dans leurs divergences, qui sont réelles, mais dans leurs trop nombreuses convergences. Eux qui ont travaillé avec tant d’énergie à se distinguer du commun des mortels, il n’est rien qu’ils ne tiennent davantage en horreur que les « points communs
». Mais malgré cela, ils en présentent beaucoup, et leur liste en est d’ailleurs accablante… Ils ont tout d’abord en partage leurs trois principales religions : la littérature, le libertinage et le catholicisme romain, qui pour eux n’en forment qu’une seule. L’un comme l’autre ont subi les influences intellectuelles décisives de Freud et de Lacan, celles de Nietzsche, Heidegger, Kojève et Debord. Leurs admirations littéraires communes sont innombrables, de Baudelaire et Claudel à Roth et Kundera en passant par Céline et Proust. Ils sont animés l’un et l’autre par un amour animal de la peinture,
c’est-à-dire des femmes. Dieu merci, leurs différences aussi sont nombreuses (chez eux, tout est nombreux) : le goût sollersien des voyages et la propension plutôt sédentaire de Muray ; l’indifférence relative ou totale de Sollers à Bernanos, Bloy et Marcel Aymé ; celle de Muray à la Chine, à Joyce, à Rimbaud et à Breton ; et la haine de ce dernier, parfois feinte, des deux arts les plus chers à Sollers : la musique et la poésie ; sans oublier l’impardonnable détestation de Sollers envers Péguy.
Mais les « points communs » reviennent à la charge, ils sont têtus, ils sont partout : leur médisance joyeuse et noire, leur goût du secret et la jouissance que suscite en eux (et quelquefois chez les autres) leur parole surprenante et intarissable, leur mégalomanie enfantine ainsi que leur paranoïa généreuse et féconde.
Après leur rupture, comme un seul homme, en parfaite intelligence avec l’ennemi, ils se sont mutuellement décrétés littérairement morts. Ils n’ont plus cessé, dès lors, de se donner à goûter mutuellement leurs curares les plus délicats en s’envoyant fidèlement, de livre en livre, quelques nouvelles petites fléchettes invisibles. Peu après la mort de Muray, cependant, Sollers commit une regrettable erreur de dosage entre les baumes et les poisons. Comme s’il pressentait l’ombre que Muray mort allait jeter sur lui, il écrivit par deux fois, dans le Journal du dimanche et dans Un vrai roman, des mots indélicats et sans noblesse, dictés par le ressentiment.
Six ans plus tard, le 12 juin 2012, c’est avec joie que j’ai entendu Sollers, invité à l’EHESS, évoquer cette fois la mémoire de Muray sur un autre ton, avec chaleur et amitié. Son éloge vibrant et enthousiaste du XIXe siècle à travers les âges et de La Gloire de Rubens fut une heureuse surprise.
En dépit de quelques sifflements de fléchettes invisibles, durant plus d’une heure, Sollers parla de Muray avec une admiration et un plaisir très sensibles, au point d’en oublier même un peu Sollers de temps à autre. Aux historiens auxquels il s’adressait, il a notamment proposé ce portrait mémorable de son vieil ennemi : « Muray était un aventurier. Un amateur. Ce sont les amateurs qui font l’Histoire… Les historiens arrivent plus tard… un siècle après… en trottinette… »
Pour l’essentiel, l’oeuvre de Sollers, comme celle de Muray, est une méditation poétique sur le Temps. Chez eux, la douleur et l’angoisse se font irrésistiblement rire et style. Ils sont la littérature elle-même, la langue française en personne. La-littérature-à-moi-tout-seul. Tous les deux..[/access]
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !