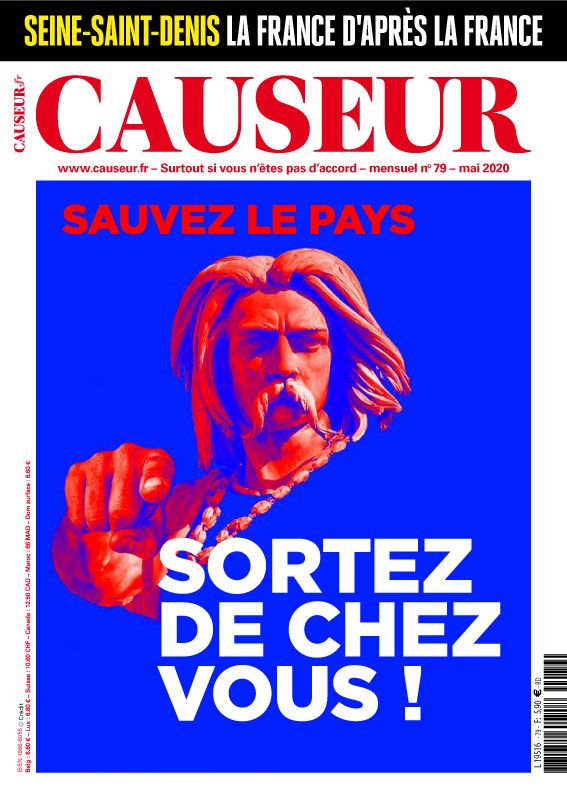Avec l’explosion des dettes publiques, du chômage et de la pauvreté, l’Occident déjà éprouvé par les diverses crises de la mondialisation est au bord du gouffre. Seules la relocalisation et la création de monnaie nous éviteraient le pire.
Pour la troisième fois en douze ans, le monde est au bord du gouffre. Tout se passe comme si les deux grandes crises de 2008-2009, issue de la faillite du marché hypothécaire américain, et celle de 2010-2012, issue des entrailles de la zone euro, n’étaient que des préfaces de celle du coronavirus.
On me reprochera d’amalgamer des crises proprement économiques avec les dommages collatéraux d’une crise sanitaire d’ampleur mondiale. C’est d’ailleurs le thème de maints commentateurs qui n’acceptent la réalité du désastre en cours que pour en pointer l’origine « aléatoire ». « Crise sanitaire, crise économique », c’est ainsi que Daniel Cohen a résumé l’affaire dans L’Obs. La crise économique de 2020, aussi fâcheuse soit-elle, ne doit pas entraîner un changement des choix fondamentaux faits depuis trente ans.
Chacun aura compris que le procès de la mondialisation n’est pas à l’ordre du jour, même si l’on admet que l’extension des « chaînes de valeur » à l’échelon planétaire a privé les systèmes sanitaires des produits essentiels nécessités par le combat contre la pandémie.
A lire aussi, Stéphane Germain : Le séisme de 2020 tourne la page de la mondialisation heureuse
Le coronavirus atteint des corps anémiés
Pourtant, cette défaillance offre une illustration accablante du système aveugle qu’on appelle mondialisation. Car la question déborde infiniment celle, pleinement légitime, mais réductrice, de la « souveraineté » embrassée par le président qui a changé de monture pour prendre la tête d’un combat qui n’a jamais été le sien, ni celui d’aucun de ses coéquipiers. Elle appelle à un bilan, un vrai, qui aurait déjà dû être esquissé dès 2008. Car la crise dite des « subprimes » était une crise de la mondialisation et de la déflation salariale dont les effets étaient masqués par l’endettement des ménages pauvres et modestes. C’est à ce bilan qu’on s’est refusé il y a douze ans comme on s’est refusé au bilan de la monnaie unique il y a dix ans, après les faillites dites des dettes « souveraines » qui ont révélé l’incongruité d’une monnaie embrassant des pays comme l’Allemagne et la Grèce. Le refus du bilan résume la démarche de ceux qu’on doit appeler, non sans ironie, les « élites ».
Oublions un instant que les