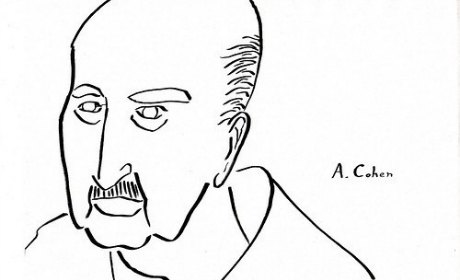I. Y a-t-il une place dans l’enfer pour moi et mes amis ?
Lausanne, en été, est une ville peu banale : le jour, elle est quadrillée par des mendiantes roumaines à l’allure de sorcières qui cèdent leur place, la nuit tombée, à de jeunes Noirs tout droit sortis de « Nollywood ». Ils se livrent à des trafics en tous genres sous le regard placide de la population locale qui goûte modérément la cocaïne, lui préférant sans doute une fondue moitié-moitié. Lausanne a encore des allures de campagne et ce qui vient d’ailleurs la déroute toujours un peu, mais elle veille à n’en rien laisser paraître.[access capability= »lire_inedits »] « Nollywood », peut-être faut-il le préciser pour ceux qui ne s’intéressent ni au cinéma, ni à l’Afrique, est la troisième industrie cinématographique mondiale. Installée au Nigeria, elle produit plus de 200 films par mois qui pourraient tous porter le même titre : « Y a-t-il une place en enfer pour moi et mes amis ? », non parce qu’ils sont financés par des évangéliques, mais parce qu’ils cultivent une esthétique de la déchéance et de la violence que Sam Peckinpah ne renierait pas. C’est donc à Nollywood qu’un jeune photographe sud-africain, Pieter Hugo, a portraituré les acteurs, sur un mode tout à la fois grotesque et terrifiant. Ainsi, cette femme zombie allongée sur le sol et dévorant une main… Pourvu que cela n’inspire pas les mendiantes roumaines regroupées autour de la place Saint-François ! Pieter Hugo est plus proche de Ballard ou de Cronenberg que de Peter Beard : il nourrit une méfiance instinctive envers la photographie et nous épargne tous les clichés de Out of Africa. C’est sur la route qui conduit à la piscine de Pully, au Musée de l’Élysée, que j’ai découvert cette alchimie subtile entre fiction et réalité qui tranche brutalement avec les visions convenues de l’Afrique. Du coup, les pourvoyeurs de drogues de la place Bel-Air ne m’apparaissent plus comme de simples dealers, mais comme de mystérieuses divinités posant à chaque passant la même question : « Y-a-t-il une place dans l’enfer pour moi et mes amis ? »
2. Heidi au Japon
Même si, devant le Palais de Justice de Montbenon, figure une statue de Guillaume Tell, il est rare qu’on croise à Lausanne un barbu son arbalète à la main, ce qui rendrait le shopping à la rue de Bourg assez pittoresque les jours de marché. Il faut donc se rabattre sur une autre incarnation de la mythologie helvétique, sans doute la plus populaire et la plus adulée dans le monde entier : Heidi. Avec ses tresses blondes et son âme pure, Heidi l’orpheline incarne à la fois les idéaux pédagogiques de Rousseau ou de Pestalozzi et la recherche d’un paradis perdu, celui de la Suisse primitive. Heidi, la petite fille modèle, est aussi une petite fille moderne : telle est la conclusion de l’essai de Jean-Michel Wissmer : Heidi, enquête sur un mythe suisse qui a conquis le monde (éd. Métropolis).
Paradoxalement, si le monde entier a adopté Heidi − et l’a adapté au cinéma (elle doit ses nattes blondes à Hollywood)− personne ne s’est intéressé à la créatrice de ce mythe, la Zurichoise Johanna Spyri qui, après une brève liaison avec Richard Wagner, se convertit au piétisme, religion du coeur et de la nature. Comment connaîtrait-on d’ailleurs Johanna Spyri puisque son nom ne figurait même pas sur les couvertures des premières éditions ? Heidi, c’est elle, la fillette née dans l’Oberland zurichois et qui découvrira, adolescente, les turpitudes de la grande ville.En parcourant le joli petit livre de Jean-Michel Wismmer dans le bus de la ligne 8 qui me conduisait à la piscine de Pully, je songeais à toutes les jeunes Heidi qui avaient agrémenté mes Bildungsjahre (années d’apprentissage) helvétiques. J’ai même, dans la chambre de mon hôtel, le numéro de téléphone de l’une d’elles, et j’hésite à l’appeler. Heidi, grand-mère ? C’est impensable. Et c’est pourtant le titre qu’a donné Réa à une suite de Heidi. Je ne l’ai pas lue, pas plus que je n’ai lu Heidi et ses enfants. Et je ne reverrai sans doute jamais Heidi. Plutôt jouer au tennis de table avec l’ami Joseph qui rêve d’être enterré dans un cercueil qui aurait la forme d’une raquette de ping-pong. C’est encore la meilleure façon de préserver son enfance…
Pas le cercueil, (encore que) mais le tennis de table à Pully-Plage. Certes, je pourrais aussi m’envoler pour le Japon où une véritable histoire d’amour s’est nouée entre ce pays et la petite fille des Alpes. Les Japonais ont même créé un « village Heidi » dans leurs montagnes et depuis 1920, date de la première traduction en japonais, leur passion pour la petite Suissesse ne s’est jamais éteinte. Il est vrai que les Japonaises, outre leur privilège de ne jamais vieillir − ou le plus tard possible − partagent avec les Suissesses le culte de l’ordre et de la propreté. Comme Heidi, qui range et astique tout, elles pratiquent avec ferveur les règles du bonheur domestique, règles qu’on aurait tort de railler tant elles procurent de satisfactions, légèrement perverses certes, mais bien réelles. Et je parle d’expérience. Peut-être n’y a-t-on pas prêté suffisamment attention, mais Heidi est la meilleure publicité jamais imaginée par l’Office du tourisme suisse pour attirer ses hôtes. Qui ne rêverait de rencontrer Heidi et de découvrir avec elle les plus beaux paysages du monde ? Décidément, Heidi a toutes les vertus. À chacun ensuite de lui inoculer ses vices.
3. Albert Cohen dans le bus
Il s’en est fallu de peu pour que j’appelle Heidi. Heidi maintenant grand-mère. Celui qui m’en a dissuadé n’est autre qu’Albert Cohen. Préventivement, j’avais emmené avec moi ses Carnets 1978, et j’avais été bien inspiré. Car, peu avant de composer, non sans anxiété, le numéro fatidique, j’avais ouvert les Carnets d’Albert au hasard et j’avais relu cette page 87 dans laquelle il relate comment, dans les bus genevois, immanquablement, des vieilles viennent s’asseoir à côté de lui, des vieilles bien laides, sans-gêne, dont le derrière frôle un peu le sien − « et c’est affreux », ajoute-t-il. Il en arrive à penser que les vieilles le repèrent, qu’elles complotent pour venir s’asseoir auprès de lui, ce qui lui donne la nausée. Il change alors de place, mais une autre, plus vieille encore, eczémateuse et bossue, pose le bas de son dos près de lui.
Il en conclut qu’il est traqué par ces vieilles, hélas ingambes, qui le recherchent dans les autobus et se signalent peut-être l’une à l’autre qu’il est là. Impossible de fuir… Où qu’il se tourne, la mort le guette.
Dans le bus, ligne 8, qui me conduit à la piscine de Pully, ce sont des ados qui crient, qui flirtent, qui s’esclaffent, qui se bousculent. Mais je suis d’accord avec Albert Cohen, même si le spectacle qu’ils offrent − surtout celui des filles aux longues jambes dorées en mini-short et débardeur moulant − damnerait le plus puritain des Vaudois : c’est déjà leur futur cadavre qu’elles exhibent. Si nous étions immortels, ce serait pire encore. Et pourtant, comment accepter que nous qui sommes, demain nous ne soyons plus ? Je me délecte de cette phrase d’Albert Cohen : « Quelle aventure que ce mobile que je suis soit bientôt immobile et pour toute éternité ! »
Impossible alors de ne pas penser à ces amis de mes étés lausannois, Jean-Marc Lorétan, l’écrivain, Alain Bloch, le cinéaste, Rainer-Michael Mason, le poète, Pierre du Bois, l’historien, tous déjà immobiles pour l’éternité. Sans oublier les filles, et d’abord Rachel, si précocement dégoûtée de l’existence qu’elle avait pris les devants en se jetant sous un train.
Alors, Heidi grand-mère ? Ce ne sera dans le meilleur des cas qu’une de ces vieilles qui s’accrochaient à Albert Cohen ou, au pire, un fantôme. Quelle démence de vouloir ressusciter le passé ! Mieux vaut encore manger un plat de viande séchée des Grisons en buvant trois décis de Goron au Café Romand, brasserie de la
place Saint-François sans laquelle Lausanne ne serait plus tout à fait Lausanne. Et si j’y rencontre Heidi, je feindrai de ne pas la reconnaître et me plongerai dans la lecture des Carnets d’Albert Cohen. Sans doute est-ce la principale vertu de la littérature : nous soulager du poids de la réalité.[/access]
*Photo : Yehohanan92
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !