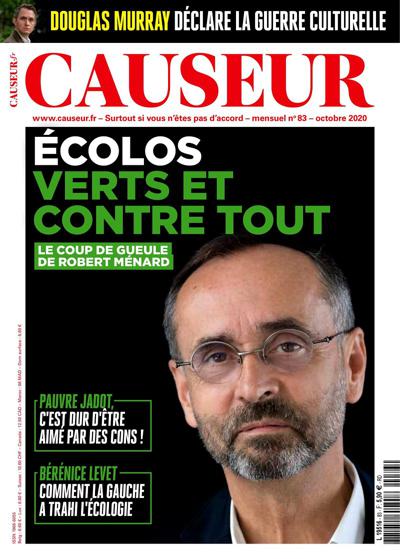Féru de nouvelles technologies, le prince héritier d’Arabie saoudite a rompu avec l’équilibre traditionnel entre les différents clans du royaume. Comme le montre l’assassinat de Jamal Khashoggi en Turquie ou la séquestration du Premier ministre libanais dans un hôtel, son despotisme 2.0 ne connaît pas de frontières.
En mai 2018, les forces de sécurité saoudiennes arrêtent la féministe Loujaine al-Hathloul, qui milite pour le droit de ses concitoyennes de conduire une voiture et de voyager sans chaperon masculin. Selon l’explication officielle, al-Hathloul aurait « établi des contacts avec des éléments étrangers dans le but de déstabiliser » le royaume. Quelques semaines plus tard, Mohammed Ben Salmane (MBS) autorise les femmes à conduire puis abolit la nécessité d’une autorisation masculine pour quitter le pays. Pour qui connaît mal le prince héritier, l’épisode peut sembler contradictoire. D’après Ben Hubbard, journaliste au New York Times et auteur de la biographie The Rise to Power of Mohammed Bin Salman, aux yeux du probable prochain monarque saoudien, les libertés ne sont pas des droits, mais des privilèges accordés gracieusement par un souverain à ses sujets. On pense à la célèbre scène du film Lawrence d’Arabie quand le chef de tribu incarné par Anthony Quinn tergiverse avant de céder à l’argument massue de l’officier anglais : vous n’agirez ni par contrainte ou obligation ni par appât du gain, mais parce que c’est votre bon plaisir !
The Rise to Power of Mohammed bin Salman fourmille de ce genre d’anecdotes. S’y dessine le portrait d’un personnage aussi fascinant qu’effrayant, mélange unique de modernité technologique et managériale d’un côté, d’archaïsme de l’autre. Un alliage d’autant plus surprenant que ce jeune homme de 35 ans n’était pas destiné à gouverner.
MBS est non seulement parvenu à concentrer tous les pouvoirs mais aussi à changer le régime
C’est seulement grâce à une série d’« incidents dynastiques » (la mort de ses frères) que son père Salmane, vingt-cinquième fils du fondateur de l’Arabie, le roi Abdelaziz, et simple gouverneur de Riyad pendant cinquante ans, est devenu prince héritier en juin 2012 puis monarque le 23 janvier 2015. Quant à MBS lui-même, né le 31 août 1985, il n’est que l’aîné de la troisième épouse de son père, occupant donc une position en principe très basse dans l’ordre de la succession. Autre singularité, Salmane n’a pas amassé de fortune considérable ni exercé de postes ministériels importants le mettant en contact avec le monde extérieur. Dans ces conditions, MBS, qui avait peu de chances d’accéder au pouvoir, est l’un des rares princes qui n’avaient pas étudié à l’étranger, ne maîtrisaient pas l’anglais et n’avaient que rarement quitté les frontières de leur pays. En somme, MBS et son père sont les plus « bédouins » des princes saoudiens.
À défaut de lui ouvrir les portes du monde, Salmane a méticuleusement fait découvrir son pays à son fils préféré. En accompagnant son père à ses rendez-vous, MBS a rencontré les personnages clés des différentes tribus, s’initiant aux subtilités, us, coutumes et rapports de forces de la politique tribale. MBS a également mis à profit ce long apprentissage – commencé à 16 ans – pour connaître le système religieux saoudien, particulièrement complexe. Il faut rappeler que la longue ascension de la maison des Saoud est intimement liée à leur alliance au xviiie siècle avec Mohammed Ben Abdelwahhab, promoteur d’un islam radical (au sens littéral de « retour aux sources ») et puritain.
Bon connaisseur de la société et du système politico-religieux de son pays, MBS a compris que l’Arabie saoudite était otage de sa rente pétrolière. Au-delà du spectre de l’épuisement des ressources, maintes fois annoncé depuis les années 1970, l’enjeu est de diversifier l’économie, de créer des emplois pour proposer des perspectives nouvelles aux jeunes Saoudiens dopés à l’argent public. Dans un pays dépourvu de femmes au volant, de salles de cinéma et de musique, une telle transformation nécessitait de se confronter à l’establishment wahhabite. MBS l’a fait. Par un décret royal rendu public en avril 2016, celui qui n’était pas encore le prince héritier mais commençait déjà à exercer le pouvoir officiellement tenu par son père a privé la police religieuse de ses pouvoirs coercitifs. Depuis, ces fonctionnaires barbus et sourcilleux ne peuvent que signaler à la police les infractions constatées. Et cerise sur le gâteau : ce coup asséné aux religieux, jusqu’alors impensable, n’a pas rencontré de véritable résistance. Grâce à son habileté, MBS a inversé la tendance suivie par Riyad depuis 1979. En riposte à la révolution iranienne, l’Arabie saoudite a accru la mainmise des wahhabites sur l’espace public afin de contester à l’Iran l’hégémonie du monde musulman. Par une logique de surenchère, Riyad est ainsi devenue un Téhéran sunnite.
Une fois ces réformes sociétales accomplies, le prince a pu passer à la phase politique de son projet, mettant en jeu deux processus parallèles et interdépendants : le premier visait à prendre la place du prince héritier, le deuxième à neutraliser les princes les plus puissants. En effet, dans le système politique saoudien, les grandes décisions, les grands ministères et les nominations à la tête de l’État répondent à une logique dynastique fondée sur l’ordre d’aînesse et à la nécessité de parvenir à un équilibre entre les clans. Entre les milliers de membres de la famille royale, l’obligation de négocier et de maintenir un consensus limite le pouvoir du monarque. L’action du roi s’en trouve généralement ralentie, favorisant un conservatisme prudent peu propice aux coups d’éclat. Or, là aussi, MBS a radicalement rompu avec la tradition. Au nom de la lutte contre la corruption, des centaines de personnes, dont des princes importants et richissimes, ont été convoquées – souvent sous couvert d’une prétendue audience royale – à l’hôtel Ritz Carlton. Retenus de force dans le palace, ils ont dû supporter une détention arbitraire de plusieurs mois. Certains ont été torturés, beaucoup ont subi des interrogatoires musclés. Interdits de contact avec leurs familles et leurs avocats, tous ont fini par accepter de céder à l’État des biens, des sociétés et d’importantes sommes d’argent en compensation des fraudes commises. Certes, selon les standards occidentaux, une bonne partie d’entre eux était bel et bien corrompue. Sauf qu’il ne s’agit pas de l’Occident et au royaume des Saoud, qui mélange allègrement argent public et dépenses privées, appels d’offres et faveurs royales, ce gigantesque coup de filet apparaît pour ce qu’il est : une opération politique. D’autant que les princes menaçant l’ascension de MBS furent les premiers ciblés et les plus durement touchés.

C’est avec les mêmes méthodes musclées qu’en juin 2017, MBS a forcé le prince héritier Mohammed Ben Nayef (MBN) à lui céder sa place. Choisi par son père lors de son ascension au trône pour rassurer la famille et les États-Unis, MBN, un homme cultivé et expérimenté, était responsable de la lutte contre Al-Qaïda et le terrorisme islamiste. En cette qualité, on le savait proche des Américains et apprécié de leurs services.
Désormais prince héritier, MBS est non seulement parvenu à concentrer tous les pouvoirs entre ses mains, mais aussi à changer le régime. La monarchie prudente et consensuelle est devenue un régime absolutiste agressif, ambitieux, voire aventurier. L’affaire Khashoggi en est la démonstration.
Jeune homme au début des années 1980, Jamal Khashoggi s’était rapproché des Frères musulmans pendant ses années d’études aux États-Unis avant d’entamer une longue carrière de journaliste en Arabie saoudite. Son métier l’a amené en Afghanistan, où il a rencontré Ben Laden ainsi que d’autres djihadistes au service de l’Arabie saoudite et des États-Unis dans la guerre contre l’URSS. Son engouement pour l’islam radical s’est atténué avec le temps, si bien qu’il est resté proche du prince Turki ben Fayçal, chef des services de renseignement du royaume de 1979 à 2001, puis ambassadeur à Londres et Washington. D’abord plutôt séduit par l’énergie et la volonté réformatrice de MBS, Khashoggi s’en éloigne lorsqu’il prend la mesure de son projet absolutiste. Pour neutraliser cet ancien frère musulman repenti, il aurait suffi de le contraindre à un exil doré avant de l’inciter à modérer ses critiques en échange d’un retour au pays. Telle n’est pas la méthode du prince héritier. En utilisant les services de renseignement du royaume ainsi que son cabinet noir personnel, MBS emploie les moyens de surveillance et de manipulation les plus sophistiqués sur les réseaux sociaux (trolls, faux profils, campagnes de dénigrement, fausses informations) dans la guerre contre ses ennemis. Avec Khashoggi, il a franchi un pas supplémentaire, décidant tout simplement de le tuer. Quand, fin septembre 2018, le journaliste prend rendez-vous au consulat d’Arabie saoudite en Turquie pour le 2 octobre, son assassinat est programmé. En quarante-huit heures, les services saoudiens montent l’opération. Se présentant à son rendez-vous, Khashoggi est interrogé, torturé, assassiné et son corps disséqué sans autre forme de procès. Sa fiancée, qui l’attend près du consulat, donne l’alerte. Immédiatement, les Turcs se saisissent de l’occasion pour embarrasser leurs rivaux saoudiens. L’affaire embrase la presse et les opinions publiques mondiales. Trois semaines plus tard, après avoir prétendu que Khashoggi avait quitté le consulat vivant, l’Arabie saoudite finit par reconnaître son meurtre à l’intérieur du bâtiment. Il faudra à Riyad encore quelques semaines et plusieurs versions contradictoires avant d’admettre que l’assassinat était prémédité. Officiellement, les Saoudiens incriminent quelques collaborateurs trop zélés du prince. Le seul tort que concède MBS paraît bien véniel : il leur aurait trop inculqué l’amour de la patrie et le désir de la servir. La fable officielle est donc que, par excès de patriotisme, ses sbires auraient tué Khashoggi sans le consulter…
Le scandale déborde largement les frontières du royaume. Une telle opération montée sur un sol étranger n’est pas sans conséquences diplomatiques. L’affaire n’a pas seulement donné des munitions à Ankara, elle a mis les États-Unis dans l’embarras puisque Jamal Khashoggi y résidait et travaillait au Washington Post. Les relations américano-saoudiennes n’avaient pas besoin de cette crise. Au moment où MBS a ordonné l’élimination de Khashoggi – c’est la seule hypothèse plausible –, Riyad et Washington vivaient une lune de miel inespérée.
Quelques années plus tôt, en 2015, les Saoudiens se sont sentis trahis par les Américains quand Barack Obama a signé l’accord sur le nucléaire avec l’Iran. L’année suivante, certaines déclarations de Donald Trump, concernant notamment l’implication du royaume dans les attentats du 11 septembre, ont fait craindre à Riyad un coup de froid diplomatique. Pourtant, une fois installé à la Maison-Blanche, Trump s’est révélé un allié inespéré. Sa logique était simple : les Saoudiens étant immensément riches, son job de président était de transférer une partie de cette richesse aux États-Unis. Pour couronner le tout, son gendre, Jared Kushner, a rapidement tissé des liens très étroits avec MBS, de quatre ans son cadet. Le mélange peu habituel aux États-Unis entre public et privé, mandat politique et famille semblait sans doute parfaitement normal aux Saoud.
Dans ce contexte, l’assassinat de Khashoggi a constitué une prise de risque inconsidérée. Le journaliste exilé et déprimé n’a jamais représenté qu’une nuisance mineure pour le royaume. En l’occurrence, MBS s’est comporté comme le parrain d’une famille mafieuse qui ne peut tolérer la moindre opposition. Le châtiment doit être exemplaire, disproportionné et inspirer la terreur par sa cruauté et sa brutalité. Et ce n’est pas la première fois que ce prince tombe dans de tels travers.
Son premier faux pas diplomatique a été la guerre au Yémen. Nommé ministre de la Défense par son père le 23 janvier 2015, MBS fait intervenir son pays dans la guerre civile qui ravage son voisin yéménite. Décidant seul – le chef de la garde nationale du royaume a appris l’entrée en guerre par les médias… –, MBS a engagé les forces armées de l’Arabie saoudite dans un conflit meurtrier et coûteux. Ce qui ne devait être qu’une promenade de santé de quelques semaines dure encore, plus de cinq ans après, sans qu’aucun des objectifs saoudiens ait été atteint. Pire, l’Iran est plus impliqué que jamais au Yémen et les fournisseurs d’armes du royaume sont sous pression à cause des énormes dégâts et des très nombreuses victimes civiles du conflit.
Puisqu’une erreur n’arrive jamais seule, deux ans plus tard, toujours aussi brutal, dominateur et sûr de lui-même, MBS se lançait dans une nouvelle aventure géopolitique, toujours au nom de la croisade contre l’Iran. Avec une victime désignée : le Qatar.

Tout commence le 23 mai 2017, tard dans la soirée, quand le site internet de l’agence de presse qatarie diffuse des propos attribués à l’émir, le cheikh Tamim Benn Hamad Al-Thani où il exprime son soutien à l’Iran, au Hamas et au Hezbollah. Après une première réaction confuse, Doha dément rapidement ses déclarations dont il dit ignorer l’origine. Plus tard, une enquête du FBI démontrera que le site web de l’agence de presse du Qatar et d’autres plates-formes médiatiques gouvernementales ont été piratés et que les communiqués incriminés ont été ajoutés par des hackers. Entre-temps, et malgré les dénégations qataries, les fausses citations de l’émir ont largement essaimé dans les médias arabes, notamment aux Émirats et en Arabie saoudite. Quinze jours plus tard, le 6 juin, le New York Times rapporte que ce piratage est le énième épisode de la cyberguerre que se livrent le Qatar et ses rivaux du Golfe. Les médias saoudiens et émiratis ont repris les fausses déclarations de l’émir moins de vingt minutes après leur publication et commencé très rapidement à interviewer des commentateurs qui semblaient préparés à l’exercice. Malgré la fragilité des accusations saoudiennes, le 5 et le 6 juin 2017, l’Arabie saoudite, les Émirats, le gouvernement loyaliste du Yémen, l’Égypte, les Maldives et le Bahreïn annoncent la rupture de leurs liens diplomatiques avec le Qatar, mettant ainsi l’émirat sous blocus. La frontière avec l’Arabie saoudite – seule frontière terrestre qatarie – est fermée et les espaces aériens des pays boycotteurs interdits aux engins qataris. Pris au dépourvu quelques semaines après la visite de Trump à Riyad, les États-Unis, qui possèdent une importante base militaire au Qatar, se seraient bien passés de ce nouvel imbroglio diplomatique.
Au fil de toutes ces péripéties, un schéma commence à se dessiner : MBS est seul maître à bord, contrôlant l’État comme un outil docile entre ses mains sans que personne n’ose s’y opposer. Le prince conduit les affaires étrangères, militaires et stratégiques de son pays comme s’il s’agissait d’une partie de jeu vidéo entre amis. Grand travailleur (son anglais s’est beaucoup amélioré ces dernières années), plein d’énergie et de charme, apprendrait-il de ses erreurs ? Malheureusement, rien ne l’indique…
Cinq mois après le déclenchement de la crise avec le Qatar, MBS frappe à nouveau. Il convoque le Premier ministre libanais Saad Hariri à Riyad pour le séquestrer à l’hôtel Ritz Carlton comme le premier opposant saoudien venu. Quelques jours plus tard, dans une apparition télévisée surréaliste, Hariri annonce sa démission. L’affaire se soldera par une nouvelle débâcle saoudienne : Riyad devra finalement laisser partir Hariri sans explication ni gain politique quelconque.
En somme, quel bilan tirer de l’action et de la personnalité de MBS ? À l’intérieur, MBS a brisé toutes les personnes et institutions susceptibles de lui résister. Cependant, on aurait tort de ne voir en lui qu’un satrape moyen-oriental de bas étage. En effet, MBS a su se doter d’une base politique large qu’il ne cesse de cultiver. Ayant neutralisé l’aristocratie comme l’ont fait jadis les rois de France, MBS fait alliance avec le peuple saoudien et tout particulièrement avec sa jeunesse. Une alliée de poids dans une société où 40 % de la population a moins de 25 ans. Contrairement aux médias occidentaux, nombre de jeunes Saoudiens ont vu d’un très bon œil son coup de filet contre la corruption des princes. Ils sont également nombreux à apprécier ses réformes sociétales. Apparemment, ils ne lui tiennent même pas rigueur d’avoir payé des centaines de millions de dollars pour un yacht qui appartenait autrefois à Donald Trump, 450 millions de dollars pour le tableau Salvator Mundi de Léonard de Vinci et 300 millions pour une propriété en France où il met rarement les pieds. En dehors de la famille royale et des cercles les plus conservateurs et religieux, MBS semble populaire.
C’est sur le terrain international que le bât blesse. MBS donne l’impression de ne pas très bien distinguer l’intérieur de l’extérieur des frontières. Traitant des étrangers comme s’ils étaient ses sujets saoudiens, il part en guerre, organise un blocus, arrête le Premier ministre libanais de la même manière qu’il confisque la fortune de ses cousins.
Dans un premier temps, sa volonté de faire entrer le royaume dans le xxie siècle a pu séduire ses homologues internationaux. À des fins de communication, MBS a dépensé une fortune en cabinets de conseil qui lui ont préparé de magnifiques présentations PowerPoint. Dans un discours en 2017, il reprend tous les termes à la mode : « Mon rêve en tant que jeune en Arabie saoudite et les rêves des êtres humains en Arabie saoudite sont si nombreux, et j’essaie de rivaliser avec eux et leurs rêves et ils rivalisent avec mes rêves pour créer une meilleure Arabie saoudite. » Un comique n’aurait pas fait mieux.
À 85 ans, le roi Salmane ne semble pas être dérangé par les foucades de son héritier. MBS est donc déjà au pouvoir même s’il n’en a pas tous les attributs. Rien ne permet d’espérer qu’une fois installé sur le trône, il changera de tempérament ou de politique. À considérer le monde entier comme un épisode de Game of Thrones, MBS se révèle bel et bien moderne, effroyablement moderne.