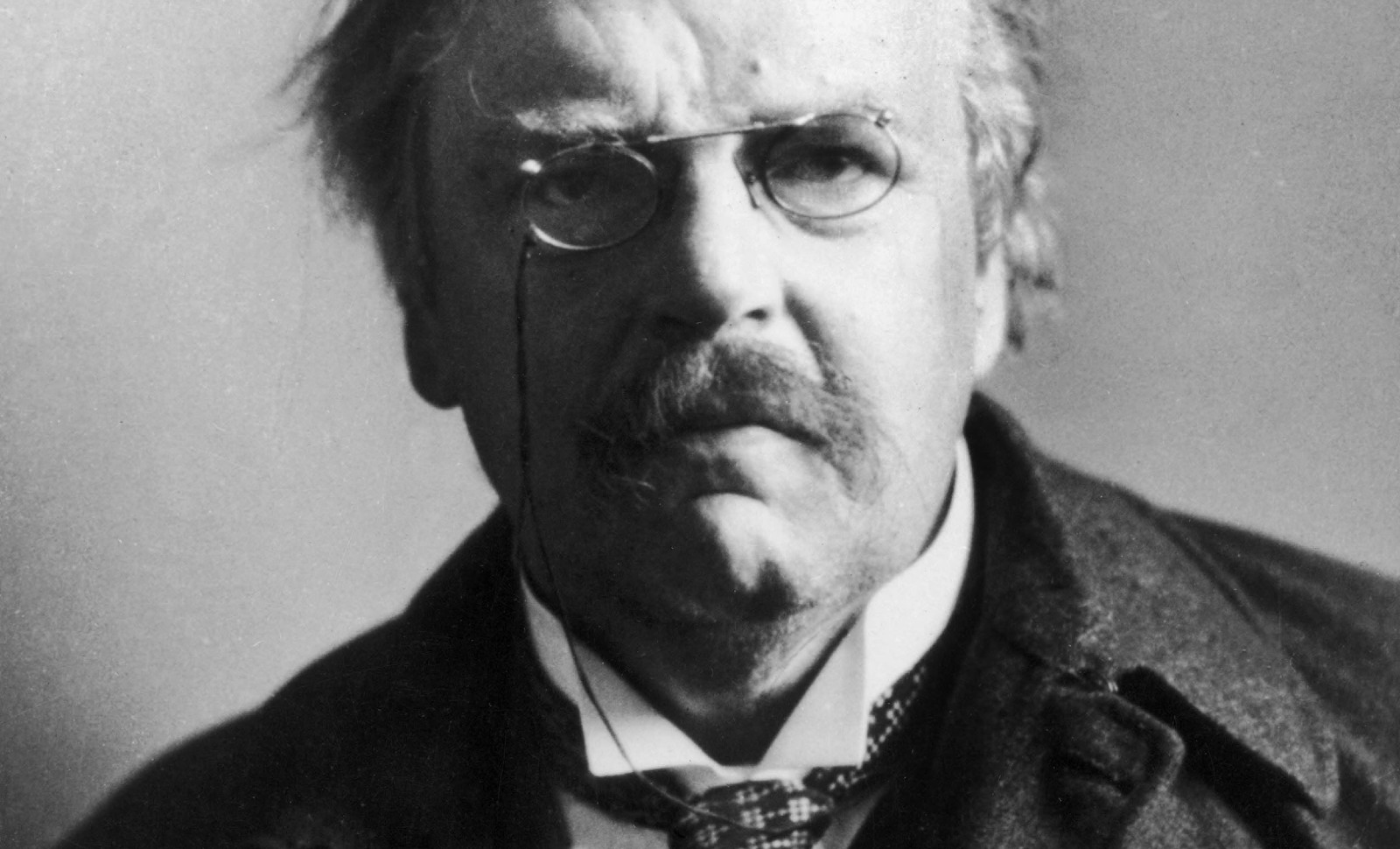La parution d’un recueil de romans d’Octave Mirbeau et d’une nouvelle traduction d’un chef-d’oeuvre de Chesterton permet de lire ou relire ces deux écrivains qui, entre la fin du xixe siècle et le début du xxe, s’attaquent frontalement à leur époque et, dans un rire inquiet et salvateur, en dénoncent la dangereuse folie.
Octave Mirbeau (1848-1917) a commencé sa carrière journalistico-politique à droite, voire très à droite pour devenir un romancier franchement libertaire, la quarantaine venue. Le sens commun veut des évolutions contraires, en oubliant pourtant que Victor Hugo lui aussi a été un jeune romantique monarchiste et légitimiste avant de mourir en père de la République sociale, auréolé de ses combats contre la misère, le travail des enfants, la peine de mort.
On peut chercher dans la vie de Mirbeau une explication biographique à cette évolution brutale qui a fait de l’antisémite un ardent dreyfusard et du polémiste bonapartiste le défenseur de l’anarchiste Ravachol.
Cette explication biographique a un nom : Judith Vinmer. Elle est à Mirbeau ce qu’a été l’Odette de Crécy au Swann de Proust, une demi-mondaine « qui n’est même pas son genre ». Quatre ans entre 1880 et 1884 dont il ressort moralement épuisé. Pourtant, rien ne vaut un chagrin d’amour pour vous décider à écrire enfin un roman. En 1886, le brillant journaliste, de retour de la campagne où il était allé lécher ses plaies de grand fauve, publie Le Calvaire. Ce roman-cauchemar tient de l’exorcisme. C’est à partir du prisme de la pulsion de mort que contient toute passion amoureuse que Mirbeau a l’intuition d’un monde conçu comme un abattoir grandeur nature. La maîtresse cruelle, voire franchement sadique, conduit dans Le Calvaire Jules Mintié, le narrateur, écrivain raté et qui le sait, à la limite du meurtre et de la folie. Il préfère disparaître, habillé en ouvrier, au fin fond de la Bretagne.
Mirbeau, lui, ne disparaît pas, mais devient au contraire un écrivain de premier plan, une voix unique, inclassable dans ce qu’il a été convenu d’appeler la littérature fin-de-siècle. C’est un Bloy athée et anticlérical, mais qui partage avec le catholique inspiré une verve pamphlétaire redoutable et une aptitude rageuse aux chocs frontaux avec son époque. À défaut d’être amis, d’ailleurs, Bloy et Mirbeau s’estimaient et estimaient mutuellement leurs œuvres respectives, ce qui n’allait pas de soi quand on connaît l’exigence et la férocité de ces deux-là en matière de critique littéraire.

On ne retrouve pas la noirceur désespérée du Calvaire dans le volume Mirbeau publié dans la collection « Bouquins » et édité par