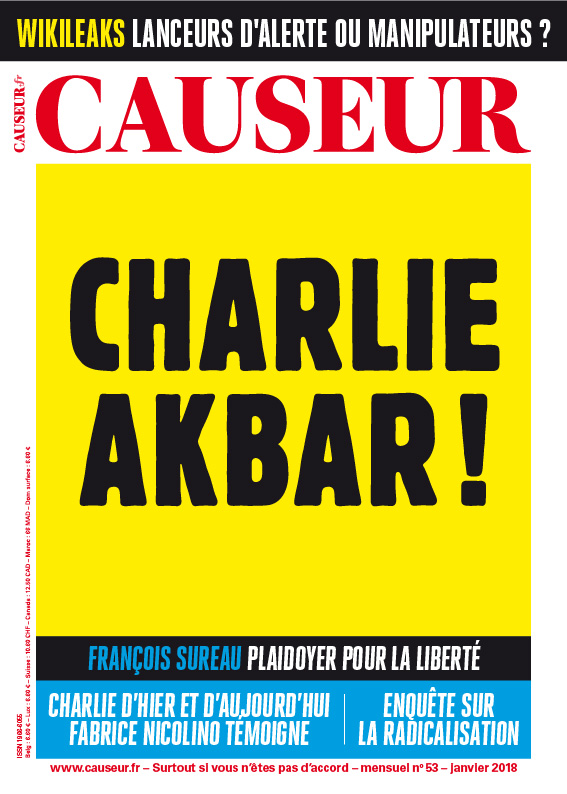Le magnifique Mindhunter de David Fincher ne se contente pas de bouleverser la routine des polars télé américains et de ringardiser la concurrence. A force de dynamiter les règles du genre, c’est un véritable tueur en série.
« Le crime a changé », constate l’un des personnages de Mindhunter dès le premier épisode. Le Vietnam, le Watergate, les hippies et les gauchistes… À la fin des années 1970, l’Amérique ne sait plus à qui se fier, ma bonne dame. Même les criminels ne sont plus ce qu’ils étaient. Fini le classique « je tue pour voler une voiture et la revends pour payer ma drogue » selon la définition donnée par l’un des policiers de la série, place aux meurtriers récidivistes et sans mobile. Des « sequence killers », hasarde Holden Ford, jeune agent du FBI, en sentant confusément qu’il n’a pas encore trouvé le mot juste.
Deux aventuriers en costumes de fonctionnaires
Accompagné de son supérieur, Bill Tench – le meilleur duo de flics depuis l’attelage parfait entre Danny Glover et Mel Gibson dans L’Arme fatale –, il décide d’approcher ces nouveaux visages du crime. Et si Charles Manson n’était pas un cas isolé ? Ford est un premier de la classe, élevé dans le Midwest et qui semble ne jamais avoir entendu parler du Grateful Dead ou des Weathermen ; Tench,