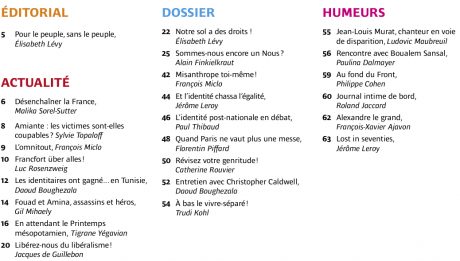Heinrich Heine a causé beaucoup de tort à Emmanuel Kant. Quand Nietzsche se contentait d’affubler le « Chinois de Königsberg » de sobriquets dignes de cours de récréation, Heine écrivait les pages les plus vachardes sur l’auteur des trois Critiques. C’est dans De l’Allemagne que le poète dresse, en 1853, le plus calamiteux portrait du philosophe : « L’histoire de la vie d’Emmanuel Kant est difficile à écrire, car il n’eut ni vie ni histoire ; il vécut d’une vie de célibataire, vie mécaniquement réglée et presque abstraite, dans une petite rue écartée de Königsberg. » Et de propager le bruit que les voisins de Kant savaient exactement « qu’il était deux heures et demie » quand ils voyaient passer le philosophe sous les tilleuls d’une allée à laquelle, de son vivant, la rumeur publique avait déjà donné son nom, complétant le tableau par l’image du vieux Lampe, domestique usé, dont la fonction principale consistait à suivre le maître, parapluie sous le bras. En cas d’averse.
Voilà où naît notre modernité philosophique, voilà où ont été forgés les grands concepts avec lesquels nous tentons encore de penser un monde qui n’est plus tout à fait moderne : nous mettons nos pas dans ceux d’un homme dont la pratique du vivre-ensemble consistait essentiellement à sortir huit fois par jour accompagné d’un porte-parapluie… En cas d’averse.[access capability= »lire_inedits »]
C’est pourtant cet homme, dont Heine écrit qu’il était plus précis que la grande horloge de la cathédrale de Königsberg, qui lance le mot d’ordre des Lumières : « Sapere aude ! » Le criticisme kantien n’est pas une oisive occupation. Il impose au penseur de sacrifier sa propre tranquillité aux injonctions d’une raison parfois véhémente. Il y a un emportement tout « finkielkrautien » dans cette position philosophique-là, une exigence également. Critiquer, c’est littéralement, comme l’expliquera Hannah Arendt, mettre en crise la pensée et celui qui pense. Les trois Critiques portent une radicalité philosophique que la force de l’habitude nous fait souvent perdre de vue.
La question, cependant, reste entière. Pourquoi Kant ne goûtait-il pas aux charmes délicats du « vivre-ensemble » et du « lien social » ? Certes, dans L’Anthropologie du point de vue pragmatique, le plus piètre texte kantien – il n’a pas fait que du bon –, nous avons droit à quelques considérations sur les bonnes bouffes entre copains – point trop n’en faut, surtout pas de femmes – ou sur le spectacle agréable de musiciens jouant sur la place d’un village – seule musique vraiment audible aux kantiennes oreilles.
Nous pensons avec Kant la politique et la sociabilité, mais il n’avait pas la tête d’un de ces emplois du « vivre-ensemble » que Philippe Muray décrit avec férocité dans Modernes contre modernes : « agents d’ambiance, accompagnateurs de détenus, agents polyvalents, agents de médiation, aides-éducateurs en temps périscolaire, agents d’accueil des victimes ». Heinrich Heine se hasarde à une explication : ce n’est pas en baguenaudant que le philosophe de Königsberg aurait pu écrire ce qu’il a écrit. Question de volume et de temps.
Au lieu d’aller vider une bière au bistrot du coin et de taper la discussion avec les habitués, Kant lui-même nous révèle la nature profonde de son attitude quasi asociale. Il le fait, au moins, à deux reprises au sein de son œuvre[1. « Analytique du sublime » in Critique de la faculté de juger et « Éléments métaphysiques de la Doctrine de la vertu » in Métaphysique des mœurs].
.
Dans la Critique de la faculté de juger, il écrit que la « misanthropie », c’est nul, et que ça va pas le faire. Enfin, il avait un peu de tenue, parce qu’il était allemand, et se contentait de qualifier la misanthropie d’attitude « laide et méprisable ». Mais il va plus loin et passe à confesse : « Il existe toutefois, écrit Kant, une misanthropie (très improprement dénommée), et la disposition à celle-ci vient assez souvent avec l’âge à l’esprit de beaucoup d’hommes bien pensants ; elle est bien assez philanthropique en ce qui touche la bienveillance, mais par une longue et triste expérience elle est bien éloignée de la satisfaction que peuvent donner les hommes ; la tendance à la retraite, le vœu chimérique de passer sa vie dans une maison de campagne écartée, ou (chez les personnes jeunes) de vivre toute sa vie avec une petite famille sur une île inconnue du reste du monde, rêve que les romanciers et les poètes faiseurs de “robinsonnades” savent si bien utiliser, en donnent la preuve. La fausseté, l’ingratitude, l’injustice, la puérilité des fins qui sont considérées par nous comme importantes et grandes et dans la poursuite desquelles les hommes se font les uns aux autres tout le mal possible, se trouvent dans une telle contradiction avec l’Idée de ce qu’ils pourraient être, s’ils le voulaient, et sont si contraires au vif désir de les voir meilleurs, que pour ne point haïr les hommes, puisqu’on ne peut les aimer, le renoncement à toutes les joies de la société paraît seulement un petit sacrifice. »
On sent le vécu, l’expérience de sous-bibliothécaire mal payé et contraint de faire visiter la Bibliothèque royale de Königsberg à des importuns. Est misanthrope, nous dit Kant, celui qui se fait une trop haute idée du genre humain pour pouvoir en côtoyer les spécimens concrets. C’est le vieux geste de Diogène le Cynique qui hante encore et toujours l’histoire de la philosophie : on trimballe sa lanterne sous le soleil, on cherche un Homme parmi les hommes et l’on n’en trouve point. « Je cherche un Homme » : ça a la même intensité poignante que le refrain d’Où sont les femmes ?, sauf qu’il est plus aisé à Patrick Juvet de trouver une femme qu’au philosophe de croiser un Homme.
Molière, dans Le Misanthrope, ne nous dit pas autre chose. Alceste, vieux barbon de 40 ans, s’évertue à « rompre en visière avec le genre humain ». Il le répète tout au long de la pièce et le dit à qui veut l’entendre. C’est que la misanthropie est paradoxale : le misanthrope qui veut clamer sa haine des hommes ne peut le faire qu’au milieu d’eux. Alceste ne serait proprement rien s’il s’était retiré dans un ermitage. C’est à la condition d’être dans le monde qu’il est en capacité d’admonester ses semblables et de les réprimander sur ce qu’ils sont en lieu et place de ce qu’ils devraient être.
Dans un tout autre genre, Casanova n’exprime rien d’autre qu’une forme particulière de misanthropie, c’est-à-dire de bienveillance et de déception mêlées, lorsqu’il cherche, sans jamais trouver ni l’une ni l’autre, la Liberté dans le libertinage et l’Amour parmi les amours.
Jean Genêt portera jusqu’à l’extrême, c’est-à-dire l’assassinat, la figure du misanthrope en la transférant sur celle de l’homosexuel. Des couilles de mâle poussent ici à l’anthrôpos aristotélicien, il devient andros. Qu’on relise Pompes funèbres ou Miracle de la Rose, Genet met en scène des hommes qui, ne trouvant pas autour d’eux l’incarnation concrète de l’idée qu’ils se font de l’Homme et de la virilité, les baisent et les tuent.
Attention : tout misanthrope ne finit pas sa course en assassinant son prochain. Prenez, par exemple, Alain Finkielkraut : 95 % de l’humanité pensante, c’est-à-dire la moitié du 6e arrondissement de Paris, serait prête à jurer, la main sur le cœur, qu’il est le plus achevé des misanthropes actuels. Ah ! ce qu’il est critique, bougon, ronchon. Rien ne semble trouver grâce à ses yeux. Figurez-vous qu’il n’a même pas d’iPad. C’est qu’il voudrait bien faire la courte échelle aux esprits étroits pour les élever un peu, détourner nos yeux des écrans pour nous donner à voir la littérature, l’art, la raison. « Vous montez ? » : c’est la question fondamentale de tout misanthrope convenable. Et de tout philosophe, après Kant.
Dès lors, il n’y a pas de philosophie conséquente qui ne finisse, un jour ou l’autre, par devenir une misanthropie. Elle ne nous apprend pas à vivre ni même à mourir, elle est le fruit d’une « longue et triste expérience », mais aussi d’une exceptionnelle « bienveillance ». Il n’y a pas plus bienveillant que celui qui réserve à l’homme les plus hautes promesses.
Et si cette attitude est sublime, c’est que pèse sur nos têtes la définition qu’Aristote donne de l’homme : « ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον » (L’homme est un animal politique). La communauté politique n’est pas une juxtaposition de « je » : on ne fait pas de l’un avec du multiple. Le « nous » (l’espèce, mais aussi la nation, la civilisation, la communauté, etc.) préexiste à chacun et est une condition de possibilité de notre propre existence individuelle. Le nomadisme, c’est-à-dire l’état dans lequel Rousseau conçoit l’homme à l’état de nature, nous est interdit : l’homme, nous dit Aristote, est un être de relation.
Vivre, donc, c’est nécessairement vivre ensemble. Il n’y a pas d’échappatoire. Les thébaïdes, les ermitages et la solitude des déserts n’existent pas. Et lorsque l’on croit en voir, ce ne sont que des mirages. Même saint Antoine, le fondateur de l’érémitisme chrétien au IVe siècle, vivait entouré de disciples et, dans la société, tantôt du Bon Dieu, tantôt du Diable. C’est Gilbert Bécaud qui a raison : « La solitude, ça n’existe pas. » Nous pouvons éprouver l’illusion d’être seuls au monde. Nous ne le sommes, en définitive, jamais : « je » est toujours « nous », même un « nous » qui s’ignore, s’invente et se fantasme.
Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Sauf qu’aujourd’hui, on nous demande non seulement d’effectuer notre peine, mais aussi de nous en réjouir. Alexandre avait fait de son cheval Bucéphale un dieu, notre époque a fait du « vivre-ensemble » une valeur hors norme. On ne dénombre plus les missions gouvernementales et parlementaires, les agences et les associations, les collectivités et les entreprises qui font du « vivre-ensemble » un impératif catégorique. Il faut « militer pour le vivre-ensemble », « créer du lien social », le « tisser » et, quand il se défait, en « retisser ». On ne fait plus de politique, mais du textile.
Or, quoi qu’il advienne, nous vivons ensemble et, quoi que nous fassions, nous tissons entre nous du lien social. Un couple fêtant ses noces de diamant a expérimenté la vie commune, une prostituée et son micheton aussi. Un assassin tisse avec la victime qu’il égorge une manière, étrange et définitive, de lien social. La guerre même est l’une des variations les plus extrêmes du vivre-ensemble. Partout où existe un être humain existe de la relation. Partout où la chair humaine exhale son odeur, surgissent à proximité d’autres corps et, bientôt, d’autres cadavres. Tout cannibale digne de ce nom apprend ça dès la maternelle.
Désapprenons alors jusqu’au terme même de « vivre-ensemble », pont-aux-ânes de l’idéologie contemporaine. Acceptons ce que nous sommes : des animaux politiques, c’est-à-dire des êtres doués de vie et de relation, des êtres voués à excéder, par leurs œuvres, leur propre finitude. Cessons de vouloir être tenus pour des animaux de compagnie. C’est le programme des Lumières. Et il est toujours devant nous. [/access]
Cet article est issu de Causeur magazine n ° 41.
Pour acheter ce numéro, cliquez ici.
Pour s’abonner à Causeur, cliquez ici.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !