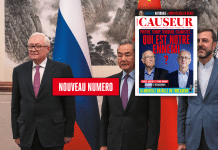Le débat sur les fake news part sur des bases malsaines: la grande majorité de la population est à la fois dépendante des médias et convaincue qu’ils ne répercutent pas ce qu’elle vit au quotidien. Nourris par cette défiance anti-élites, les réseaux sociaux offrent une caisse de résonance virtuelle aux pires balivernes. Entretien avec l’intellectuel Marcel Gauchet.
Causeur. Du collier de la reine à l’affaire Dreyfus, les rumeurs et les mensonges, parfois propagés au plus haut niveau de l’État ne datent pas d’hier. En quoi les « fausses nouvelles », qui inquiètent tant le président de la République, sont-elles un phénomène nouveau ?
Marcel Gauchet. Cette histoire est l’exemple même de l’illusion de nouveauté que peut créer l’adoption d’une langue étrangère. Une vieille plaie devient, par la magie de l’anglais, un mal inédit et tellement dramatique que le président de la République se doit de monter en première ligne. Reprenons nos esprits en revenant aux faits : dans la campagne présidentielle française de 2017, quelle fausse nouvelle aurait influencé le résultat ? Aucune ! Quel est donc ce spectre qu’il y aurait urgence à exorciser ?
La nouveauté du phénomène, car il y en a quand même une, ne réside pas dans l’existence de fausses nouvelles, mais dans leurs conditions d’émission et de circulation. D’abord, le peuple dispose désormais de moyens incomparablement puissants de lancer et de répercuter, via internet et les réseaux sociaux, des bobards. La caisse de résonance numérique est autrement plus efficace que le bouche-à-oreille, et elle est ouverte à tous. Aujourd’hui, le péquin moyen peut diffuser des messages à la terre entière en dehors de tout contrôle, filtrage ou manipulation d’en haut. Autrement dit, le pouvoir de manipulation se démocratise par l’intermédiaire de la technique.
Mais en même temps, les progrès de la connaissance et, osons le dire, de la Raison, devraient nous rendre moins vulnérables aux bobards.
C’est l’autre aspect du problème. Une chose est l’existence de fausses nouvelles, autre chose est le retentissement que certaines fausses nouvelles sont susceptibles d’avoir parce qu’elles prennent un sens qui les rend crédibles auprès des gens. Ce n’est pas nouveau en soi, mais il est visible que le phénomène prend de l’extension et il faut se demander pourquoi. Le tri rationnel entre le vrai et le faux ne fonctionne plus quand les gens sont prêts à croire une rumeur tout en sachant qu’elle ne repose sur rien, parce qu’elle leur paraît exprimer ce qu’ils ressentent.
L’histoire du prétendu compte aux Bahamas de Macron, par exemple ?
Voilà, on n’en a aucune preuve, mais on se dit que le « banquier », comme dit Mélenchon, est bien du genre à en avoir un ! Cela prend tout son sens dans un contexte marqué par une extraordinaire méfiance des populations par rapport à toute parole jouissant d’un statut officiel. Ça commence dans la salle de classe, avec des étudiants qui vérifient sur Wikipédia si ce que raconte le prof est vrai, puis ça continue dans la société et ça prend une tournure paroxystique en politique. Un quart à un tiers de la population est totalement réfractaire au discours des politiques !
Si les Français se détournent massivement des politiques et