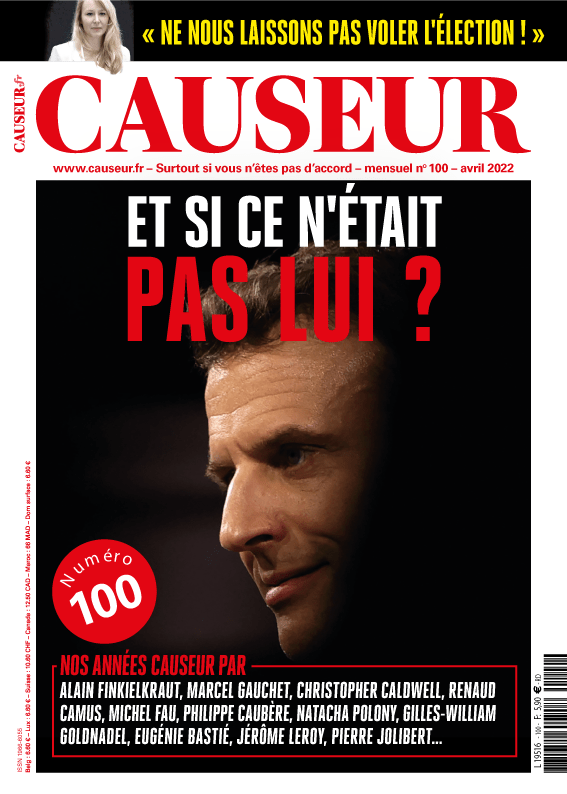Macron n’a pas réalisé les réformes promises mais sa capacité à gérer les crises a séduit les électeurs. À sa décharge, les institutions de la Ve République sont ingrates avec nos présidents. Élus avec une majorité parlementaire quasi automatique, ils peuvent appliquer un programme minoritaire qui les rend impopulaires.
Il y a plusieurs manières de raconter l’histoire du quinquennat d’Emmanuel Macron. La plus facile est de suivre les courbes de sa popularité. Cela donne une pièce en trois actes.
L’acte I ou « la plongée » commence avec son élection en mai 2017 et se termine dix-huit mois plus tard. Il est rythmé par plusieurs tableaux : juin 2017, projet de loi de la moralisation de la vie publique entaché par les affaires Ferrand et Modem ; été 2017, licenciement du général de Villiers ; été 2018, affaire Benalla. Au cours de cette phase, Jupiter dégringole pour atteindre à la fin de sa première année complète à l’Élysée le point le plus bas dans les sondages. Commence alors l’acte II, « les Gilets jaunes ». En novembre et décembre 2018, le pays et surtout Paris sont secoués par des violences hebdomadaires dont la répétition n’amoindrit pas la stupeur qu’elles suscitent. Ce sont les heures sombres du quinquennat où Emmanuel Macron touche le fond. L’Élysée a peur. La sortie de crise par l’opération « débat citoyen » apparaît a posteriori comme le tournant de son mandat. Plus jamais il ne sera aussi impopulaire. Vers mars-avril 2020, c’est le début de l’acte II, la guerre contre le Covid. Un nouveau Macron arrive sur scène – le président protecteur. Commence alors l’acte III, le « Covid ».
A lire aussi : Benalla, l’homme du président
La popularité de Macron, affaiblie par la résistance à la réforme des retraites fin 2019, poursuit sa baisse quand il décide, mi-mars 2020, de confiner le pays. Elle remonte en flèche pour s’établir au niveau où elle se maintiendra jusqu’au début 2022, moment