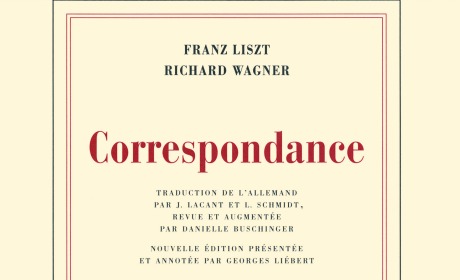« Un géant en appelle un autre, à travers les intervalles déserts des temps, sans qu’ils se laissent troubler par le vacarme des pygmées qui grouillent à leurs pieds, ils continuent leurs hautains colloques d’esprit. » : c’est ainsi que Nietzsche, à la suite de Schopenhauer, opposait sa « République des génies » séparés par les siècles, à la « République des lettres » (en allemand « République des lettrés », Gelehrtenrepublik), ce réseau de contemporains, écrivains, savants, antiquaires et amateurs, premier tissu de l’unité culturelle de l’Europe, dont Marc Fumaroli s’efforce depuis quelques décennies de retracer la cartographie engloutie.
Rares sont les livres capables de contrer aussi efficacement le lieu commun de cette opposition que la correspondance entre ces deux génies romantiques[access capability= »lire_inedits »], qui surent être de vrais alliés et, plus encore, de grands amis – tout en étant parfaitement contemporains : Liszt, né en 1811 et mort 1886, Wagner né en 1813 et disparu trois ans plus tôt, en 1883.
Pas une page de ce riche monument (402 lettres, 150 pages d’annexes, sans compter les « textes de liaison » fouillés et précis et l’indispensable index) qui, malgré les refroidissements inévitables, n’oppose un démenti au préjugé de l’inimitié des génies. La confiance règne presque sans discontinuer depuis la première lettre de débutant timide que Wagner hasarde, de Paris, en mars 1841, à son indifférent aîné, jusqu’à la dernière missive, écrite par le Hongrois à Venise, en décembre 1882. La mort de Liszt, survenue trois ans plus tard à Bayreuth, pendant le fameux Festival de ce confrère qui ne fut jamais vraiment un concurrent, met un point final éloquent à cet échange. Point d’orgue de plus de quarante années d’une conversation épistolaire témoin de toutes les humeurs, tous les appels au secours, tous les partages… Certes, le ton semble souvent déséquilibré : Wagner est ardent et volubile, Liszt plus posé et mesuré, plus tacticien, plus froid peut-être. Ainsi, en 1849, le « virtuose qui compose », coqueluche du public européen, multiplie les conseils de tous ordres à Wagner : non seulement jouer la carte parisienne en faisant donner son Rienzi dans la capitale, quitte à faire quelques concessions au goût français, mais aussi abandonner le « galimatias socialiste » qui l’a mis au ban de l’Allemagne… Ne plus perdre son temps aux « colères personnelles »… C’est tout un bréviaire des « moyens de parvenir », un manuel de décrassage des (mauvaises) humeurs de l’artiste post-beethovenien que Liszt dispense à son confrère, en même temps qu’il met à sa disposition son carnet d’adresses et, bien souvent, son portefeuille… Rusé, le Hongrois sait aussi imaginer que son ami saura convertir ses idées politiques en opportunité publicitaire : son histoire de Cola Rienzi, rebelle de la Renaissance italienne, pourra, l’époque s’y prête, faire le tour de l’Europe et exprimer l’esprit révolutionnaire du temps à la manière, dix-huit ans plus tôt, de la Muette de Portici d’Auber, Scribe et Casimir Delavigne, origine de la révolution belge…
Nous sommes donc en plein romantisme, c’est-à-dire au moment historique où la respublica literaria, cette internationale des esprits, se délite sous les coups conjugués de l’égo des créateurs et de l’égoïsme des nations. Quand on connaît ou croit connaître la posture nationaliste de Wagner, qui passe souvent, de surcroît, pour résumer et porter à son paroxysme le romantisme, on imagine que la solidarité devrait définitivement laisser la place à la glorieuse solitude des démiurges. Et pourtant, le modèle du poète maudit et solitaire n’est tout simplement pas tenable pour un musicien dramaturge qui cherche à s’imposer sur la scène européenne. Le Prométhée de « l’art total » lui-même a besoin du soutien attentif d’un grand contemporain, et le compositeur hongrois joue pour lui ce rôle de grand facilitateur dont Wagner sait profiter amplement sans lui ménager, d’ailleurs, ni la reconnaissance ni l’admiration. Le secours dépasse souvent les simples bons offices : on rencontre dans ces pages un Wagner émouvant, plongé dans la misère, qui supplie Liszt de lui procurer le plus modeste pécule : « J’ai besoin de bois et d’un pardessus chaud, vu que ma femme ne m’a pas apporté mon vieux paletot, parce qu’il était en trop piteux état »… Sa détresse ne lui inspire pas seulement des accents déchirants, mais aussi une amitié intense, quasiment amoureuse, un peu comme Voltaire jadis écrivait à Frédéric : « Je rêve à mon prince comme on rêve à sa maîtresse. » L’auteur de Lohengrin déborde d’émotion et d’attentes, évoque son impatience à recevoir la moindre lettre de son ami, avoue composer pour lui et en pensant à lui : « Te revoir enfin au mois de septembre est pour moi le seul rayon de lumière qui éclaire la longue nuit de cette triste année » (1855). On pourrait citer mille aveux, mille assertions de la même veine. Wagner s’épanche et se répand volontiers en humeurs aussi bien qu’en théories, témoin la longue lettre où il débite, par le menu, sa philosophie à la Feuerbach de plus en plus relayée par les idées de Schopenhauer. Les choses se compliquent à mesure que la princesse Carolyne de Sayn-Wittgenstein gagne en influence auprès de Liszt et cherche à faire du musicien hongrois, dont elle est devenue l’égérie, le premier compositeur de son temps. La princesse est volontiers théologienne et le bouddhisme athée de Wagner n’est pas tout à fait pour lui plaire. Sans parler même, bien sûr, du moment où, dérobant Cosima à son premier mari, le chef d’orchestre Hans von Bülow, Wagner devient le gendre de son mentor. Mais finalement, par-delà un premier refroidissement, qui doit beaucoup à l’influence de la princesse, l’entrée de Wagner dans la famille Liszt a plutôt rapproché encore les deux « génies », sur un plan désormais plus intime.
La complémentarité des caractères, servie par l’amour supérieur de la musique, explique la constante réussite de cette rencontre. Celui qui deviendra « l’abbé Liszt » était un être sociable, mondain même, d’une amabilité notoire, d’un dévouement extrême (et parfois dévorant), toujours prêt à aider et à élever ses jeunes confrères. En cela, s’interroge Georges Liébert, inspiré par une pensée de Gracq, Liszt fut peut-être déterminé, profondément, par une béance inquiétante au cœur de sa créativité. La générosité n’a pas bonne presse à notre ère du « soupçon » et l’on se demandera volontiers pourquoi, à force de se rendre utile, Liszt risqua de jouer les utilités, et comment, pour seconder les autres, il faillit se rendre secondaire. Ainsi, cette relation intense qui pose la question du dialogue des génies à l’heure romantique, interroge aussi la montée du commentaire dans l’art, liée à la crainte du caractère subalterne de l’interprète.
Sorte de génie parodique postmoderne avant l’heure, Liszt, « virtuose qui compose », fut aussi transcripteur et herméneute hors pair de l’œuvre des autres, au point de sacrifier peut-être son propre sillon, tel un Sainte-Beuve de la musique. Wagner lui-même, Liébert le souligne dans son avant-propos éclairant, s’inquiétait de l’honorable dispersion de son maître et ami, faiblesse secrète qui empêcha peut-être le grand interprète de se concentrer autant qu’il l’aurait fallu sur son talent de créateur.
Chacun en jugera. En tout cas, après que Liszt, flanqué de Lola Montès, eut entendu Rienzi à Dresde le 29 février 1844, il ne lâcha jamais Wagner et fit tout pour que le « miracle » de son œuvre « sublime » advienne au grand jour et trouve son public : c’est le monument de cette amitié des sommets que dressent ces pages et leur riche appareil critique, aussi précis que maniable. « Le parfait est censé ne s’être pas fait », affirmait Nietzsche. Pourtant, c’est l’effet exactement inverse que produit cette magnifique visite guidée dans les coulisses de ces deux œuvres.[/access]
Franz Liszt, Richard Wagner, Correspondance. Nouvelle édition présentée et annotée par Georges Liébert, Gallimard, « NRF », 2013
*Photo:DR
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !