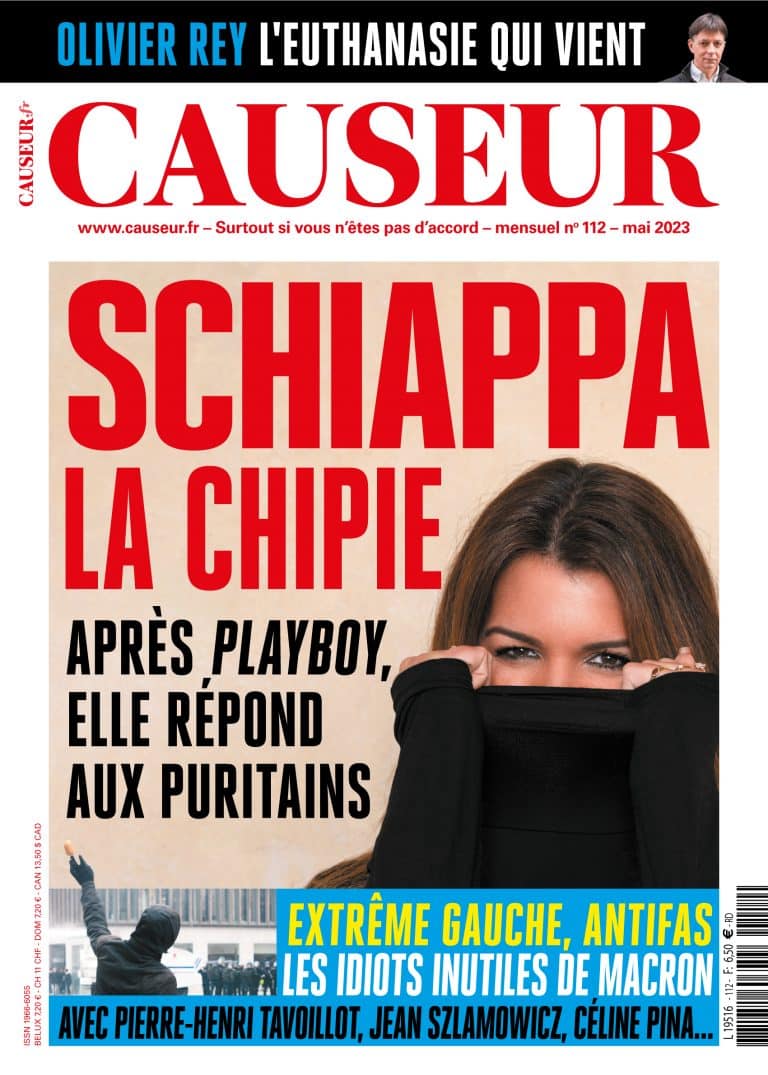Il est probable que l’euthanasie sera légalisée en France. Cette maîtrise de sa propre mort, aboutissement ultime du contrôle de sa propre vie, est réclamée par une grande partie de la population. Mais cette mesure individualiste se double de tant de dérives et de paradoxes que c’est la société entière qui en paiera les conséquences.
Sondage après sondage, une grande majorité de la population se déclare en faveur de l’« euthanasie ». On peut certes critiquer la façon dont les questions sont formulées, qui favorise une réponse de ce genre, mais n’ergotons pas : les résultats sont assez massifs pour être significatifs. Avant de discuter des conclusions législatives qu’il convient d’en tirer, il est bon de s’interroger sur ce qui motive pareille position.
La « culture du projet »
Le premier élément à prendre en compte est un changement profond dans le rapport à la mort. Dans un pays comme la France, au xviiie siècle, un enfant sur deux n’atteignait pas l’âge de 11 ans. Aujourd’hui, plus de neuf décès sur dix surviennent après 60 ans. La mort, de menace toujours présente, a été repoussée dans les marges. « On savait autrefois (ou peut-être le pressentait-on) qu’on contenait la mort à l’intérieur de soi-même, comme un fruit son noyau. […] Et quelle mélancolique beauté était celle des femmes, lorsqu’elles étaient enceintes, debout, et que, dans leur grand corps, sur lequel leurs deux mains fines involontairement se posaient, il y avait deux fruits : un enfant et une mort. » Ce temps est révolu, Rilke l’avait compris. On continue de mourir, certes. Non plus, cependant, parce que la vie est, selon la formule de Hans Jonas, « une aventure dans la mortalité », mais parce qu’il reste des défaillances de la machine humaine que l’on ne sait pas surmonter ou pallier. Si jamais Jeanne Calment, prolongeant de quelques années encore sa vie, s’était éteinte durant la canicule de 2003, à 128 ans, elle ne serait pas morte de vieillesse mais de l’incurie du gouvernement n’ayant pas su prendre toutes les mesures adéquates pour protéger nos anciens.
Par ailleurs, comment définir l’humain ? La question, qui a travaillé la philosophie pendant plus de deux millénaires, a enfin trouvé sa réponse : l’humain est un être qui fait des projets. Si le Projet pouvait parler il dirait : Moi, le Projet, je suis partout. Tout le monde doit faire des projets, tout le temps, à l’intérieur du grand projet moderne qu’est le Progrès. Or, comme relevé il y a un siècle par Max Weber, une vie immergée dans le Projet et le Progrès ne devrait pas avoir de fin, car il y a toujours un nouveau projet à mener à bien, un nouveau progrès à accomplir. « Abraham, ou n’importe quel paysan d’autrefois, pouvaient mourir “âgés et rassasiés de jours” parce qu’ils étaient installés dans le cycle organique de la vie, parce qu’il leur semblait que la vie leur avait apporté, au