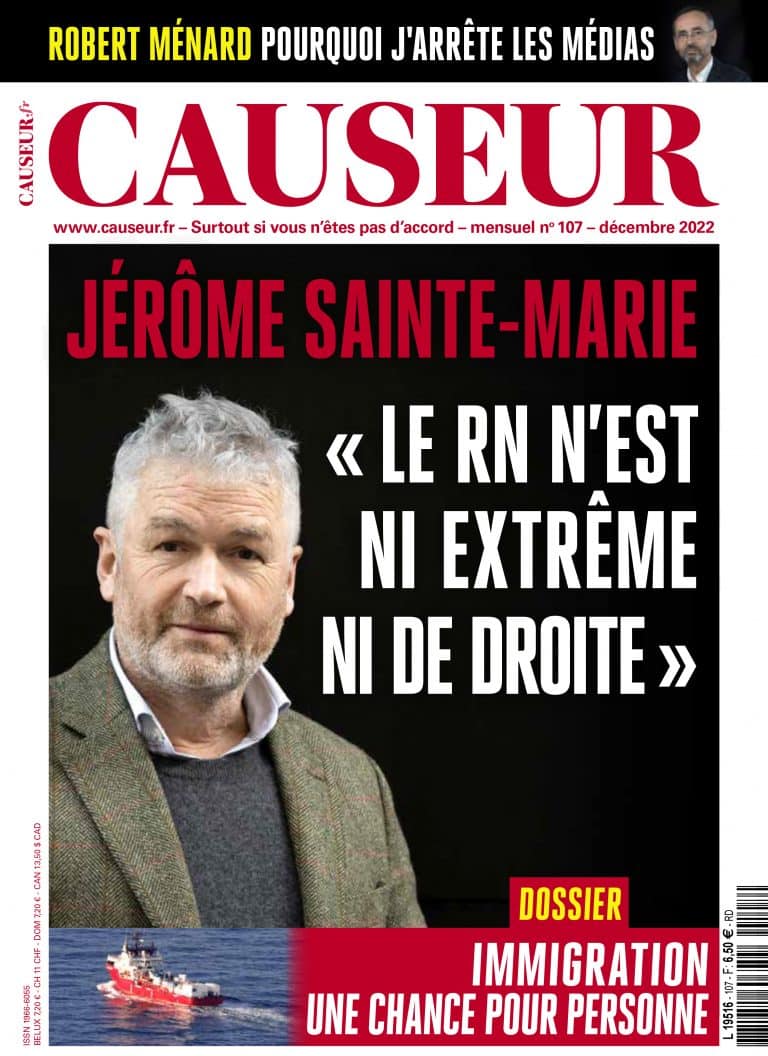La nouvelle présidente du Conseil italien n’est pas la dangereuse postfasciste décriée par ses adversaires. Dans l’exercice de l’Etat, elle se révèle technique, pragmatique, voire conciliante. Et la crise de l’Ocean Viking a révélé qu’elle pouvait défendre ses idées sans renoncer au cadre européen.
Le 25 octobre, au lendemain du discours de politique générale de Giorgia Meloni au Parlement, 44 % des Italiens ont affirmé leur confiance en leur nouvelle présidente du Conseil.[1] Il y a quelques mois encore, personne n’aurait parié sur une telle adhésion. Meloni étonne et rebat les cartes du souverainisme à l’italienne. Elle déstabilise les observateurs européens et les pousse à changer de lexique : désormais au pouvoir, une stratège insoupçonnée apparaît derrière la prédatrice politique qui ne peut plus être réduite aux interventions racoleuses de sa campagne électorale.
Une ascension étonnante
Au terme des élections législatives de septembre, la coalition de droite a remporté 43,8 % des voix et le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, est arrivé en tête avec 26 % des suffrages, contre 4,3 % en 2018. Il est allié à Forza Italia de Silvio Berlusconi dont la longévité frise la science-fiction et à la Lega de Matteo Salvini, qui n’a séduit que 8,9 % des votants contre 18 % quatre ans plus tôt. « Aucune surprise. Mais Salvini s’est pris une vraie raclée tout de même », remarque Marco qui tient le bar Rialto, au centre de Venise, où l’on commente chaque matin l’actualité politique. Autour de lui, on glose sur l’effet de vases communicants. « La Meloni » a siphonné les voix de son ex-concurrent avec une habileté qui laisse pantois. Autrefois jugée plus outrancière que Salvini, elle a emprunté le virage de la respectabilité tout en refusant de participer au précédent gouvernement multipartite de Mario Draghi, contrairement à la Lega qui a ainsi déçu son électorat. Les Italiens ont donné l’avantage au seul parti antisystème : Fratelli d’Italia. Tous deux résolument souverainistes, Salvini et Meloni se sont toujours opposés à la technocratie bruxelloise. Mais Meloni ne l’a pas fait en faveur de la Russie, contrairement à Salvini, dont le parti a reçu des financements russes maintes fois épinglés par la presse italienne. Elle s’est rapprochée de la Pologne en prônant une Europe catholique ; et elle a approuvé les sanctions