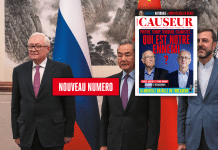Notre contributeur Philippe Bilger, magistrat et président de l’Institut de la Parole, raconte son rapport aux médias et à ses acteurs.
Raphaël Enthoven a cette chance d’échapper toujours à la sottise. Qu’on soit en désaccord ou non avec lui, sa pensée stimule et la contradiction qu’on lui oppose donne du prix à sa propre réflexion. Ainsi, quand il déclare que « travailler dans les médias, c’est gagner sa vie en faisant un métier de drogués », il me semble qu’il se trompe et qu’en tout cas cette affirmation est largement à nuancer, qu’on « travaille dans les médias » ou qu’on soit chroniqueur régulier dans ceux-ci.

Cette appréciation de Raphaël Enthoven m’a d’autant plus intéressé qu’elle me permet de faire état d’une évolution qui m’a métamorphosé au fil des ans. En substance je suis passé, notamment sur les plans professionnels – justice et médias – d’une solitude désirée et toujours défendue, avec un zeste de narcissisme, à la certitude qu’on ne pouvait jamais être exceptionnel, voire seulement bon, tout seul.
A lire aussi: L’extrême-centre et