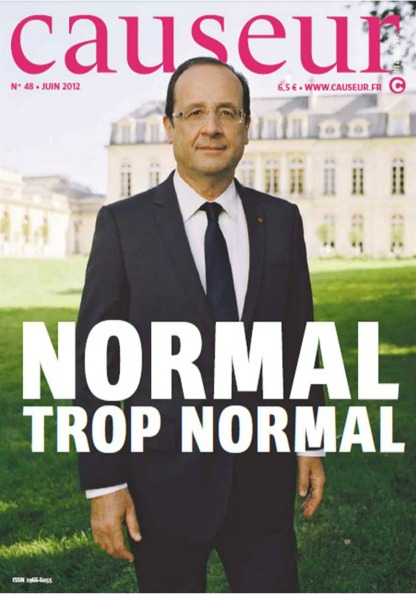L’art tauromachique reste inscrit au « patrimoine immatériel » de la France. Les cris d’orfraie des amis des bêtes n’ont pas empêché cet acte de reconnaissance du legs inestimable que nous ont fait nos amis espagnols. Dans la symbolique économique, le bel animal revêt cependant une signification opposée à celle que lui a attribuée la tauromachie[1. Le monde entier connaît le taureau de bronze de Wall Street. Dans le jargon des financiers, bullish market (de bull, taureau) désigne un marché à la hausse et bearish market (de bear, ours) un marché à la baisse.]. Tandis que le taureau statufié de Wall Street incarne l’optimisme des marchés, le noble acteur des arènes espagnoles est voué, sauf cas d’espèce, à mourir sous les coups du matador qui l’a mis en scène. Toute la révérence qui entoure la victime du drame tauromachique n’empêche pas que c’est à l’homme que revient en définitive l’honneur d’incarner la fierté et la bravoure espagnoles.
Ces deux symboliques du taureau, promis à la mort ou annonciateur de succès, tissent une parabole de la trajectoire espagnole des vingt dernières années.[access capability= »lire_inedits »] Le « miracle espagnol » renvoie simultanément au taureau symbole d’optimisme de Wall Street et au matador terrassant la pauvreté et le chômage pour s’installer parmi les puissances économiques du monde. Mais les vents économiques sont désormais contraires et les symboles se sont retournés. L’Espagne n’est plus le puissant animal de Wall Street ni le glorieux matador, mais le taureau blessé qui attend, au centre de l’arène, une fin aussi éprouvante qu’inévitable.
La modernisation heureuse
Adopté le 9 juin, le plan de sauvetage des banques espagnoles, sixième du genre dans la zone euro depuis le 10 mai 2010, a dessillé les plus ignorants. Il y a peu de chances que Ségolène Royal proclame, comme elle le fit à l’hiver 2007, que « l’Espagne a trouvé le secret de la croissance moderne » ou que Michel Sapin propose l’Espagne comme modèle de croissance à la France embourbée comme au printemps 2008. Du FMI, à la Commission européenne, de l’OCDE aux agences de notation, tous les économistes institutionnels confirment aujourd’hui la faillite virtuelle d’un pays qui semblait avoir enrayé le déclin historique qui l’a accablé à partir du dix-septième siècle.
La chute brutale de l’Espagne, du piédestal où on l’avait installée, appelle d’autres explications que les assertions à l’emporte-pièce prodiguées par les médias. Avant d’analyser les erreurs stratégiques du pays et la corruption qui mine son économie, il faut tenter de comprendre comment la patrie de Cervantès avait renoué avec le succès. Le naufrage actuel est la conclusion d’un cycle contrasté, une première phase d’essor et de modernisation véritable ayant été suivie d’une deuxième période, caractérisée par une véritable folie stratégique.
Tout commence à la fin des années cinquante, avec l’arrivée au pouvoir, dans le gouvernement franquiste, de ministres appartenant à l’Opus Dei qui pensent, à juste raison, que l’Espagne ne pourra pas se moderniser par ses propres forces. Pour gagner du temps, tout en préparant l’inéluctable chute du régime, ils plaident pour l’ouverture du pays aux investissements directs étrangers et emportent la décision du dictateur nationaliste. C’est alors que l’industrialisation commence au-delà des régions traditionnellement dynamique –Catalogne, Pays basque et Asturies. Les entreprises américaines, japonaises, allemandes et françaises sont accueillies à bras ouverts[2. La plus grande usine du groupe PSA, située à Vigo, est issue d’un atelier de fabrication de fourgonnettes 2CV installé en 1958.]. En dépit du retard des infrastructures et de la faiblesse des revenus des ménages espagnols qui limitent les débouchés offerts aux industriels étrangers installés sur le territoire, les premiers résultats sont encourageants. Mais il faudra attendre que le départ ad patres du Caudillo mette un terme à l’isolationnisme politique et diplomatique du pays pour que l’on comprenne que l’Espagne est entrée dans l’antichambre du développement.
Cette période de modernisation heureuse se poursuit avec la normalisation politique et l’entrée du pays dans la Communauté européenne, à la veille de la mise en œuvre des « fonds de cohésion structurels » que Jacques Delors a lancés peu après son arrivée à la tête de la Commission de Bruxelles. L’idée-maîtresse qui préside à la création de ces fonds est que les pays européens les plus riches doivent subventionner les plus pauvres de manière à accélérer le rattrapage de leur retard économique et social. Ils permettent aux pays bénéficiaires de se doter de routes, d’autoroutes, de ports, d’aéroports, de lignes ferroviaires, voire de stades ou de musées, en s’appuyant sur des transferts directs consentis par les Trésors (donc par les peuples) allemand, français, néerlandais, italien, anglais et d’autres encore. Ces investissements financés par l’extérieur, contribuant mécaniquement à la croissance comptable, c’est-à-dire à l’augmentation du PIB, les économistes les plus niais finissent par croire à leur effet d’entraînement durable. Il est vrai que tout touriste visitant l’Espagne peut en admirer les réalisations tangibles, par exemple le réseau de lignes à grande vitesse le plus dense d’Europe.
Alors que la législation franquiste empêchait les employeurs de licencier, la modernisation heureuse a également pour conséquence un début de normalisation du droit du travail. Pour sortir de l’impasse, le Parlement espagnol contourne l’obstacle en autorisant l’application de normes plus souples aux nouveaux contrats de travail, qu’ils concernent de nouveaux emplois ou des postes existants libérés par le départ de leur titulaire. En apparence, cette réforme est un succès puisqu’entre le milieu des années 1980 et la fatidique année 2007, l’Espagne est le pays européen qui crée le plus grand nombre d’emplois proportionnellement à sa population[3. La propagande néolibérale sur les rigidités du marché du travail responsables de tous les maux fait l’impasse sur cette modernisation partielle et réussie du droit du travail réalisée avant le grand essor.].
La folie des grandeurs
C’est durant les années 1990 que l’hubris s’empare des dirigeants de Madrid. Le pays est déjà la première destination touristique d’Europe, si l’on tient compte à la fois du nombre des visiteurs et de leur durée de séjour. Le boom touristique stimule l’activité de la construction, tout en saccageant les côtes du pays, non protégées de la pollution immobilière. Très peu de temps avant la relève du gouvernement de Felipe Gonzalès par celui de José Aznar, le pays s’oriente vers une croissance à marche forcée, dopée par la consommation et la construction. Il faut aller toujours plus vite, embaucher à tour de bras, montrer à l’Europe et au monde que l’Espagne compte à nouveau sur la scène économique et politique internationale.
Durant la fin de la décennie, le pays bénéficie, plus encore que ses grands voisins français, allemand, italien, de ce qui est – mais on ne le sait pas – la dernière belle période économique de l’Europe. Les effets stimulants de la consommation et de la construction s’ajoutent à ceux d’un développement industriel qui ne se dément pas et de la poursuite d’investissements gratuits dans les infrastructures. Mieux encore, l’Espagne, qualifiée pour l’entrée dans la nouvelle monnaie unique, commence à bénéficier de conditions d’emprunt favorables. L’Etat, les entreprises, les banques, les particuliers peuvent s’endetter à des conditions proches de celles dont bénéficient les agents économiques allemands ou néerlandais. Et ce mouvement encourageant, au moins en première apparence, va se poursuivre jusqu’en 2010, au point que le crédit des débiteurs andalous finit par égaler celui des débiteurs bavarois.
On pourrait aujourd’hui soutenir que si l’euro a fini par échouer, c’est parce qu’il avait trop bien réussi. Offrant aux emprunteurs grecs, irlandais, portugais, espagnols, le bénéfice d’une monnaie « forte », il conduisait à relâcher la vigilance sur la solvabilité, c’est-à-dire la capacité économique de rembourser ses emprunts. Il permettait aussi d’acheter à bas prix des marchandises étrangères, européennes ou non européennes, encourageait de ce fait les importations au détriment de l’équilibre extérieur.
Dans le même temps, les finances publiques espagnoles se portaient le mieux du monde. Le Trésor local engrangeait les plus-values fiscales liées au boom économique, sans avoir, pour l’essentiel, à supporter le coût des infrastructures. En 2007, le budget était excédentaire à hauteur de plus d’un point de PIB et la dette inférieure à 40% du PIB. On comprend presque l’émerveillement de Ségolène Royal et de Michel Sapin. Qui aurait osé bouder une réussite aussi éclatante ?
Or, au moment même où la prospérité espagnole brillait de mille feux, deux maux invisibles sapaient ses fondations. Tout d’abord, la croissance des rémunérations était plus rapide que celle de la productivité globale du travail : autrement dit, le bénéfice engrangé par l’entrée dans l’euro (équivalent à une dévaluation d’environ 20 %) a été intégralement affecté à des hausses de salaires. En deuxième lieu, et c’est là que se trouve l’origine de la faillite bancaire, les emprunteurs espagnols du secteur privé accumulaient les dettes. Dans les faits, l’Etat espagnol surfait sur la vague de prospérité entretenue par les emprunts toujours accrus des ménages, des entreprises et des banques. Un chiffre suffit à mesurer le phénomène: entre 1990 et 2011, la dette globale des agents économiques a triplé, passant de 120% à 360% du PIB, malgré la forte croissance de celui-ci entre 1990 et 2007.
S’il plus personne ne peut aujourd’hui nier l’ampleur de la crise espagnole, sa compréhension reste brouillée par deux erreurs d’appréciation qui émaillent les commentaires des autorités européennes et des journalistes économiques. La première consiste à voir dans la descente aux enfers de l’économie ibérique un sous-produit de la crise occidentale. La seconde réside dans la focalisation sur le boom immobilier, tenu pour le premier facteur de la faillite des banques. La réalité est bien plus fâcheuse. D’une part, la récession espagnole a commencé dès le printemps 2007, une année avant le basculement des grandes économies occidentales, et, d’autre part, le krach immobilier dissimule le surendettement des entreprises espagnoles tous secteurs confondus. Bref, il y a une crise spécifiquement espagnole, plus déterminante encore pour l’avenir de l’euro et de l’Europe que la catastrophe grecque, qui n’obéit pas seulement au schéma général connu depuis l’épisode du « subprime rate ».
L’ère du mensonge
C’est bien pour cacher cette singularité espagnole que les autorités de Madrid se sont employées depuis des années à biaiser ou à falsifier les bilans de santé.
La première falsification intervient au printemps 2009 lorsque la banque d’Espagne présente un rapport réconfortant sur l’appareil bancaire du pays. Il y est dit, en substance, que les banques ont échappé au séisme grâce à son excellente supervision. Sa présentation sera relayée dans toute la presse économique occidentale, en particulier en France, où beaucoup voient dans la reprise en main par les Banques centrales nationales le remède aux errements financiers. L’ennui, c’est ce que rapport est à l’évidence fantaisiste. Durant la période de boom du crédit, les banques locales ont octroyé des prêts nouveaux à un rythme deux fois supérieur à celui qui avait cours en moyenne dans la zone euro. Aucune personne sensée ne peut imaginer que cette masse de prêts ne comporte pas de mauvaises créances. Or, le rapport ne suscite pas seulement l’enthousiasme des médias, mais aussi celui des autorités européennes, dont notre compatriote Jean-Claude Trichet, qui, jusqu’au bout, accorde sa confiance à la banque d’Espagne – représentée au sein de la BCE.
Il est vrai que les banques espagnoles ont largement titrisé leurs crédits hypothécaires, dont une partie substantielle a migré vers les banques françaises et allemandes, se délivrant ainsi d’une partie des risques liés à ces crédits. Il est vrai aussi qu’elles détiennent d’importantes créances sur l’Etat espagnol dont le crédit est alors intact. Mais le montant global des créances encore inscrites dans leurs comptes n’en dépassent pas moins la norme autorisée. Et au printemps 2009, cela fait deux ans que la récession s’est installée et que les défauts de paiement des débiteurs locaux, inférieurs à 1% en 2007, ont commencé à s’aggraver. Il fallait donc surveiller les banques espagnoles comme le lait sur le feu au lieu de croire aveuglément ce que racontait la Banque d’Espagne.
La deuxième manipulation est observable dès le deuxième semestre 2007. Alors que les chiffres représentatifs de l’activité économique, emploi, consommation de détail, investissement, production industrielle, se dégradent à partir du mois d’avril, l’Institut national de la statistique, sous tutelle gouvernementale, et la banque d’Espagne (encore elle !) continuent d’afficher un PIB en croissance. Il faudra attendre le deuxième semestre 2008, au moment où l’Occident tout entier voit plonger son activité et son emploi, pour que la récession espagnole apparaisse dans les statistiques nationales.
Cette falsification des données macro-économiques était pourtant évidente: il suffisait d’observer séparément chacun des éléments intégrés par ces données. À partir de l’été 2006, les activités liées à la construction chutent de façon continue, pour atteindre aujourd’hui un niveau deux fois moins élevé que lors du pic antérieur. Entre le printemps 2007 et le début 2012, l’emploi total chute de 17%, l’emploi manufacturier, qui n’est pas directement affecté par la crise immobilière, de 20% environ. La production manufacturière baisse de 25%, la consommation de détail de 20%. En revanche, la consommation totale continue à augmenter durant toute la période de crise. C’est ce qui permet aux autorités espagnoles d’avouer une récession totale de seulement 3,5 %, inférieure à celle de l’Italie et de l’Angleterre, alors que 2,8 millions d’emplois productifs ont disparu. À titre de comparaison, la France, pays de 65 millions d’habitants, a perdu un demi-million d’emplois entre 2008 et 2009, tout en subissant une décroissance estimée par l’INSEE à 2,6%.
Les mensonges officiels n’y changeront rien. Victimes de l’insolvabilité des ménages, mais aussi des entreprises, qui sont les plus endettées de la zone euro, après les entreprises portugaises, les banques espagnoles subissent un taux de défaut de 8% en moyenne : en clair, les entreprises prises collectivement, ne pourront pas acquitter les dettes contractées. D’un autre côté, l’Etat et les régions accusent des déficits et des dettes croissantes que les efforts drastiques imposés au nom du rétablissement du crédit public ne permettront pas de résorber. Aussi, les autorités européennes s’attendent-elles à ce que le gouvernement Rajoy avoue bientôt qu’il sera incapable de tenir ses objectifs de réduction du déficit public.
Le taureau espagnol est maintenant au centre de l’arène, là où les grands matadors ont pour habitude de mener leur adversaire pour la mise à mort. Hélas, quand celle-ci sera intervenue, ce sont tous les Européens qui saigneront. Que restera-t-il alors de nos amours européennes ?[/access]
Photo : Lui G. Marín – www.luimalaga.com
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !