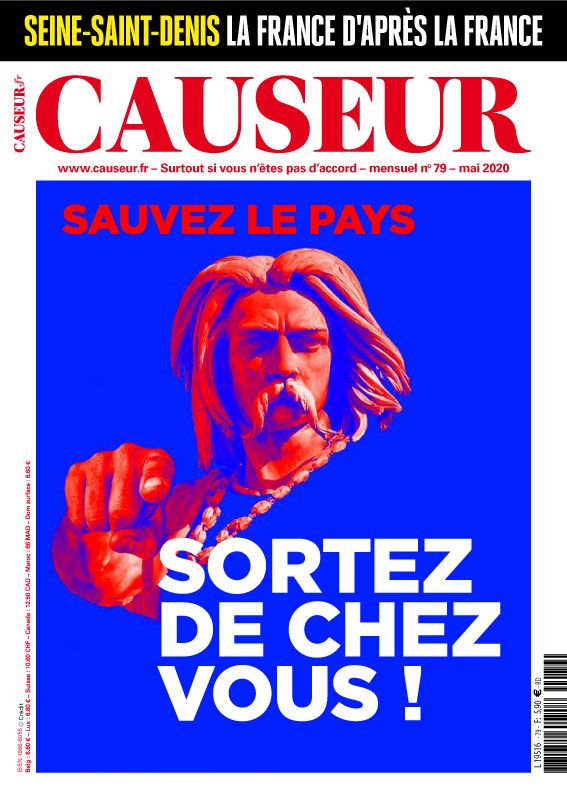Pour répondre aux besoins sanitaires illimités d’une population angoissée, l’Etat-Providence dispose de ressources limitées. A l’heure où la mort est devenue inacceptable, la puissance publique doit définir des priorités. Et évaluer le coût de chaque vie sauvée.
Dans une situation de pandémie, il est compréhensible que les besoins en santé d’une population angoissée soient illimités. Les ressources restant limitées, cette demande exponentielle révèle l’existence d’un domaine que la plupart d’entre nous ignorent : l’économie de la santé. Comme l’a écrit Michel Foucault, il s’agit « de la mise en rapport d’une demande infinie avec un système fini. […] Il va falloir décider que telle maladie, tel type de souffrance ne bénéficieront plus d’aucune couverture, que la vie même dans certains cas, ne relèvera plus d’aucune protection. […] C’est à cet endroit qu’une certaine rationalité devient elle-même scandale. » Cette citation renvoie à l’une des principales caractéristiques de notre civilisation postmoderne : l’exigence du risque zéro, la transformation de la maladie, de la souffrance et de la mort en scandales inacceptables. Pour ceux qui sont supposés répondre à cette attente – les professionnels de la santé, ainsi que ceux qui les financent et les contrôlent –, c’est une sacrée gageure.
Stratégie d’optimisation des ressources
La question du prix de la vie humaine a commencé à être étudiée de façon théorique dans les années 1970 avec l’avènement de l’État-providence. Il ne s’agissait pas de coller une étiquette de prix sur des personnes, mais d’optimiser les ressources disponibles pour sauver le plus de vies possible. Après un quart de siècle d’investissements prioritaires dans les structures, les équipements et le personnel, une question s’est imposée face à l’augmentation de la part des dépenses de la santé dans les PIB des différents pays occidentaux : quelle stratégie permet d’utiliser au mieux les moyens à notre disposition pour sauver une vie ? De telles évaluations deviennent d’autant plus utiles que le déficit de l’Assurance-maladie se creuse et que les finances publiques servent de garantie. Il devient donc urgent de pouvoir identifier les meilleures mesures de santé publique en termes de rapport coût/efficacité.
En posant des questions nécessaires à la formulation de priorités, l’économie de la santé se trouve confrontée à l’éthique. Les professionnels de la santé le savent bien, eux qui s’y frottent au quotidien et font des arbitrages au cas par cas. Mais à l’échelle d’une nation, il revient à la puissance publique de définir les priorités sanitaires. Les gouvernants sont alors tentés