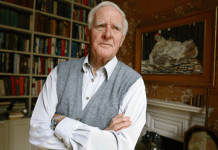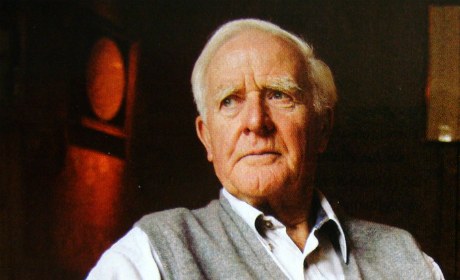
C’était un temps déraisonnable, mais finalement presque rassurant. À l’époque, les années 1960, à Londres, au 9 Bayswater street, près de Picadilly Circus, se trouvait le Cirque : des bureaux anodins, une administration poussiéreuse et des hommes à la banalité affectée qui ressemblaient à des ronds-de-cuir un peu gris. Le premier d’entre eux s’appelait George Smiley et, derrière son allure de petit fonctionnaire mal marié à une femme trop riche et trop jolie, il était un maître-espion. John Le Carré venait d’inventer l’anti-James Bond et, par la même occasion, devenait un des grands écrivains anglais de ce temps, propulsant une littérature de genre, le roman d’espionnage, à des altitudes inconnues.
Avec lui, aurait dit Borges, le roman d’espionnage devenait une branche de la théologie. Une réflexion janséniste sur le Bien, le Mal et le sentiment biblique du « combat douteux » surprenait le lecteur qui croyait simplement assister à des conversations sur d’éventuels agents doubles autour d’un single malt dans un club londonien ou à l’assassinat à mains nues d’un traître, sur cette terra incognita qu’était devenu le Bloc de l’Est.[access capability= »lire_inedits »]
Argent sale et sang des autres
L’Espion qui venait du froid, La Taupe, Les Gens de Smiley rendaient compte de cet univers où des étudiants étaient recrutés à Oxford pour le Grand Jeu et passaient, en quelques années, de l’étude du grec ancien à la traque sans pitié d’un ennemi invisible. Leurs fidélités contradictoires à des seigneurs rivaux du renseignement, les doutes qui les rongeaient inévitablement à force de jouer double et parfois triple jeu les faisaient parfois tomber aux mains de l’adversaire. À force de mensonges, d’identités falsifiées, de vies par procuration, ils ne savaient plus quels maîtres ils servaient au juste et tout se terminait par une exécution hâtive, sans gloire, dans l’impasse sans nom d’une ville tchèque d’importance secondaire. C’était un temps déraisonnable : c’était le temps de la Guerre froide et il cessa un jour de décembre 1989, réduisant au chômage ces héros paradoxaux frappés par un sentiment de vacuité prononcée.
Là où tant d’auteurs de romans d’espionnage passèrent à autre chose (roman noir, techno thriller), John Le Carré creuse le même sillon, à la manière d’un tailleur de Saville Row qui refuse la dictature du
prêt-à-porter made in China et persiste à faire du sur-mesure impeccable. Pour lui, malgré la chute du Mur et, avec lui, du Bloc soviétique, l’Histoire continuait, encore plus complexe. Celui qui n’avait eu de cesse de dévoiler le danger communiste, sa manière diabolique de s’infiltrer et de séduire les élites (on se souvient de la fameuse affaire Philby) s’est retrouvé dans un monde où le capitalisme imposait sa loi aux États, engendrant les principaux désordres géopolitiques de l’époque. On se souviendra de La Constance du jardinier, roman du cynisme absolu, dans lequel de grands laboratoires pharmaceutiques profitent des guerres civiles en Afrique pour tester leurs nouvelles molécules sur des cobayes humains.
Un Traître à notre goût, le dernier roman de Le Carré, prétend montrer les dessous de la crise financière de septembre 2008 et ses conséquences. Tout commence par un couple d’Anglais bien comme il faut, la trentaine active, qui prend des vacances à Antigua, paradis fiscal aux plages magnifiques. Lui, Perry, enseigne la littérature à Oxford. C’est un athlète accompli qui joue superbement au tennis. Gail est une avocate qui monte dans les cabinets d’affaires londoniens. Seulement Perry doute : il n’est plus du tout certain de vouloir terminer sa vie dans le cocon d’Oxford.
De ses parents de gauche, Perry a hérité une culpabilité qui lui donne envie, dans un Royaume-Uni en pleine déglingue, d’aller mettre ses compétences aux services de mômes défavorisés. Gail, que cette perspective n’enchante guère, propose ce séjour à Antigua : luxe, calme et volupté pour prendre le temps de faire le point. Ce sera évidemment un échec. La rencontre avec Dima, un mafieux russe, et avec toute sa famille, va changer la donne. Une sympathie réciproque et les confidences très encombrantes de ce banquier des oligarques et blanchisseur en chef vont faire de Perry un espion malgré lui. Dima demande en effet la protection du Royaume-Uni en échange de renseignements proprement terrifiants sur les manoeuvres de la City, prête à tout pour conserver son rang de grande place financière en dépit des séismes financiers à répétition.
De la tuerie de Bombay en 2008 aux coulisses de Roland-Garros en passant par la mémoire du Goulag, John Le Carré rappelle que l’argent sale qui submerge la planète, c’est d’abord le sang des autres. Dans ce livre où il fait preuve d’une maestria narrative encore plus grande que d’habitude, avec points de vue éclatés et chronologie fragmentée, on sent percer une pointe d’amertume sur son pays en voie de tiers-mondisation, qui a tout oublié, jusqu’à sa fierté séculaire : « Vous avez la réputation de penser que notre beau pays verdoyant a cruellement besoin d’être sauvé de lui-même. Il se trouve que je partage cette opinion. J’ai étudié cette maladie, j’ai vécu dans le marigot. Ma conclusion d’expert est que, en tant qu’ancienne grande nation, nous souffrons de pourriture managériale du sommet à la base. »[/access]
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !